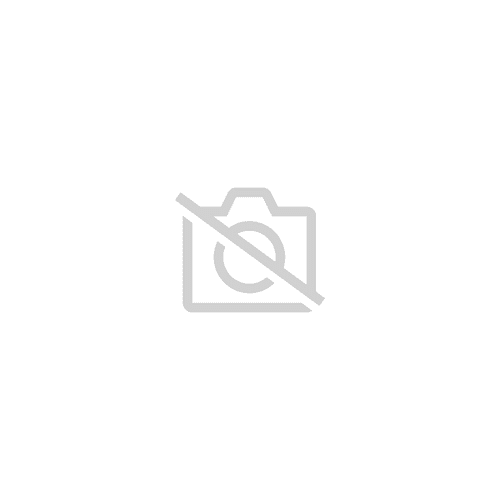Avertissement: la première version de ce texte a été rédigée en mai 2013; une deuxième version, partiellement révisée date de juin 2013 (en particulier le paragraphe sur le paradoxe éducatif après une relecture de l’introduction des Réflexions sur l’éducation Kant Paris, J. Vrin, 1993, p. 69.)
« Maintenant, on peut désormais écrire de nouveau le mot de « morale » qu’il fallait auparavant rayer de tous les dictionnaires »
Fichte

Pourquoi cette admiration pour la réflexion kantienne sur les principes de la morale ? C’est que Kant malgré sa vie sédentaire et souvent moquée a réussi dans la pensée un coup d’audace: celui d’avoir formalisé la réflexion morale en ramenant ses principe à l’autonomie d’une volonté raisonnable ne tirant pas ses règles d’action d’autre chose que d’elle-même. En effet, il constate d’abord que chaque homme n’est humain que par un pouvoir de juger qui le distingue des autres êtres de la nature, et lui confère:
“l’autonomie de la volonté [qui est le] principe unique de toutes les lois morales et de tous les devoirs qui y sont conformes “
Kant Critique de la raison pratique
Faire comme si ce pouvoir de juger n’existait pas, c’est vivre comme si était impossible la détermination des principes qui fondent la morale.
Philosopher, c’est s’interroger sur ce que nous devons faire, dire et penser. Or, avoir des principes d’action n’est pas ici l’expression d’une loi extérieure qui aliènerait notre liberté, comme la loi gravitationnelle qui rend nécessaire la chute d’une pierre (hétéronomie), c’est au contraire, se donner par soi-même et à soi-même, une obligation intérieure dont le respect constitue toute la valeur de la vie humaine. Par cette obligation, l’Homme se distingue à la fois de la bête (qui ne subit que des contraintes) et du divin (qui ne connait pas, de par sa perfection, d’écart entre ce qu’il est et ce qu’il doit être). Nous devons donc préciser le sens final d’une obligation morale: on distinguera ainsi trois sens des principes d’action: agir pour le bonheur, agir pour le Bien, agir pour le respect de la loi morale.
Agir pour le bonheur
C’est en quelque sorte la maxime du sens commun. Elle consiste à affirmer qu’il est moralement raisonnable de chercher à être heureux en suivant les bons conseils qui peuvent permettre de réussir sa vie. Retenons que cette poursuite du bonheur se prête mal à une clarification des raisons d’agir: le bonheur est un “idéal de l’imagination” (Kant) qui ne peut tout au plus qu’inviter à suivre des conseils de prudence formulés au conditionnel. Il est sans doute vain de chercher à déterminer raisonnablement ce qui nous rend heureux. Le “calcul des plaisirs” auquel invitent des philosophes comme Epicure dans l’Antiquité ou Mill à l’époque contemporaine est une méthode louable mais qui néglige ce “je-ne-sais-quoi” qui rend toujours le bonheur insaisissable à la prise de la raison, négligeant sans doute aussi l’irréductibilité du bonheur au plaisir.
D’ailleurs, les soi-disant “bons” conseils sont-ils toujours faits en connaissance de cause ? Ils n’engagent le plus souvent pas ceux qui les prescrivent, et témoignent plutôt de la volonté pas toujours raisonnable d’affirmer un ascendant autoritaire sur un esprit désorienté. Méfions nous donc de ceux qui voudraient faire notre bonheur à notre place, et reconnaissons donc que le bonheur n’est pas en lui-même une fin raisonnable, susceptible de prescrire le sens de nos devoirs. Il est alors essentiel de distinguer ce qui nous incline à désirer l’agréable et à fuir le désagréable (nos affects) de ce qui nous prescrit le Bien: la raison.
Agir pour le Bien
Agir pour le Bien est une maxime qui risque cependant aussi de poser un problème, si elle signifie en effet agir en donnant à la raison une forme qui fasse dépendre la volonté de la valeur estimée du bien qu’elle recherche. Kant critique ainsi les stoïciens qui identifient raisonnablement le souverain bien à la vertu: en cherchant la vertu par l’exercice de la raison, le philosophe s’éloignerait, selon les stoïciens, de la satisfaction trompeuse des plaisirs, et combattrait la tyrannie des désirs qui entretiennent l’état de manque et le sentiment de frustration. il se rendrait ainsi capable d’atteindre l’ « ataraxie » (la paix intérieure issue d’une libération des troubles de l’âme).
Kant choisit de définir le principe de l’action non par rapport à un souverain bien mais par rapport à l’intention de faire le Bien. Kant appelle ainsi « bonne volonté », la capacité d’agir qui nous élève au-dessus de notre nature sensible et de l’animalité. Exercer la bonne volonté, ce n’est pas seulement être conciliant (“je veux bien…”), ce n’est pas non plus avoir seulement le sens de l’effort (“faire preuve de bonne volonté”), ou de courage (“être volontaire” pour une action dangereuse), c’est purement et simplement agir par devoir, et non par l’incitation d’inclinations sensibles. Kant y insiste:
“Toute la valeur de l’acte accompli par devoir réside dans la pureté de l’intention qui l’inspire”
Fondements de la métaphysique des moeurs, (FMM) p45
Un exemple illustre bien le sens pur de cette bonne volonté, c’est celui du « désespéré moral »: celui-ci est en effet celui qui prend soin de sa vie sans l’aimer et qui souhaitant sa propre mort se donne une pure raison morale d’agir pour préserver sa vie, son action n’étant pas dès lors “suspecte” d’être accomplie par le mobile d’un amour de l’existence, c’est-à-dire par une inclination sensible et donc “amorale” pour la survie. Si parler de Bien n’est pas suffisant pour éclairer le sens de la bonne volonté, que reste-t-il pour comprendre et reconnaître le sens des principes de l’action ?
Agir pour le respect de la loi morale
Le vrai devoir se reconnait en ce qu’il est un devoir qui impose au sujet un impératif catégorique (c’est-à-dire indiscutable). Il n’est pas un simple conseil qui vaudrait conditionnellement selon les circonstances et dont on pourrait toujours relativiser la valeur (“Si tu veux du pain, vas au moulin”). Il est universel. Certes, certains conseils de prudence peuvent avoir une forme impérative (“Si tu veux la paix, prépare la guerre”), mais ils restent des “impératifs hypothétiques”, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas absolus, comme peut l’être l’impératif catégorique de la morale qui énonce:
“Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature.”
FMM, p137
“Agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen”
FMM, p150
Cet impératif catégorique n’est pas non plus dépendant de la définition d’un contenu parfait de la volonté comme le souverain bien fut-il aussi estimable que la vertu. Celle-ci est encore un idéal, sans doute plus définissable mais pas plus réellement saisissable que d’autres formes de Souverain Bien comme le bonheur. C’est ainsi à la forme de ce qu’il prescrit que le devoir moral se reconnait. De plus, si l’autorité de la loi morale est analogue à celle d’un commandement divin, par le caractère sacré qui s’en dégage, et l’effroi de la transgression qu’elle provoque, elle n’est pourtant jamais tirée d’une autre source que de celle de la conscience d’un être raisonnable élevant la maxime de son action à la forme universalisable de la loi, pour mesurer sa non-contradiction. C’est la morale qui peut alors servir de support à la croyance religieuse (et non l’inverse) en laissant espérer la possibilité d’une réconciliation future de la vertu et du bonheur dans un monde idéal qui obéirait aux pures lois de la morale (le « règne des fins ») et non seulement à celles de la nature.
Reste à savoir si les purs principes de l’action peuvent suffire à nous convaincre de faire notre devoir. Derrière cette question se cache l’enjeu fondamental du « pouvoir pratique » de la raison. La moralité du devoir se définit comme un « pur » principe d’obligation. Cette obligation suscite certes des sentiments moraux (remords, conscience, bienveillance envers autrui, respect de soi) qui motivent la volonté de son accomplissement et incitent à vaincre les penchants inclinant à ne pas être à la hauteur du devoir moral (paresse, désir de transgression). On peut aussi associer à l’obligation le plaisir du « devoir accompli », ou la déception devant l’échec de l’action entreprise; tous ces sentiments ne sont cependant pas suffisants pour s’assurer de la pureté de l’intention morale, car ils peuvent toujours relever de la complaisance : attitude qui consiste à se donner « bonne conscience » et que dénonce Pascal dans les Provinciales, en tant qu’elle étouffe la pureté rigoureuse de l’intention morale, en lui substituant un coupable relâchement de la rigoureuse intention d’être moral (au profit du contentement laxiste d’afficher cette moralité en apparence).
Le débat sur le respect juridique de la dignité et le paradoxe éducatif
L’obligation morale semble marquée par l’indétermination suivante: soit elle exprime des sentiments apparemment moraux, mais toujours suspects d’être impurs (la question se posant toujours de savoir si ces sentiments sont au service d’une obligation morale ou s’ils trahissent un intérêt impur mêlant à la motivation morale des mobiles a-moraux), soit elle exprime un motif pur, celui de la forme universelle et catégorique de la loi morale, mais ce motif lui s’expose à être ineffectif. C’est à cette indétermination que cherche à trancher la réflexion kantienne sur la politique et sur l’éducation.
Politiquement, les hommes manifestent certes leur raison en tant qu’ils veulent une société où chacun obéit à des règles : ils sont sociables, mais ils manifestent aussi leur déraison en tant qu’ils sont les premiers à transgresser en fait, dès qu’ils l’estiment avantageux, ces règles qui ne valent pourtant en droit que si chacun les respecte. Ils veulent le respect universel de la dignité, mais ne sont pas d’accord dès qu’il s’agit de faire un usage juridique de ce concept de dignité pour s’entendre sur ce qui est dignement respectable ou pas.
C’est que, contre le devoir d’accomplir ses obligations agit souvent sourdement la tentation de faire ce qu’on sait pourtant ne pas devoir faire (« Je vois le meilleur, je l’approuve et je fais le pire » Ovide), le comble du scandale étant la transgression allant ostensiblement contre la dignité de celui qui la commet. Il faut donc que la politique consiste à user des moyens de contraindre les hommes à adopter au moins une conformité extérieure de leurs actions au devoir, c’est-à-dire minimalement à « sauver les apparences » de la vertu.
La tâche de l’éducation est elle tout aussi délicate; elle consiste, en ce qui concerne son moment disciplinaire, en quelque sorte paradoxalement à former à la liberté sous la contrainte: un élève en effet n’est plus un nourrisson ayant besoin avant tout de soins, mais n’est pas encore un étudiant, pouvant d’une façon autonome recourir à l’instruction de la culture proprement dite (Attention: Kant appelle aussi culture, au sens large, l’ensemble des actions éducatives qui recouvre la discipline et l’instruction, par opposition aux simples soins).
« la première époque chez l’élève est celle où il doit faire preuve de soumission et d’obéissance passive ; la seconde celle où on lui laisse, mais sous des lois, faire déjà un usage de la réflexion et de sa liberté. La contrainte est mécanique dans la première époque ; elle est morale dans la seconde »
KANT, Réflexions sur l’éducation, Paris, J. Vrin, 1993, p. 69.
« Instruire », c’est savoir faire acquérir aux étudiants le sens moral (opposé ici à mécanique) de la contrainte, laquelle ne s’applique plus à ces élèves soumis et passifs qu’ils ne sont plus, mais à des sujets actifs, capables de s’appliquer eux-mêmes leur contrainte, cad « sous des lois, de faire (…) un usage de la réflexion et de (la) liberté », ce qu’on peut aussi appeler l’ « autonomie ». Ce qui explique bien souvent les difficultés de l’instruction est donc l’incapacité de l’éducateur et du système scolaire à faire initialement entrer de futurs étudiants dans la contrainte, condition de leur élévation disciplinaire à la hauteur d’une véritable conscience de la loi morale; ainsi, « le défaut de discipline est un défaut bien plus grand que le défaut de culture (au sens d’instruction) car celui-ci peut se réparer plus tard, mais la sauvagerie ne peut être chassée et une erreur dans la discipline ne peut être comblée » (Opus cit, p. 74).
Tout ces problèmes politiques et éducatifs montrent qu’une morale formelle de l’obligation ne suffit pas à penser la morale effective. Kant le reconnait qui affirme: « Il est deux découvertes humaines que l’on est en droit de considérer comme les plus difficiles; l’art de gouverner les hommes et celui de les éduquer. » (Opus cit). Tant que ces problèmes politiques et éducatifs ne sont pas résolus, il peut apparaitre bien vain de spéculer sur la réalité de l’autonomie morale…
La critique que Hegel adressera à Kant sera ainsi sévère quand il écrira:
“Le devoir pour le devoir, ce but pur est ce qui est sans effectivité”
Phénoménologie de l’esprit, 2, p185
La morale de l’autonomie risque ainsi de déchirer la conscience de chacun des sujets singuliers que nous sommes entre un idéal d’intention pure, et la réalité de penchants pathologiques, la condamnant ainsi à n’être qu’une conscience malheureuse écartelée entre l’être et le devoir-être, contradiction que peut certes résoudre le postulat d’un au-delà réconciliant la vertu du devoir et la jouissance des penchants dans une vie future (« le royaume des fins »). C’est cependant plus à la question : « Que m’est-il permis d’espérer ? » qu’à la question : « Que dois-je faire ? » que répond alors un tel postulat, et c’est par un « déplacement équivoque » (Hegel – Opus cit, p. 156) qu’est résolu le problème de l’effectivité de la morale. Ne faut-il pas alors introduire une pensée plus profonde de la responsabilité pour donner à la morale son effectivité ?