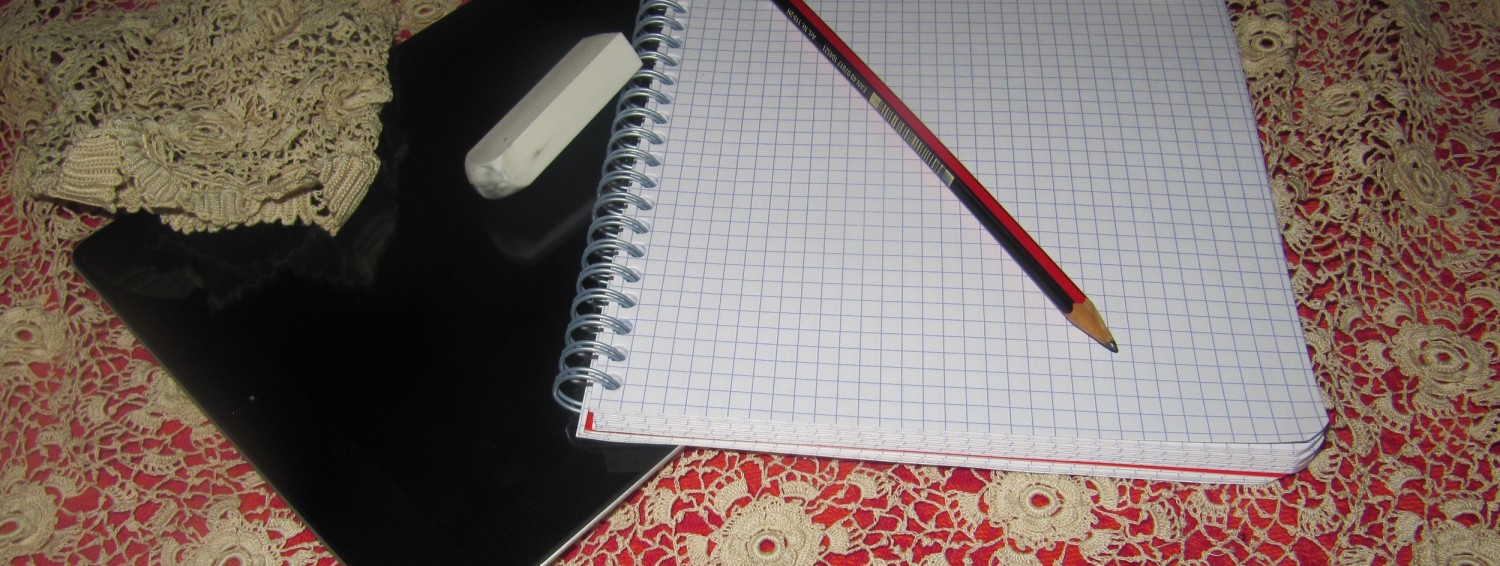Ce matin, j’ai dévoré trois articles qui figuraient en première page de ce blog. Le premier sur Hartmut Rosa et l’accélération du temps. Le deuxième sur l’utilisation des algorithmes dans les procédures de recrutement et dans le cadre du big data. Le troisième sur la manière dont l’utilisation de Google Art Project peut modifier notre regard sur l’art. Efficace : je gamberge encore. Arriverai-je à me soumettre à la discipline de le consulter régulièrement? C’est dur sur internet où la tendance est à la dérive de lien en lien.
Auteur/autrice : aufildestice
J'enseigne l'allemand depuis 34 ans. J'ai commencé ce blog en 2013 parce que l'internet a révolutionné et facilité ma pratique personnelle de la langue. Je suis convaincue qu'il peut aussi améliorer notre enseignement au quotidien et les apprentissages des élèves. J'ai donc créé ce blog pour documenter mes réflexions et mes pratiques. Depuis mars 2020, à cause de l'enseignement à distance mis en place avec le confinement, j'ai repris la plume. L'objectif : faire honnêtement le bilan des opportunités et des limites de l'enseignement avec le numérique.
Un an plus tard : TIC et langues vivantes : donner une recherche aux élèves.
Oui, j’ai renouvelé cette année l’expérience que j’avais faite l’an dernier et qui avait à moitié réussi. Réussi parce que les élèves en étaient sortis motivés et avaient appris beaucoup de choses sur la région qu’ils allaient visiter. Echoué parce que l’objectif linguistique visé n’avait pas été atteint.
La tâche à effectuer n’a pas beaucoup évolué et consiste à :
- choisir un lieu éloigné d’au plus 150 km de notre ville jumelle
- imaginer pour ce lieu une visite de musée et une activité
- préparer une présentation assistée par ordinateur et un exposé oral en allemand afin de convaincre leurs camarades que ce programme est génial.
Les différences concernent l’approche pédagogique et se concentrent sur deux points :
- la préparation en amont : elle a consisté à familiariser les élèves avec l’utilisation de sites en allemand et à rendre systématique cette utilisation
- l’accompagnement des élèves pendant la réalisation du travail et qui a comporté quatre aspects :
- définir les différentes étapes à parcourir pour réaliser le produit final
- formaliser ces étapes sur une fiche indiquant à quel stade les élèves étaient parvenus (sous forme de cases à cocher : fait, en cours, non fait)
- organiser le planning des séances où les élèves peuvent se retrouver pour travailler en groupe
- élaborer des fiches de travail individuel où l’élève explique ce qu’il a fait lui dans le cadre du travail de groupe.
Les points positifs du bilan sont les suivants :
- les élèves n’ont utilisé que très rarement des sites qui n’étaient pas en allemand. Ils ont donc réellement travaillé la compréhension écrite et la recherche d’informations en allemand
- ils ont utilisé le dictionnaire en ligne leo.de : c’est devenu automatique
- ils ont tous travaillé (sans doute dans l’objectif de compléter la fiche « parcours individuel »)
- ils étaient concentrés sur leur travail et enthousiastes (ils n’entendaient pas la sonnerie)
- ils ont beaucoup apprécié d’avoir la liste de sous-tâches à accomplir et de pouvoir cocher les cases au fur et à mesure de l’avancement de leurs travaux.
Les points à améliorer :
- la plupart des élèves ont rencontré des difficultés à travailler en groupe en dehors des séances prévues parce qu’ils habitent loin les uns des autres. Un groupe a contourné la difficulté en se créant une page sur Facebook
- certains élèves, bien qu’ayant le B2I n’ont jamais réalisé de présentation assistée par ordinateur. Si le travail de groupe a compensé ce manque, on observe sur ce genre de travaux une inégale maîtrise de l’outil
- je pense ne pas les avoir assez préparés à l’argumentation non pas d’un point de vue linguistique mais du point de vue de ce que signifie « argumenter ». Certains ont semblé découvrir à l’occasion qu’argumenter servait à convaincre l’autre. J’envisage donc de réfléchir à une meilleure manière de présenter l’argumentation en situation de communication.
Voilà donc trois points qui me permettent de prendre rendez-vous avec vous l’an prochain, pour une nouvelle mouture de cette tâche complexe.
En tout cas, pour ceux qui souhaitent connaître la première version de l’expérience, je les renvoie à mon premier article sur le sujet.
A la découverte de Danah Boyd.
Merci à Place de la Toile pour le grand entretien avec Danah Boyd diffusé le 16 mars 2013. Danah Boyd est une ethnographe américaine qui consacre ses travaux aux nouvelles technologies et à la manière dont les gens les utilisent, en particulier les adolescents.
D’elle même, elle raconte qu’ « elle a grandi en ligne » et que cela fut pour elle une riche expérience de socialisation . Cependant, elle reconnaît que cette expérience présentait des aspects contradictoires. D’une part, elle n’éprouvait ni le désir ni la volonté consciente de prendre des risques. D’autre part, ce qu’elle faisait n’était quand même pas sans danger.
Toutefois, cela l’a amenée à beaucoup réfléchir à l’usage des technologies, en particulier chez les jeunes. Pour cela, elle part d’un double questionnement :
- Qu’est-ce que les jeunes font réellement sur le web ?
- Qu’est-ce qu’on imagine qu’ils font sur le web ?
Elle confronte donc la réalité avec nos représentations de cette même réalité (où l’on trouve beaucoup d’anxiété et de mythes) pour tenter de définir les risques et les enjeux réels.
Ses premiers travaux de recherche ont porté sur l’usage que les jeunes faisaient de my space. La problématique en était : comment les jeunes construisent-ils leur identité (expression, socialisation et rapport aux pouvoirs) sur le web. La méthode consistait à se connecter régulièrement au hasard sur des profils inconnus et à rencontrer des jeunes en vrai. Pour en arriver à la conclusion que sur le net, les jeunes trainent comme autrefois les générations précédentes trainaient devant le supermarché du coin. Internet est donc un espace public où les jeunes se rencontrent sans rien faire de plus. On peut dès-lors se demander pourquoi ils ont quitté l’espace physique du supermarché pour rejoindre l’espace virtuel du web. Les raisons en sont diverses, mais les principales sont l’interdiction parentale de sortir, l’accroissement du nombre d’activités en dehors de l’école et donc de temps disponible et enfin l’absence de voiture. Cependant, il y a des différences notoires entre l’espace public et l’espace web. Dans ce dernier, le contenu est durable, reproductible , traçable, il peut aussi être amplifié ce qui peut conduire à un brouillage entre vie publique et vie privée.
Doit-on en conclure que les jeunes se désintéressent de ce qui relève de la vie privée ? D’après la chercheuse, non. Mais les jeunes rencontrent de nombreuses difficultés à défendre leur espace privé. D’abord parce qu’il est particulièrement compliqué de se retrouver dans les paramètres de confidentialité des sites dans la mesure où ils changent tout le temps. Ensuite parce que le contrôle exercé par les mères devient plus serré. Enfin, elle pose la question de l’idéologie de la transparence mais ce point mérite approfondissement.
Par la suite, Danah Boyd développe son point de vue sur le big data. Elle estime qu’une idéologie sous-tend l’évocation de ce nouvel univers de données. On imagine qu’en collectant beaucoup de données, on comprendra enfin l’humanité et qu’on en résoudra les problèmes. Mais pour l’instant, ce sont les entreprises qui le font et elles le monnayent . A ce sujet, Danah Boyd délaisse le registre du quantitatif pour poser la question en terme de pouvoirs et constate une différence entre l’Europe et les Etats-Unis. Si les Européens craignent l’intrusion des entreprises dans leur vie, les Américains redoutent celle de l’Etat. Mais pour elle, le danger est ailleurs. Quant on parle de liberté, on raisonne à l’échelle de l’individu. Or le changement introduit par le net, c’est la dimension réticulaire. Elle clarifie son propos en citant deux exemples. Celui du génome : quand je diffuse mon génome sur la toile, je le fais à titre individuel certes. Mais j’engage aussi toute ma famille, les enfants que je n’ai pas encore aussi. Quant à Facebook, quand un ami m’annonce l’ouverture de son compte, même si moi je n’en possède pas, je suis déjà quelque part sur le site comme ami (e) de, donc comme celui ou celle qui ressemble à. Danah Boyd estime donc qu’à partir de tous ces éléments, nous nous trouvons dans une situation tendue entre l’évolution du marché, les normes sociales, la loi et l’architecture sociale.
C’est alors dans ce cadre qu’elle définit son positionnement. Beaucoup lui reprochent de travailler pour Microsoft. Mais elle se considère comme une activiste dont la mission est de mettre en relief les complexités, les tensions et les peurs suscitées par un monde nouveau afin de faire de nous un public éclairé capable d’exercer son sens critique.
Pour ce qui me concerne, deux points ont particulièrement attiré mon attention :
- ses tentatives pour faire la distinction entre les changements réels liés aux nouvelles technologies et ce que nous en fantasmons
- ses interrogations sur les pouvoirs qui émergent de ces technologies et sur notre liberté vraie qui est une question qu’on ne se pose sans doute pas assez aujourd’hui.
La partie immergée du blog.
Le blog, c’est comme une plante verte. Si on ne l’arrose pas régulièrement, si on ne le taille pas au bon moment, il dépérit.
Derrière ces quelques articles (au maximum deux par semaine), il y a du travail.
-
D’abord, je prospecte pour trouver des sources fiables et renouvelées.
-
Ensuite, il y a la lecture de ces sources pour les transformer en fiches de lecture.
-
Puis vient le classement de ces fiches en catégories. Derrière celles-ci, j’envisage de créer des tags car je sais que certains articles se font écho et que je dois mettre cela en valeur. Mais ce que j’ai vu jusqu’à maintenant des tags me paraît trop embrouillé pour être vraiment utilisable.
-
Plus loin en amont, il y a la réalisation d’un fonds documentaire sur support durable car dans peu de temps, les liens aujourd’hui actifs deviendront d’illisibles « erreurs 404 ».
-
Enfin, il y a les concepts qui n’apparaissent pas encore mais s’élaborent progressivement.
Les jeunes qui passent leur temps devant des ordinateurs sont-ils sur le point de devenir incultes ?
C’est la question que pose l’émission « Place de la Toile » du 2 février 2013 et dont le titre est « Culture numérique et Jeunesse inculte ».
En effet, c’est un des problèmes que soulève actuellement le discours ambiant (tenu par qui?). Apparemment, nos jeunes ne lisent plus, ne savent faire que du copier-coller, chatter avec les copains, s’adonner à des jeux violents et errer de lien en lien.
Or, pour les participants à la discussion (il ne s’agit pas d’un débat puisqu’il n’y a pas de défenseur de l’idée d’un déclin de la culture), il y a une redéfinition de la culture et de l’accès à la culture.
Avant le numérique, le bien culturel était rare. Il avait été laborieusement construit par les générations précédentes. Seule, une minorité le détenait et le transmettait à un nombre nécessairement limité de représentants de la génération suivante et ceci dans des lieux dédiés.
Aujourd’hui, « on trouve tout sur internet ». D’où une autre approche de la culture et de la manière dont elle se construit. D’autres parcours entrent en concurrence avec les lieux dédiés à l’enseignement. Si 75% des jeunes font des recherches pour l’école, ils sont aussi 80% à en faire pour leur propre compte. Et ils se bâtissent ainsi des connaissances en parcourant, non pas le sentier balisé du cadre légitime, mais les sinuosités des hyperliens et de leurs propres associations d’idées. A cette occasion, ils ne se contentent pas de réunir des contenus : ils en produisent. 60% d’entre eux, en effet, utilisent vraiment les applications qu’ils ont téléchargées telles que les logiciels photos. Ils mettent ainsi en place une culture de l’amateur, par exemple à travers des mix. Ainsi impliqués, ils se regroupent souvent dans des communautés autour de leurs centres d’intérêt. Pas question ici de solitude devant l’écran, mais de l’émergence d’une culture populaire qui interroge la culture classique.
Au bout du chemin, peut-on dire que cette jeunesse devient inculte ? L’émission ne répond pas directement à la question telle que je la pose, mais sous-entend que non. Cependant, je m’interroge : les jeunes, que savent-ils au juste faire de et avec ces technologies ? Que puis-je et dois-je leur apprendre?
Mais que savent vraiment faire nos élèves avec les TIC ?
Pour ce qui est des technologies, les jeunes se débrouillent mieux que nous : ils sont nés avec. C’est ce que répète, à l’envi, un de mes collègues. Certes, sur certains points, il a raison. Mes enfants me battent à plate couture sur Temple Run ou quand il s’agit d’utiliser des claviers digitaux pour envoyer des messages.
Mais quand l’un d’entre eux doit faire une recherche sur internet ou rendre une production scolaire, il n’est pas rare qu’ils m’appellent à la rescousse. Parce que trouver un site intéressant et accessible nécessite l’usage de mots clés… bien pensés. Or, l’enfant (ou l’élève) ne réfléchit pas systématiquement aux mots qu’il va utiliser. Il reprend ceux de l’enseignant qui ne sont pas obligatoirement les mieux indexés. De plus, il peut être intéressant de consulter d’autres moteurs de recherche. Ah oui ? Parce qu’il y en a d’autres ???????
Quant aux productions, elles requièrent d’autres compétences autant techniques qu’intellectuelles : savoir utiliser les touches raccourcis du clavier, les puces et la numérotation des pages pose problème à plus d’un. Quant à la conception d’un texte – parce que dans notre société des écrans on écrit encore – elle exige autant de savoir rédiger que de construire sa pensée.
Alors, nos élèves se débrouillent-ils mieux que nous ? Plus j’observe, plus je suis convaincue qu’il y a des usages différents du web et que c’est dans ces différences lucidement repérées que doit se construire l’enseignement d’aujourd’hui.
Profweb.
J’aime beaucoup nos amis canadiens. Ils ont dix ans d’avance sur nous, nous font partager les résultats de leurs travaux gratuitement et tout cela en langue française. Cette pépite s’appelle « Profweb ».
Qui connaît John Hattie ?
Qui connaît John Hattie ? En France, je mise sur François Muller qui s’est intéressé de près à l’évolution du système éducatif néozélandais.
Car John Hattie est originaire de ce pays. En 1995, ce chercheur en éducation s’est lancé dans un projet fou : définir ce qu’est un bon cours en s’appuyant sur des études réalisées dans le monde anglo-saxon. Il a donc procédé à 800 méta-analyses reposant sur 50 000 études concernant 2,5 millions d’élèves. En 2008, il a publié un ouvrage « Visible Learning » où il présente ses résultats et les conclusions qu’il en tire. En mai 2013 sortira la traduction allemande de Klaus Zierer. Il va sans dire qu’en tant que germaniste, je me la procurerai parce qu’attendre la version française risque d’être un peu long. Merci en tout cas au journal « die Zeit » de se faire l’écho aussi de débats pédagogiques de fond.
Car cette publication imminente fait déjà l’objet, Outre-Rhin, d’échanges animés entre chercheurs en éducation. Mais que dit-elle au juste ? Tout ce que j’en dis maintenant est la synthèse d‘un article paru dans le Zeit du 3 janvier 2013.
Ce ne sont pas les équipements d’une école, ni la taille des classes, ni la concurrence entre établissements, ni les réformes de structure, ni l’individualisation des pratiques qui font un bon cours. Ce sont les enseignants et la manière dont ils conduisent leurs classes.
Les principes structurants d’un bon cours sont, selon Hattie :
- que l’enseignant mène son cours du début jusqu’à la fin, sans perdre de temps avec des choses inutiles et en veillant à ce que les élèves comprennent clairement ce qu’il attend de lui
- qu’il fasse cela mais en adoptant systématiquement le point de vue de l’élève
- c’est-à-dire en menant, en même temps qu’il fait son cours, une réflexion introspective sur ce qu’il fait et comment il le fait
- ce qui implique qu’il dispose d’un large répertoire de pratiques diversifiées lui permettant de trouver une solution aux problèmes pédagogiques qu’il rencontre
A cela s’ajoute la dimension affective de l’apprentissage qui ne fonctionne bien que dans un climat de respect, considération, attention et confiance.
Tout cela amène Hattie à poser la question du mauvais enseignant, question taboue par excellence.
Quel rapport entre tout cela et les Tice ? Aucun. Si ce n’est que les Tice pour les Tice ont toutes les chances de ne pas être efficaces, qu’elles ne le seront qu’intégrées dans des projets pédagogiques ciblés sur les élèves et que la formation des enseignants pensée en direction des élèves est le nerf de la guerre.
Distinguer l’apprentissage collaboratif de l’apprentissage coopératif.
France Henri et Karin Ludgren-Cayrol dans leur ouvrage « L’Apprentissage collaboratif à Distance » font la distinction entre l’apprentissage coopératif et l’apprentissage collaboratif.
Certes, il y a des points communs entre les deux approches. Elles reposent toutes deux sur la conception socio-constructiviste de l’apprentissage. Au plus près de situations réelles, les apprenants rassemblés en groupes doivent participer chacun individuellement à la réalisation d’une tâche. Les objectifs visés sont aussi les mêmes : il s’agit de développer l’autonomie et l’interaction, mais aussi des compétences de haut niveau telles que l’analyse, la synthèse, la résolution de problèmes et l’évaluation.
Cependant, tous les apprenants n’ont pas le même degré d’autonomie et de maturité ni le même sentiment de responsabilité dans le cadre d’un travail en groupe. La collaboration n’est pas acquise par tous, surtout pas encore par les jeunes apprenants, et s’apprend : par ce que les auteures appellent l’apprentissage coopératif.
Dans ce dernier cas, la manière dont les membres du groupe travaillent ensemble est strictement encadrée par le formateur. C’est lui qui organise, supervise, guide et contrôle (alors que dans un dispositif collaboratif, le groupe prend en charge sa propre régulation). C’est aussi lui qui définit très précisément les buts à atteindre et les démarches à suivre (alors que dans un cadre collaboratif, chaque apprenant détermine son parcours). Et l’enseignant prend tout cela en charge parce qu’il doit établir des procédures qui favorisent les contacts sociaux, le sentiment d’appartenance et l’engagement de chacun par rapport au groupe. Au terme de la séquence, il procède à une évaluation sommative du groupe sur la tâche à exécuter.
On peut se demander quel est l’intérêt de ce genre de réflexion dans un blog dont l’objet est l’usage des TIC dans l’enseignement. Or il ressort de nombreuses lectures mais je ne citerai ici que l’article de Rémi Thibert publié dans la revue de l’Ifé de novembre 2012 et intitulé « Apprentissages et Numérique : Web 2.0 » que c’est dans les activités de type socio-constructiviste que l’apport des TIC est le plus productif. Et comme mon idée, ce n’est pas seulement d’utiliser les TICE, mais de le faire efficacement, cette démarche s’impose.
Mes résistances face aux plateformes de cours en ligne.
Je suis convaincue que mettre mes cours en ligne serait un réel plus pour mes élèves. Mais aujourd’hui, c’est non. Pour deux raisons.
La première, c’est que notre institution n’est pas capable d’équiper tous les établissements avec la même plateforme et qu’elle envisage même, d’après le responsable de la formation que j’ai reçue en décembre, de changer de plateforme.
La seconde, c’est que la plateforme que nous pouvons utiliser actuellement va changer. Claroline va devenir Claroline Connect.
A quoi bon dès-lors investir du temps, à quoi bon former aujourd’hui des élèves à la dite plateforme si c’est pour changer de support au plus tard dans deux ans.
Travailler plus pour tout refaire ensuite, non.