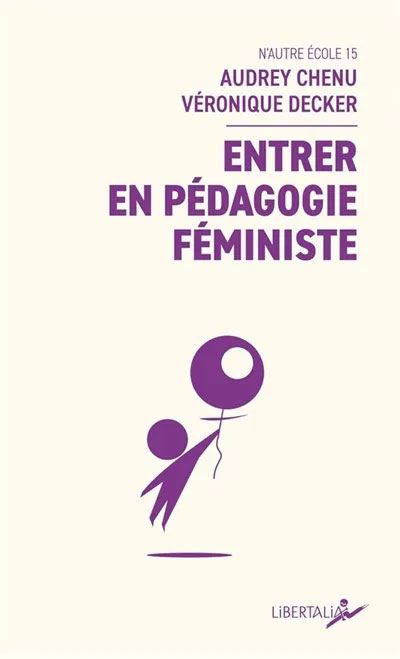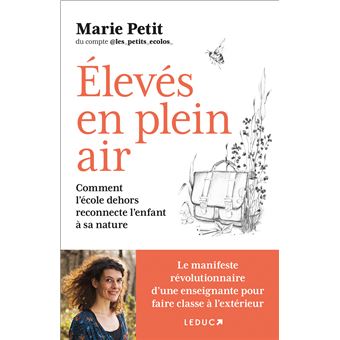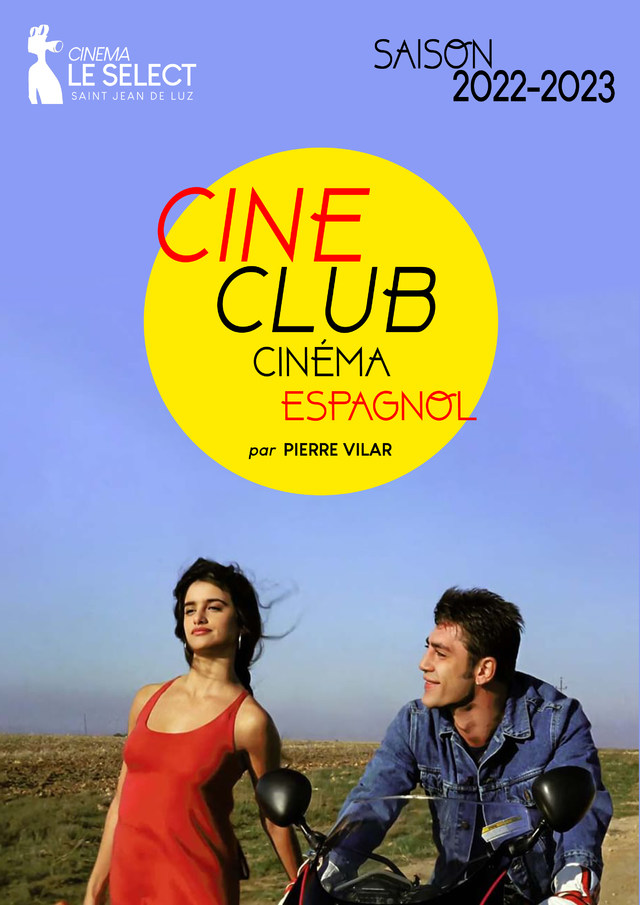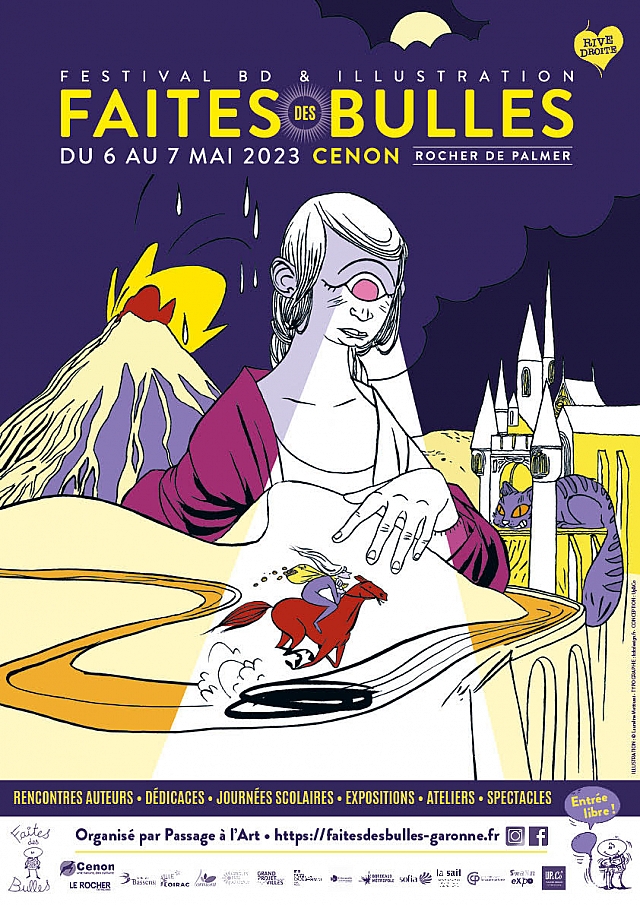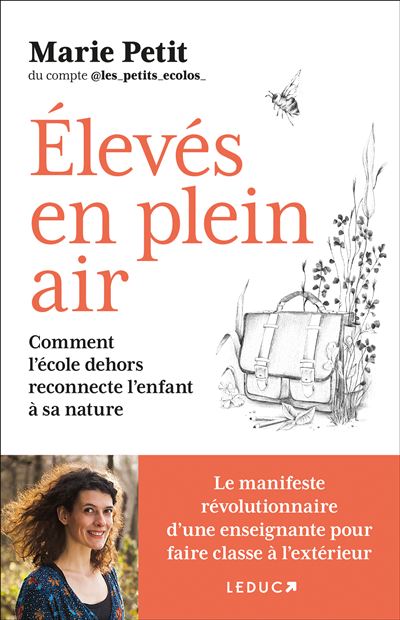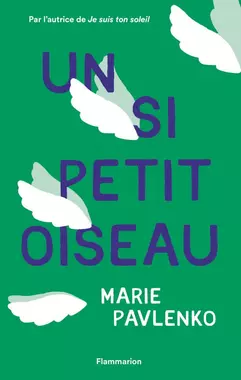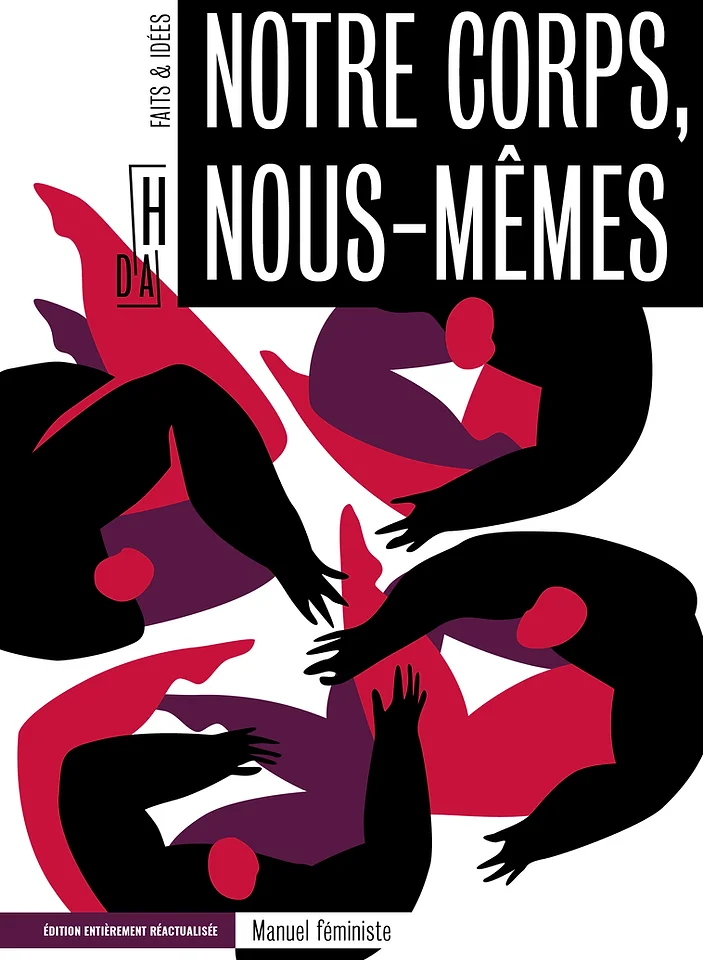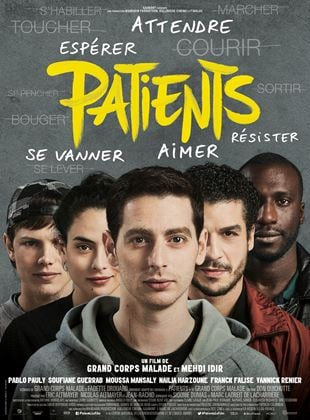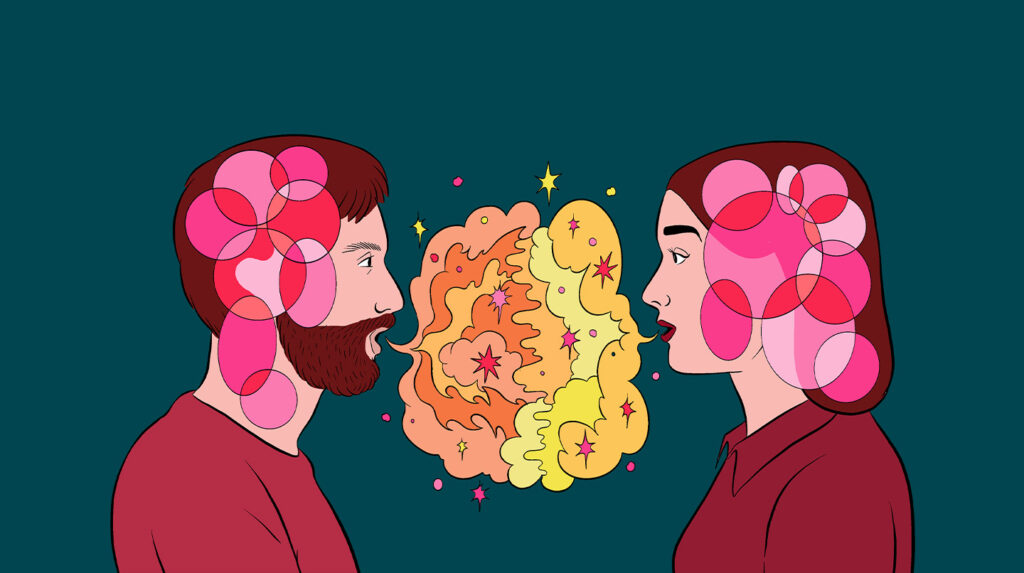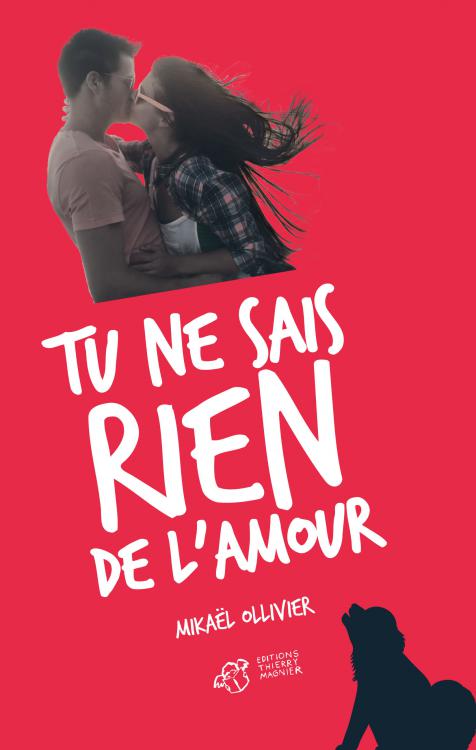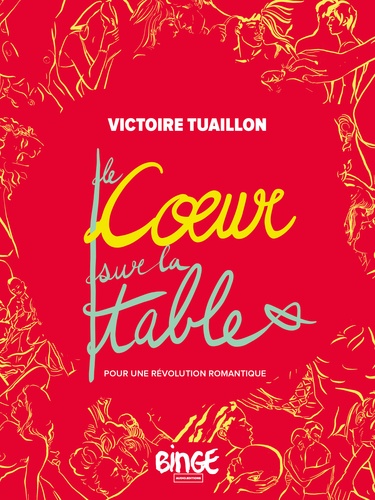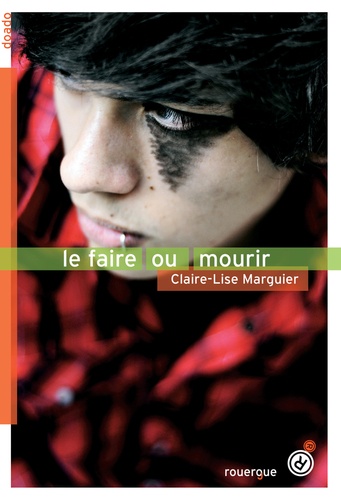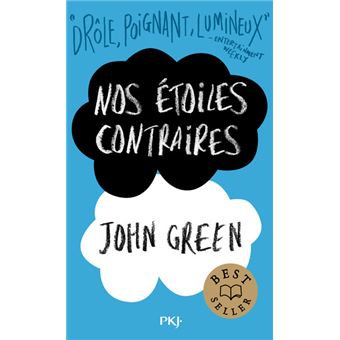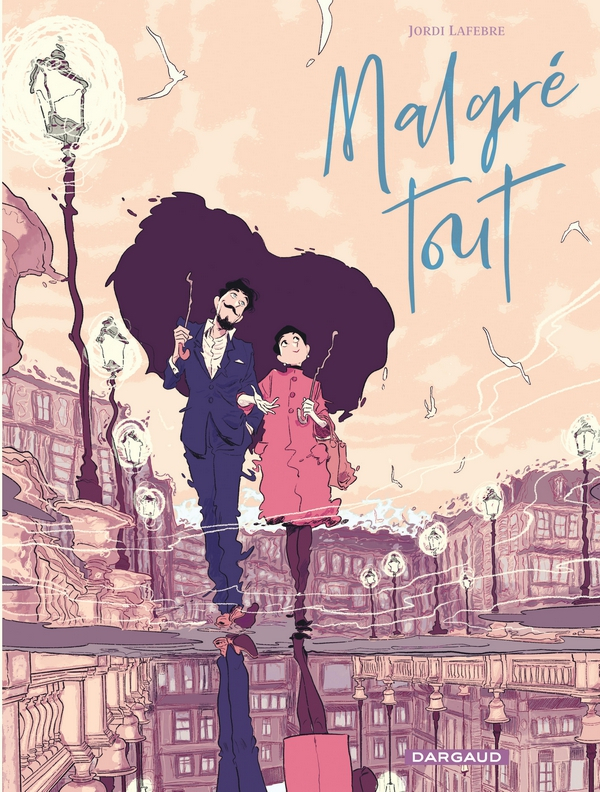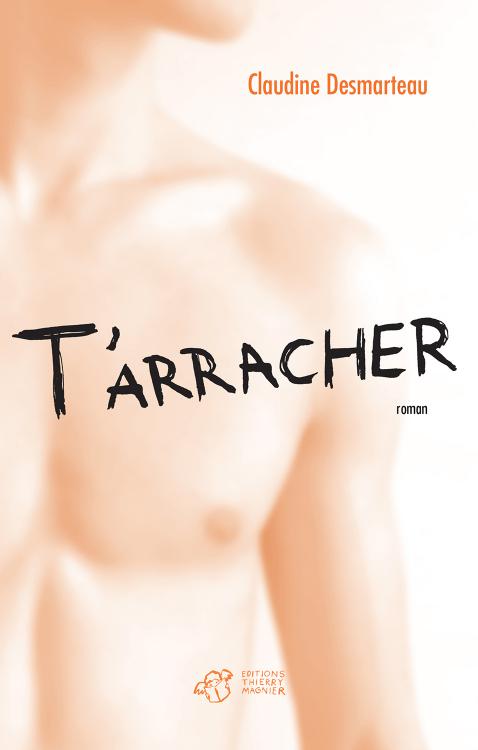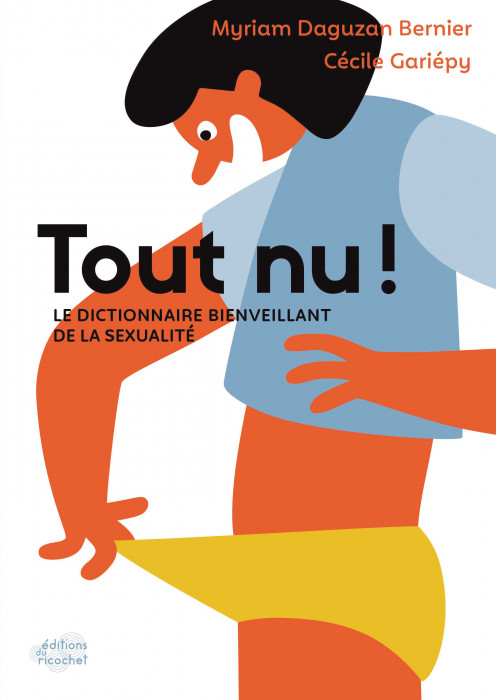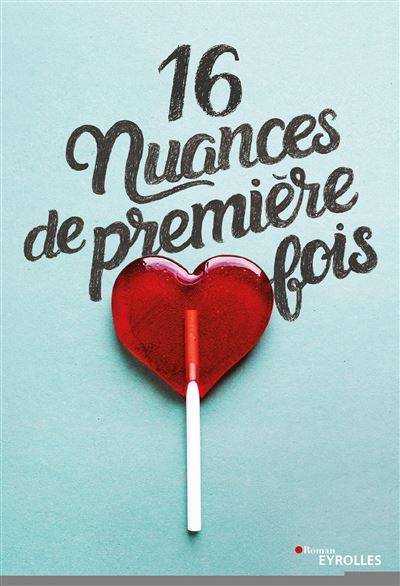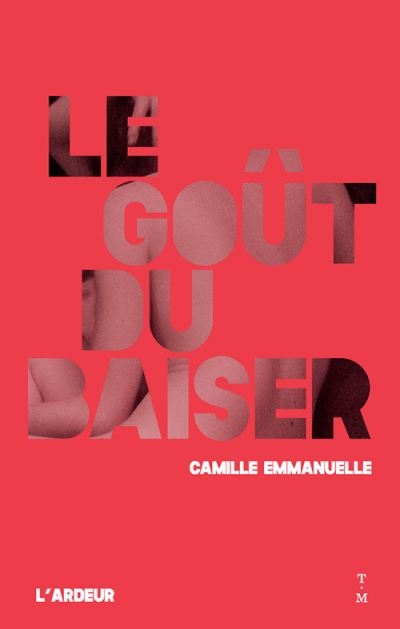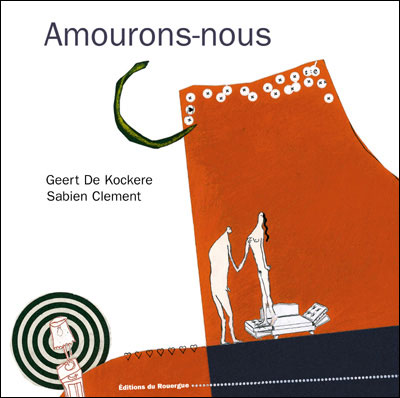Pour ce mois de Septembre, nous avions très envie de vous parler du rôle du professeur principal et ce que représente pour nous cette charge.
Et pour inaugurer ce mois à thème, j’avais envie de parler de ma frustration de Professeure principale en lycée.
Il y a deux ans, au bout de quelques semaines, je m’aperçois qu’une élève est absente depuis presque 3 semaines. Je demande alors à la cantonnade si l’un de ses camarades à des nouvelles. Un élève me répond mais c’est qui H?? Nous étions à la fin du mois de Novembre, étonnée, je lui rétorque sèchement que ce serait bien qu’il prenne connaissance de l’ensemble de ses camarades, en faisant un bref laïus sur la solidarité de classe,etc…
Un brouhaha se détache et je prends alors conscience que ma classe n’est plus une classe exceptée 8 heures par semaine. Ils ne sont dans quasiment aucun cours ensemble. Langues séparées, spécialités séparées, sections réservées qu’à certains élèves, enseignement scientifique en demi groupe, options en petit effectif,…. Oui la classe au lycée, c’est acté, n’existe plus!
Cette nouvelle me rend triste et je repense avec délice aux premières fêtes, à ce moment de joie où nous avons appris ensemble que nous étions reçus au baccalauréat, à ces camarades qu’on a soutenu, aidé, les repas de classe, les soirées pizza- K7 vidéo qui clôturaient chaque période, les histoires aussi, les premières fois, les premières manifs, les premiers cafés à l’extérieur avec les fiches de révision! Là en 2020, tout ça n’existe pas, tout ce qui a fait nos souvenirs d’adolescents a volé en éclat sans que personne ne s’en rende compte ou si peut être un ou deux spécialistes dans les cabinets du ministère.
Au delà de ces anecdotes de jeunesse, je pense qu’une classe est la première forme de collectivité à laquelle est confronté l’enfant avec tout ce que cela implique. Le respect, la tolérance, la solidarité, l’écoute, la bienveillance, …. et c’est bien dommage que cela fasse défaut dans notre société actuelle. Ou je ne veux pas virer au complotisme mais c’est aussi peut être souhaité de détruire ce qui permet de vivre la fraternité pour nos jeunes, afin de rendre l’individualisme notoire de notre société plus acceptable.
Alors comment fait-on CLASSE? Et bien je n’ai pas encore la solution. L’an dernier, j’avais tenté un projet de classe artistique mais ce fut un échec cuisant parce que ce qui se fait en vie de classe ne rapporte aucun point, parce que l’artiste n’a pas réussi à partager sa pratique correctement au vue d’un nombre d’heures dérisoires que l’établissement lui proposer pour présenter sa pratique, parce qu’il est quasiment impossible d’organiser une sortie sans que certains élèves soient dans l’obligation de rattraper des évaluations du contrôle continu, ou qu’ils subissent une pression pour assister à des « cours jugés plus importants » .
Alors pour cette rentrée, je me pose toujours la question : Comment fait-on CLASSE au lycée? Des réponses les semaines à venir peut être….