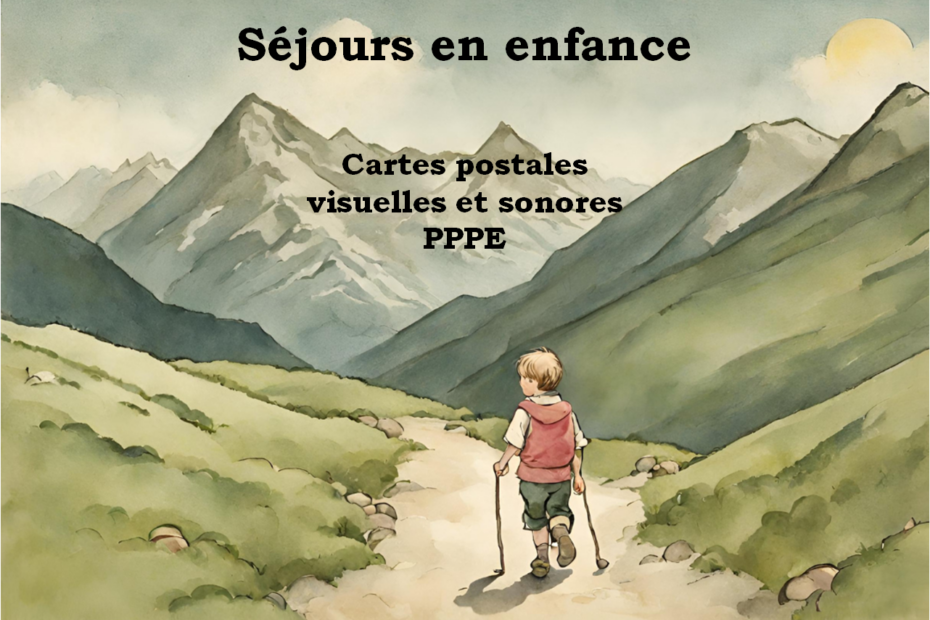Cliquez sur l’image ci-dessous
pour découvrir la carte postale sonore interactive :

Le roman « La gloire de mon père » est paru en 1957 et est le premier tome d’une série de romans autobiographiques publiés par l’auteur sous le nom de « Souvenirs d’enfance« . Ce premier tome débute avec la naissance de l’auteur le 28 février 1895, dans lequel celui-ci nous raconte son enfance à Marseille, ses premières années passées à l’école primaire ainsi que ses vacances en famille près du village de la Treille. Le roman prend fin sur les exploits de son père lors d’une partie de chasse dans les collines du massif du Garlaban. À travers ce premier tome, le lecteur découvre Marcel dans son enfance sous la forme d’un petit garçon intelligent, curieux, débordant de joie et d’amour.
De plus, au sein de ce roman, le représentation de l’enfance est débordante comme nous l’atteste la présentatrice Lou lors de la diffusion de son émission « Nos Enfances en Pagaille ». En effet, celle-ci analyse que » une appétence qui se retrouve souvent chez les jeunes enfants [et notamment chez Marcel], c’est celle du sang-froid et du sens de la débrouillardise. » Ensuite, elle souligne que » [les enfants] adorent la plupart du temps s’adonner à l’observation, à l’expérimentation et à la recherche quant au fonctionnement des mécanismes de l’être vivant. Ainsi, il n’est pas rare de voir un enfant “jouer” avec un animal alors que, en fin de compte, celui-ci manque un petit peu de douceur et commence très facilement à le disséquer.«
Face à l’horizon azur de ma fenêtre, j’ai eu une idée : et si je créais une structure à la fois délicate et robuste mais aussi compréhensible et implicite pour représenter ce petit garçon intrépide et courageux qu’est Marcel.
À la suite de cette première idée, j’ai commencé. Je me suis d’abord demandé comment j’allais représenter ce petit homme et après réflexion, j’ai remarqué qu’en fin de compte, tout au long du roman, Marcel Pagnol nous partage une représentation de son enfance plutôt joyeuse et bien vécue mais aussi et surtout, les prémices de la construction de sa personnalité et de son identité.
À partir de ce moment réflectif, je suis revenue sur mes notes, j’ai fouillé, observé et me suis imprégnée de l’écriture de Marcel Pagnol pour en arriver à une conclusion subjective ; celle que, en fin de compte, l’auteur compare implicitement des valeurs, des expériences ainsi que des représentations qui sont à l’origine de sa propre construction.
Ainsi, j’ai remarqué plusieurs oppositions au sein de la personnalité de Marcel mais aussi dans son espace familial et auprès des membres de sa famille. Pour exprimer ces différences, j’ai voulu jouer sur un jeu à double-face où deux symboles concrets ou abstraits s’opposent mais dans une entité commune car elles sont à la base ou à la construction de l’identité de Marcel.

Le premier jeu d’opposition que j’ai remarqué le plus aisément chez Marcel est le fait qu’il peut être à la fois un vrai ange mais aussi un petit démon parfois. Cette différence se retrouve tout au long du roman mais aussi dès son début notamment lorsque Marcel évoque son intérêt à observer l’abattage des animaux en face de chez lui. Celui-ci atteste page 30: “Pendant que ma mère faisait son petit ménage, (…), je regardais l’assassinat des bœufs et des porcs avec le plus vif intérêt.”
Ensuite, sa tendance à apprécier la cruauté mais tout simplement aussi l’expérimentation est retrouvée aux pages 38 et 39 où celui-ci s’amuse (pendant que sa tante a le dos tourné) à lancer des pierres sur les canards de l’étang “(…) avec la ferme intention d’en tuer un.” Il souligne même que “cet espoir, toujours déçu, faisait le charme de ses sorties (…).”
Au contraire, ce petit garçon peut se montrer aussi très doux et inquiet notamment par rapport aux membres de sa famille et particulièrement de sa mère. En effet, durant leur voyage entre la maison résidentielle et la maison de vacances, celui-ci est dérangé par l’idée que sa mère s’épuise en faisant autant de chemin à pied, il le dit lui-même à la page 78: “Mais moi je pensais que c’était beaucoup pour elle.” Ainsi, il n’hésite pas à prétexter des fausses douleurs (notamment à la cheville) pour s’assurer que sa mère a le repos nécessaire avant de continuer la marche. Cette attitude bienveillante s’oppose radicalement à son appétence à la cruauté animale mais n’est-ce pas une caractéristique commune chez les enfants ? Ceux-ci n’aiment-ils pas jouer avec les animaux et expérimenter juste pour voir comment ça fonctionne sans aucune arrière-pensée néfaste envers l’animal ?


Par la suite, j’ai remarqué tout au long du roman que Marcel peut être amené à se questionner souvent par rapport à ce que les adultes ont le droit ou non de faire et en fonction des libertés qu’ils peuvent s’octroyer, celui-ci se permet lui aussi d’adopter ces droits qui lui étaient avant proscrits. À titre d’exemple, alors que les balades au parc Borély étaient de plus en plus communes avec sa tante, Marcel rencontre Jules qui se présente à lui comme étant le propriétaire de ce parc. Le petit garçon le croit sans même hésiter. Pour autant, quelques balades après, Jules lui avoue, gêné, qu’en fin de compte, il n’est qu’un simple homme et non propriétaire de ce parc. Marcel, complètement abasourdi, souligne dans le roman à la page 47: “(…) je découvris ce jour-là que les grandes personnes savaient mentir aussi bien que moi, et il me sembla que je n’étais plus en sécurité parmi elles”. Ainsi, alors qu’auparavant la rencontre, mentir pour Marcel lui était difficile et source de questionnement (par rapport à la notion de droit, de bien…), celui-ci commença à se le permettre sans aucun remord et encore mieux, comme il l’atteste page 47: “(…) cette révélation, (…) m’apporta la paix du cœur, et lorsqu’il était indispensable de mentir à mon père, et que ma conscience protestait faiblement, je lui répondais: “Comme l’oncle Jules” ; alors l’œil naïf et le front serein, je mentais admirablement”. Dès lors, grâce à l’intervention inconsciente des adultes, l’ambivalence entre mensonge et vérité au sein de la construction subjective de Marcel est réglée parce que celui-ci ne va plus se culpabiliser face au mensonge et plutôt s’octroyer le droit de mentir ou dire la vérité en fonction de l’importance du moment présent et de ses intérêts.


Le dernier jeu d’opposition notable dans ce roman est la différence de croyance religieuse entre Jules et Joseph. Le premier, s’assume être chrétien alors que l’autre se revendique être athée. Ainsi, lors de leurs nombreuses discussions, leurs avis peuvent être divergents et le ton peut monter très rapidement. Pour autant, cette différence religieuse est une vraie richesse pour Paul et Marcel qui, lorsqu’ils seront grands et aptes à prendre leur propre décision, pourront compter sur une culture religieuse diverse et variée et surtout sur leur capacité à s’ouvrir à l’altérité. Dès lors, à certains passages du roman, l’oncle Jules, sans le vouloir spontanément, apporte des connaissances religieuses à Marcel comme le fait que le dimanche est un jour sacré pour les chrétiens parce que c’est le jour du Seigneur, c’est-à-dire le mémorial de la mort et de la résurrection du Christ. Pour autant, Jules peut aussi avoir une croyance si profonde qu’il en oublie la nécessité de partager aux enfants, et notamment à Marcel, l’ouverture à l’altérité comme à la page 161 où celui-ci s’exclame face à l’inconvenance selon lui du petit Marcel: “L’ouverture ? Mais ce n’est que demain ! … Demain, c’est dimanche ! Est-ce que tu crois qu’il est permis de tuer les bêtes du bon dieu, le jour du Seigneur ? Et la messe alors, qu’en fais-tu ?” Au contraire de cette croyance parfois excessive, Marcel peut aussi compter sur la vision plus neutre et moins explosive des croyances de son père Joseph. Ainsi, celui-ci est amené, inconsciemment et dès son plus jeune âge, à comparer des valeurs et des idées et à s’ouvrir à l’altérité tout en ayant conscience de l’excès. Dès lors, ces expériences familiales peuvent avoir un rôle majeur dans sa construction identitaire.


Pour finir, j’aurais pu continuer encore longtemps sur ces différences et oppositions au sein du roman mais dans un souci de praticité, j’ai décidé de m’en tenir qu’à trois d’entre elles qui m’étaient les plus facilement repérables. Pour autant, j’aurais pu tout de même citer l’ambivalence entre le savoir manuel et intellectuel qui est transmis au petit Marcel et qui est visible particulièrement au début du roman. Tout de même, je tiens à préciser un détail visible sur ma structure, c’est l’épaisseur variée des fils qui soutiennent ces représentations. En effet, j’ai choisi de privilégier un fil épais pour les différences qui allaient jouer un rôle au moment T du roman dans la construction identitaire de Marcel tels que son rapport à la méchanceté/douceur (reconnaissable à travers la représentation métaphorique de l’ange/du démon) ou encore son expérimentation du mensonge et de la vérité. Ainsi, contrairement au fil épais, le fil fin est utilisé pour les différences qui vont construire Marcel dans sa vie future mais qui ne sont pas encore à la base de son façonnement identitaire au moment de la période du roman.
Pour conclure, j’espère de tout cœur que vous avez compris et saisi mon rapport à l’œuvre de Marcel Pagnol à travers la réalisation de ma structure créative. Si ce n’est pas le cas, j’en suis désolée mais pour autant, je vous souhaite une bonne continuation dans votre lecture des articles de mes camarades. 🙂