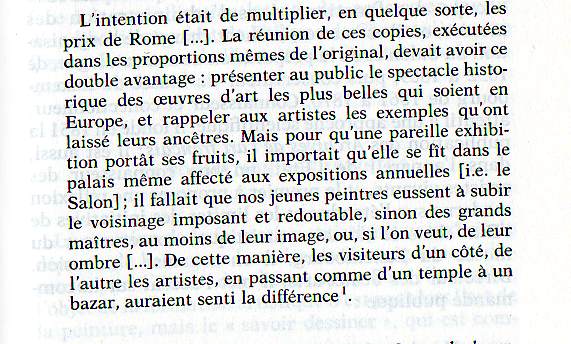Art et pouvoir politique au XIXe siècle en France
En France, tous les régimes politiques du XIXe siècle siècle ont peu ou prou suivi une politique à la fois de soutien (commandes publiques, salons) et de plus grande liberté laissée aux artistes par le rôle accordé aux Beaux Arts, à l’Institut et aux Salons, institutions devenues autonomes par rapport au pouvoir. Les fondements d’une politique « culturelle » nationale datent de cette période.
La France considère toujours les arts comme un domaine « patrimonial » et soutient les artistes même si le marché de l’art s’est considérablement développé depuis le la fin du XIXe siècle. Parallèlement la conception des arts évolue, on passe des Beaux Arts aux Arts Plastiques dans la 2e moitié du XXe siècle. Pour les politiques culturelles sous la Ve République, voir le site réalisé par le Ministère de la Culture à l’occasion du cinquantenaire de sa création. Il est un peu auto-célébrant mais mérite le détour par la mise au point historique des politiques culturelles initiées par André Malraux, fondateur du ministère sous la présidence du Général de Gaulle (voir en particulier les textes sur le patrimoine, les musées, les équipements culturels, les Arts plastiques etc.
La Révolution bouleverse la donne culturelle en supprimant toutes les institutions de l’administration royale des arts. Elle affirme le rôle éducatif de l’art et crée ses institutions culturelles les plus durables :
le musée et l’Institut : qui n’est pas l’Académie puisque les membres sont cooptés par vote des membres. Les académies sont supprimées, l’âge des membres tend à s’élever.
Voir page dédiée sur le site.
L’essor des musées au XIXe siècle provoque une véritable compétition entre les États pour étoffer les collections. Un cas typique de cette fierté de posséder des œuvres en Allemagne : La Madone Sixtine actuellement à Dresde, a été offerte au XVIIIe siècle par les moines italiens au duc de Saxe. Au XIXe, comme c’est un des rares Raphaël en Allemagne une salle lui est dédiée dans le musée. L’oeuvre est insérée dans véritable autel et des sièges sont placés en face pour le public (-> cf. valeur cultuelle aura de Wlter Benjamin). Hans Belting analyse de façon magistrale ce cas dans « Le chef d’oeuvre invisible« .
A Berlin, au moment où on instaure sous Louis Philippe le musée de Versailles (1833). Le Altes Museum construit par Schinckel (1823-1830), sur « L’île aux musées » au milieu de la Spree. L’Allemagne est pionnière dans la réflexion muséographique dans le sillage du Bildung de Goethe et de Winckelmann (accomplissement de soi par l’expérience esthétique face aux œuvres (en particulier celles du passé, de l’Antiquité, que critiquera Nietzsche), le musée est considéré comme un lieu de formation de l’esprit selon l’idéal grec. L’État prend en charge ce projet pédagogique et culturel -> véritable sacralisation de l’art qui s e substitue à la transcendance religieuse (cf. Madone Sixtine) ;
En Grande Bretagne c’est l’initiative privée qui prime, peu d’investissements publics, mais grande libéralité dans l’accueil d’un public éclairé dans les demeures de la noblesse. Les musées se développeront au XIXe grâce au mécénat privé et aux municipalités. -> Vision très pédagogique -> collections de cartels instructifs sur l’histoire de l’art chacun par quelques spécimens bien choisis à cause de leur valeur pour les chercheurs et pour l’instruction publique.
En Italie : faiblesse structurelle des musées, manque de moyens, État-nation jeune (Risorgimento 1861, Rome capitale 1870), héritage des cités -> « localisme » et contestation de la primauté romaine.
Etats-Unis : création des grands musées dans le dernier 1/3 du XIXe Le Metropolitan de New York (1870) le Art Institut de Chicago (1879-1893)
1. La tendance sous la Restauration est à la séparation entre ce qui relève de l’administration des arts et ce qui relève du pouvoir monarchique.
Extrait de l’Ordonnance de Louis XVIII (1816) :
» L’administration des Musées Royaux a pour objet :
1) la conservation des ouvrages d’art tant anciens que modernes, en peinture, sculpture et gravure, qui appartiennent à la Couronne;
2) l’encouragement des artistes, la diretion et la surveillance des travaux qu’on leur a confiés, soit à titre de libéralité royale, soit pour le service de la Couronne ».
Sous Louis Philippe (1830-1848) la liste civile est rétablie (= part du budget de l’Etat accordé à la Maison du roi).
Ce qui est frappant c’est l’opposition entre, d’une part, les roi sbienveillants vis à vis des peintres novateurs, ainsi que et des députés soucieux de la redistribution d’œuvres majeures vers la province (Thiers fait envoyer à la Ville d’Aix un grand tableau d’Ingres 1811 : Jupiter et Thétis), et, d’autre part, l’Institut d’une rigidité jamais égalée depuis, les Salons refusant souvent des artistes auxquels l’Etat avait passé commande !
– Les académies sont donc rétablies, mais elles tombent dans un classicisme sectaire. De plus les académies provinciales ne sont pas rétablies, d’où un assèchement de la production artistique provinciale.
– Les artistes s’organisent et obtiennent l’indépendance de la création surtout sous la monarchie de Juillet. Parallèlement, une véritable révolution culturelle s’opère dans le marché de l’art : au mécène se substituent l’amateur d’art, le critique, le collectionneur.
2. La IIe République 1848-1852 : vers une démocratisation ?
La démocratisation se traduit par un rôle croissant dans le choix des œuvres du Salon de la part des artistes organisés en Comité des Arts dès avril 1848. Parmi d’autres décisions, le directeur des Beaux Arts Charles Blanc ( frère de Louis Blanc) incarne une politique républicaine des arts veut promouvoir l’art public au détriment de l’art de chevalet « trop individualiste ».
Il organise le concours pour la représentation peinte, gravée, sculptée de la République en mars 1848. Il est obsédé par l’idée que seul le grand art doit orner les édifices, il préconise comme Thiers de copier les grands chefs d’œuvres italiens (comme la Chapelle Sixtine) et les reproduire dans les monuments français, il écrit une « Grammaire des arts du dessin », où il fait l’éloge des canons esthétiques traditionnels. Il propose un musée de copies universel.
Victor Schoelcher relève de son côté à l’Assemblée Nationale la désuétude dans laquelle sont tombées les manufactures nationales comme les Gobelins luttant désespérément « contre la peinture à l’huile. » p. 56 Monnier.
La IIe République est un tournant iconographique : les sujets réalistes sociaux se multiplient après 1848 parallèlement à l’émergence de la « question sociale ».
Un concours est organisé en 1848 pour créer « la figure symbolique de la République française » -> vers une iconographie nouvelle (?) Le gvt lance un « appel aux artistes » pour la composition d’une « figure symbolique de la République française ». Il s’agit donc d’une commande publique (de même que pour la sculpture et les médailles commémoratives de 1848)
-> Comment représenter la République (donc le pouvoir démocratique) ?
République = abstraite, impersonnelle, collègiale -> comment l’incarner ? Il s’agit aussi de la substituer à l’image du roi.
Dès 1792 l’abbé Grégoire avait donné sa vision de cette allégorie qu’il réclame à la Convention en le justifiant comme cela : « Afin que ces emblèmes circulant sur le globe présentassent à tous les peuples, les images chéries de la liberté et de la fierté républicaine ».
A quoi cette figure doit-elle ressembler ?
« Sous les traits d’une femme vêtue à l’antique, debout, tenant de la main droite une pique surmontée du bonnet phrygien ou bonnet de la liberté, la gauche appuyée sur un faisceau d’armes ; à ses pieds un gouvernail avec pour légende ces mots : Archives de la Révolution française » (décret du 21 septembre 1792).
La Liberté de Delacroix acquise par l’Etat est exposée au Louvre, les arbres de la liberté, le drapeau tricolore (et non pas rouge) montrent la volonté du régime de diffuser les symboles. La liberté du salon est proclamée mais il manque une image à destination du peuple explicative et rassurante (il n’y aura pas de Terreur)
Joseph Garraud directeur des beaux Arts écrit à Ledru – Rolin :
« Il semble plus convenable, si le gvt de décide à placer un dessin emblématique en tête de ses actes, de mettre ce projet au concours ou de charger du travail un artiste qui a fait ses preuves, la question d’art devant toujours être soigneusement sauvegardée dans la composition de ces images destinées, comme les monnaies, à être reproduites à l’infini et à figurer chaque jour sous les yeux du peuple. »
450 peintures, 173 sculptures, 31 projets de médailles et 41 dessins pour le médaillon emblématique participent au concours.
20 esquisses sont retenues pour passer commande de grands tableaux.
Les artistes sont-ils libres ? Ils puisent dans le répertoire greco-romain, mais Ledru Rolin ministre de l’Intérieur chargé des Beaux Arts rappelle l’esprit que doit exprimer la République fraternelle de 1848 :
« Je réponds en deux mois a votre demande, bien entendu que je parle en homme d’Etat. Sachez qu’en cette occasion, plus qu jamais, c’est la tête et le cœur de l’artiste qui doivent diriger la main de l’artiste ou du statuaire, l’art n’étant que le langage universel qui traduira votre pensée. Votre composition doit réunir en une seule personne la Liberté, l’Égalilé, la Fraternité. Cette trinité est le caractère principal du sujet. Il faut donc que les signes des trois puissances se montrent dans votre œuvre. Votre République doit être assise pour faire connaître l’idée de stabilité dans l’idée du spectateur. Si vous étiez peintre, je vous dirais non pas de l’habiller en tricolore, si l’art s’y oppose, mais cependant de faire dominer les couleurs nationales dans l’ensemble du tableau. J’allais oublier le bonnet. J’ai dit plus haut que la République réunit les trois puissances qui forment son symbole. Vous n’êtes donc pas maître d’ôter ce signe de la liberté. Seulement arrangez-vous pour en quelque sorte le transfigurer. Mais je vous dis encore une fois : vous ne pouvez pas faire disparaître ce que le peuple s’attend à retrouver dans la personnification du gouvernement qu’il a choisi. Gardez-vous aussi des airs trop belliqueux. Songez à la force morale avant tout. La République est trop forte pour avoir besoin de lui mettre le casque en tête et la pique à la main. »
Ledru-Rollin, journal des débats, 2 mai 1848.
La comparaison des quelques exemples montre la diversité des choix des artistes qui reflètent aussi des choix politiques : quelle vision de la République ? Mise en scène de la « Trinité républicaine » comme on voit en grisaille sous la Marianne de Sébastien Melchior Cornu.
Celle de Cambon est une allégorie antique triomphante, classique, nombreux attributs : mains, constitution, arc en ciel, ruche, force, drapeau tricolore.
La République de Cornu proclame la souveraineté du peuple, sur son trône est inscrite la devise de la république, dominante rouge, épée, palme du vainqueur, dominante rouge -> couleur du combat pour la liberté république combattante, en mouvement. En dessous : deux citoyens tendent leurs bras vers le bonnet de la liberté, unissent leurs mains au- dessous de la balance de la justice, (égalité), enfin ils serrent les mains dans un geste de fraternité.
Ziegler : sage, sereine, lion à ses pieds, le rouge est discret (ceinture), attribut de justice et de l’abondance, telle Cérès, très sage et végétale, disons « centriste ». (campagnes).
Daumier : drapeau tricolore, une des premières œuvres peintes de Daumier célèbre caricaturiste, comme une Charité, seins lourds, femme forte.
Double patte d’oie inscrite dans un cercle appartient au vocabulaire compagnonnique. Elle nourrit, elle abrite, elle protège, elle instruit ses enfants, Daumier choisit un seul emblème mais il met l’accent sur l’éducation. (classé 11e).
Le concours est un échec, en octobre le souvenir des journées de juin est encore frais, la République est moins triomphante, elle est divisée, en plus la direction des Beaux arts est critiquée, les artistes aspirent à plus de liberté, le vocabulaire pictural est moqué, alors qu’on attendait un renouvellement de l’iconographie. Le critique
Jules Champfleury (critique d’art défenseur du réalisme) souligne la nécessaire indépendance de l’artiste :
« On traite d’égoïstes les artistes qui ont la force de ne pas s’occuper de politique. Quel égoïsme que celui de ces hommes qui, pour quelques renommées, se consument d’efforts, subissent mille privations, et enseignent à regarder ceux qui ne savent pas voir. L’art ou la politique et non l’art et la politique. Entraîné dans la politique l’artiste ne s’appartient plus. »
Seule la République de Daumier est considérée aujourd’hui comme un chef d’œuvre. (musée d’Orsay).
En 1849, le ministère de l’Intérieur achète le tableau manifeste de Courbet, Une après-dînée à Ornans.
3. Second Empire (1852-1870)
Napoléon III, un amateur d’art…pour des raisons politiques (?) Il associe les Beaux arts et le progrès industriel dans les expositions de 1855 et 1867, Il passe des commandes personnelles (liste civile) et publiques pour soutenir les artistes français : statuaire et tableaux pour églises et bâtiments publics, portraits officiels ou privés, arts décoratifs comme cette commande chez Christofle pour la pièce centrale du surtout de cent couverts : « La France distribuant des couronnes de gloire » : 1852-1858.
Napoléon III favorise l’enrichissement extraordinaire des collections du Louvre, crée le musée des Antiquités nationales de Saint Germain-en-Laye (1867). Mais surtout, c’est sa politique dans l’architecture et l’urbanisme qui a marqué la période : Opéra, Bibliothèque Nationale, rénovation de plusieurs monuments.
Le régime et les artistes :
JB Carpaux est le professeur de dessin du prince héritier , il produite de nombreux portraits de la famille impériale, dont le portrait le plus diffusé :
Le prince impérial et son chien Néro.
Le fils unique de l’empereur Napoléon III et de l’impératrice Eugénie de Montijo est représenté en compagnie du chien de l’Empereur. Le sculpteur Jean-Baptiste Carpeaux connaît bien le jeune prince, âgé de huit ans, à qui il donne des cours de dessin. Il le fait poser en alternance avec un autre garçon sur lequel le sculpteur étudie le costume. Il donne de l’héritier de l’Empire l’image naturelle d’un enfant de la bonne société de son époque, mais sans attribut impérial ni costume officiel.
Il illustre ainsi l’importance nouvelle accordée à l’enfant au sein de la famille. Le portrait du prince impérial rencontre beaucoup de succès. Il est reproduit en différentes tailles, en bronze, en plâtre, en terre cuite et en biscuit.
Même après la chute de l’Empire et la fin tragique du prince impérial, tué par les Zoulous en 1879 en Afrique du Sud, la Manufacture de Sèvres continue à vendre son portrait sous le titre L’enfant au chien.
Carpaux travaille aussi au Louvre, à l’Opéra Garnier pour lequel il sculpte la Danse en 1869, il fait scandale. C’est une onde de femmes nues tournoyant autour du génie de la danse (qu »on pourrait aussi prendre pour le démon)..
Carpeaux présente une première esquisse à Garnier, en 1865. Elle représentait « Un homme tout nu et tout droit, qui avait l’air de s’appuyer sur une massue, une femme toute nue et toute droite, qui était aussi tranquille de mouvement que l’homme; une espèce de grosse colonne, qui ressemblait à un cippe funéraire, puis au-dessus, les pieds engagés dans la muraille, le corps en avant, les ailes flottant en panache, une sorte de démon, la main contre la bouche, la tête contre celles des autres personnages et qui semblait leur dire un secret à l’oreille. Cette esquisse était étonnante de modèle, mais elle était inacceptable ».
Garnier refuse le projet. Le sculpteur et l’architecte s’accordent sur une composition, après plusieurs ébauches, en 1866. La sculpture est remise au moulage deux ans plus tard. Le plâtre est confié à plusieurs sculpteurs qui doivent le réaliser en pierre d’Echaillon. Le budget initial sera largement dépassé et Carpeaux doit en financer une partie. Les groupes sculptés de la façade seront dévoilés successivement. « La Musique Instrumentale » de Guillaume, puis « L’Harmonie » de François Jouffroy précèdent la présentation de « La Danse » de Carpeaux et « Le Drame Lyrique » de Perraud qui seront présentés le dimanche 25 juillet 1869.
Le groupe de « La Danse », très différent des trois autres sculptures beaucoup plus académiques, est vivement critiqué. Les journalistes suggèrent qu’il faudrait soit enlever les trois groupes inertes, soit retirer La Danse.
Une bouteille d’encre est lancée sur l’oeuvre sculptée dans la nuit du 26 au 27 août. Elle se brise sur la hanche de la bacchante et le liquide macule les personnages qui l’entourent. Le scandale a un grand retentissement. Des articles paraîtront dans la presse pour témoigner de leur indignation pendant presque un an. Des chimistes mettront au point une solution capable de faire disparaître l’outrage. La tache d’encre sera enlevée le 1er septembre. Le groupe fera l’objet de nombreuses menaces d’enlèvement. L’Empereur Napoléon III est sollicité pour remplacer l’oeuvre décriée. Le projet tombera dans l’oubli du fait de la guerre. Certains photographes, qui feront commerce de la reproduction l’oeuvre souillée, seront poursuivis par Carpeaux au titre du « droit moral de l’auteur ». Le groupe original, menacé par la pollution, est aujourd’hui exposé au Musée d’Orsay. Il a été remplacé par une copie réalisée par Paul Belmondo en 1963. C’est le premier tableau réaliste entré dans les collections publiques, il sera envoyé au Musée de Lille.
La résistance d’un artiste « engagé », Gustave Courbet.
Courbet doit être situé dans un contexte de contestation politique républicaine mais aussi dans le régionalisme comtois vis à vis de l’État français jacobin La Franche Comté avait été annexée par Louis XIV en 1678. Proudhon qui était un ami admiré par Courbet, exaltait aussi l’organisation de la vie locale de façon autonome face à l’État oppresseur.
Le tableau Le Chêne de Flagey appelé chêne de Vercingetorix, camp de césar près d’Alésia Franche – Comté semble revendiquer pour sa région la paternité d’Alésia (bataille d’archéologues entre Bourgogne et Franche Comté, Napoléo III a tranché pour la Franche Comté). Les idées anarchistes et socialistes poussent d’ailleurs Courbet à revendiquer un Salon indépendant « autogéré » par les artistes eux mêmes.

Le Chêne de Flagey, appelé Chêne de Vercingétorix 1864, 89×110 cm., Murauchi Art Museum, T?ky?.
Quelques oeuvres commentées sur Histoire par l’image dont le 2e manifeste politique et esthétique de Courbet, L’Atelier.(1855) qu’il exposera dans l’Exposition personnelle de ses oeuvres l’année e l’Exposition universelle de Paris pour laquelle aucune de ses oeuvres n’a été choisie.

Gutave Courbet, L’Atelier, 1855, 361 x 598 cm, Huile sur toile, Musée d’Orsay
4. La République et les Arts depuis 1875 à nos jours
La IIIe République : 1871-1940.
Après avoir affirmé le rôle éducatif et politique des arts, la République (au-delà de la parenthèse de Vichy : pillage allemand des oeuvres, contrôle accru, vision « patrimoniale ») doit régler la question de la place de la modernité dans la politique publique des arts. Entre recul de l’interventionnisme et soutien public à la création, l’Etat doit composer aussi avec la commande locale et surtout l’émergence d’un véritable marché privé de l’art.
L’institution du musée est confortée à Paris et en province. Le Louvre devient musée national, il bénéficie de l’attention publique (et ce depuis le Seconde Empire : enrichissement des collections en particulier grâce aux legs et aux donations (collectionneurs, familles d’artistes -> L’enterrement à Ornans est p. ex legué par Juliette Courbet en 1887, rénovation des salles d’exposition, agrandissement mais surtout habilitations offertes aux peintres d’accéder aux salles et de copier les tableaux des grands maîtres voir Lettre d’Emile Zola à Paul Cézanne. (cité par Gérard Monnier dans L’art et ses institutions en France, folio Histoire1995)
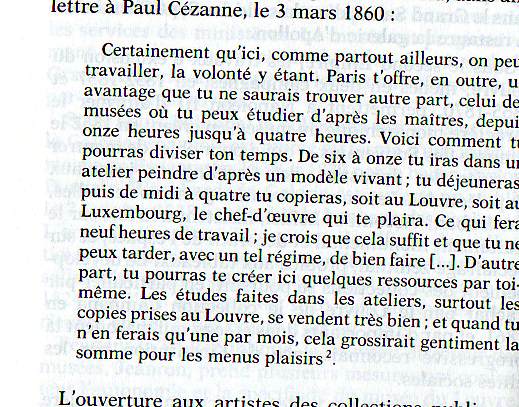
Cette ouverture des collections bouleverse le travail artistique proprement dit car les artistes peuvent maintenant s’émanciper des mécènes et même de l’Etat en se confrontant uniquement aux maitres, l’art devient ainsi une affaire d’artistes : Courbet, Manet, Matisse ont largement pratiqué la copie et le dessin in situ.
Charles Blanc directeur des Beaux Arts en 1873 revient avec son idée de Musée des copies (texte p.65).
La République donne d’abord des gages aux Beaux Arts et à l’Institut. (se démarque de la politique de Napoléon III).
Son successeur Philippe de Chènevières marque sa volonté de soutenir les production contemporaine (prix du Salon créé en 1874) également de relancer la grande « commande publique ». Mais la formation des jeunes artistes aux Beaux Arts est vivement critiquée par Rodin en 1905 : « Peuvent-ils faire de l’art, ces malheureux jeunes gens parqués dans les ateliers de l’École, ces infortunés et inconscients élèves qu’un maître patenté vient visiter par aventure quand lui en laissent le temps et ses travaux personnels et les nécessités d’une vie aussi agitée qu’officielle ? »
L’institution du musée est fortement développée par la IIIe République à Paris et en Province, les édifices néo-classiques se multiplient pour abriter des collections dont une bonne part est envoyée par Paris en dépôt. Cependant, le Louvre devient de plus en plus un lieu où se rencontrent amateurs d’art, des hommes de culture, mais moins un lieu de formation de jeunes artistes. Une élite intellectuelle et financière s’organise en « Société des amis du musée du Louvre » et lance des souscriptions. Des donations, des legs, des dations, des achats enrichissent les collections. Se pose bien sûr aussi la part des « artistes vivants » dans les collections publiques. Gustave Caillebotte (1848-1894) lègue à l’État sa collection de tableaux à condition que les impressionnistes (Manet, Renoir,Sisley…) soient reçus au Luxembourg avant d’aller au Louvre. Scandale ! Le peintre Gérôme s’offusque : « pour que l’État ait accepté pareilles ordures, il faut une bien grande flétrissure morale ». Il faudra attendre l’entre-deux-guerres pour voir des artistes vivants « modernes » (Modigliani, Picasso, Braque, Matisse ou Léger) exposés.
Voici l’extrait du film Gervaise de René Clément sur la visite du Louvre :
http://picasaweb.google.com/emmanuel.noussis/ArtEtPouvoir#5307101346598451042
L’extrait de l’Assomoir :
http://www.ac-nancy-metz.fr/Pres-etab/JeanLurcatBruyeres/lyceejeanlurcat/louvre/visite2.html
La commande publique -> la statuaire.
La République de Léopold Morice (1883)
http://www.insecula.com/salle/MS01355.html
La IIIe République s’inscrit dans la tradition de l’utilisation politique de l’art en utilisant les symboles : composition, gestuelle, attributs : places royales depuis le XVIIIe, les statues des grands hommes de la France, militaires mais aussi savants, écrivains, parlementaires fidèles à la couronne. L’abbé Grégoire avait revivifié cette tradition, en l’adaptant à la pensée républicaine.
Quelques éléments sur la statuaire publique.
La statue publique est un symbole : on l’abat en cas de changement de régime (jusqu’au tsar dans octobre, Lénine dans Goodbye Lénine de Wolfgang Becker (2003) aux dictateurs du XXe siècle, Sadam Hussein)
La révolution avait abattu les bronzes royaux et la restauration les avait reconstitué
La première statue du Roi-Soleil Place des Victoires avait été déboulonnée le 10 août 1792. Sept monuments, inspirés de l’art égyptien, devaient combler le vide. La statue du général Desaix, représenté dans la tenue d’Adam, sera installée en 1810, puis retirée pour cause d’atteinte à la pudeur.
Louis XVIII passera commande d’une nouvelle statue équestre de Louis XIV au sculpteur François-Joseph Bosio et à l’architecte Alavoine. Cette statue, inaugurée le jour de la Saint-Louis, le 25 août 1828, représentera le roi en tenue d’empereur romain, chevauchant un cheval cabré dont l’équilibre sera assuré par la queue fixée au piédestal. Le socle de marbre blanc recevra deux reliefs représentant le passage du Rhin et l’institution de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis. On peut ajouter Henri IV sur le pont Neuf en 1818…
Sous Napoléon III on assiste à l’accélération du phénomène, avec notamment un Vercingétorix par Aimé Millet en 1865. L’embellissement des villes depuis le XVIIIe a favorisé les monuments. Au XIXe la ville se développe -> boulevards, places, remparts abattus (-> contrôle du peuple avec les rues larges), la statue acquiert une fonction éducative. « didactisme civique » de Maurice Agulhon. Le citoyen qui s’est illustré, le héros natal : industriel, artiste, héros, scientifique… mérite une statue là où il est né. La République s’y reconnaît dans ses valeurs de travail, de mérite, de progrès de l’esprit. La statue du grand homme repose sur une idée pas très éloignée des galeries humanistes des grands esprits (Urbino) comme d’ailleurs des saints, parfois les villes se disputent la maternité de ces personnages comme Nantes et Amiens pour Jules Verne.
Le développement des voyages et les guides touristiques favorisent aussi la recherche d’emblèmes d’une vile.
La technique permet aussi de multiplier les œuvres surtout entre 1870 et 1914. Après 1914 se sont les monuments aux morts qui prendront le relais. Cette prolifération d’œuvres sans grand intérêt esthétique, provoque les railleries des critiques d’art et même des artistes : Auguste Rodin (1840-1917) et Aristide Maillol (1861-1944). Ces sculpteurs dont l’art est beaucoup plus « expérimental » et novateur que ne peuvent tolérer les milieux officiels. Le Balzac de Rodin, (1891-1899) est inauguré seulement en 1939 !
La symbolique de ces statues a perdu son sens avec le temps. Les Surréalistes rêvaient de les abattre
Le diaporama du cours :