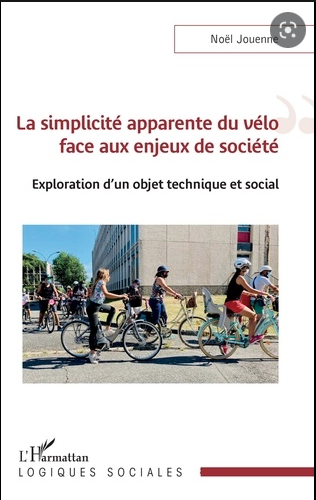
Auto-interview
– Noël Jouenne, vous venez de publier chez L’Harmattan un nouvel opus sur le vélo, pouvez-vous nous en dire plus ?
– Dans ce livre, j’ai voulu tourner une page et reprendre l’histoire du vélo, depuis la draisienne jusqu’à nos jours. C’est un travail exploratoire, c’est-à-dire que j’ouvre des pistes sans forcément les refermer. Je suis partie de la draisienne, que l’on connaît aujourd’hui sous forme d’objet destiné à l’apprentissage de l’équilibre chez les enfants pour ensuite remonter cette histoire, étant donné que nous savons où elle nous a menés. Pour ce premier chapitre, je me suis appuyé sur le travail de Keiso Kobayashi, qui est un travail pionnier et méritant. C’est le premier chercheur à avoir mené une recherche en France sur les origines du vélocipède. Son travail s’est déroulé sur une décennie et il maîtrise l’histoire du baron Carl von Drais dans ses infimes détails. Une relecture de sa recherche, combinée avec des sources disponibles sur Gallica m’a permis de proposer une nouvelle hypothèse : celle-ci concerne cette idée que la pédale a fait basculer la draisienne vers le vélo, mais une relecture attentive permet de comprendre que la selle a autant d’importance, sinon plus, que la pédale. D’ailleurs, Keizo Kobayashi m’a dit qu’il était d’accord avec cette hypothèse.
– Mais votre livre fait 260 pages, vous ne l’avez tout de même pas entièrement consacré qu’à cette question ?
– Non, bien évidemment, c’est une entrée en matière, parce qu’ensuite, je discute de l’objet technique qu’est le vélo. D’abord, il est question des avantages et des inconvénients d’une innovation aussi importante, et je montre à travers un exposé que l’innovation ne va pas de soi. Dans le langage courant, bien souvent, on parle d’innovation alors qu’il s’agit d’une invention ou d’une amélioration d’un procédé ou d’un dispositif technique. Pour qu’il y ait innovation, il faut que l’invention soit acceptée par la société. C’est ce qui est arrivé avec le vélo, mais cela a pris vingt ans à partir des vélocipèdes à pédales. En fait, les trois premiers chapitres sont destinés à cerner cette question et je reviens à la fin du troisième chapitre sur la selle et la pédale pour montrer leur égale importance. La pédale a donné lieu au verbe pédaler, ce qui n’est pas rien.
– L’organisation de vos chapitres laisse penser un certain flottement, pourquoi ce choix ?
– Comme je l’ai dit, il s’agit d’une recherche exploratoire, et je m’autorise à traiter des questions au sujet desquelles j’attends une réponse. Par exemple, cette « petite reine » que l’on attribue aujourd’hui à la reine de Hollande semble être une reconstruction, car je n’ai rien trouvé pour le prouver. Ce point est à déposer dans la boîte des contre-vérités et des falsifications de l’histoire, et elles sont nombreuses autour du vélo. Donc, j’apporte une contribution à la remise au propre d’une histoire bercée par des enjeux nationaux que l’on peut suivre depuis l’origine du vélo moderne, et même depuis la draisienne.
– Et le texte sur le vélo pliant en est un autre exemple ?
– Là c’est autre chose. Dans la continuité de mon précédent livre, dans lequel je me centrais sur l’objet, ici j’opère un décentrement : je me place à distance et j’observe. J’avais commencé à m’intéresser au vélo pliant, parce que cet objet technique particulier n’a pas de sens en soi dans les premières inventions. Dès le début, les inventeurs ont cherché à rendre pliant le vélocipède, pour permettre de l’entreposer plus facilement. La dépense d’énergie intellectuelle ne s’explique pas parce que l’on disposait de place. Alors l’idée a été de le rendre pliant pour permettre de le transporter plus facilement sur son dos. C’est ainsi que sont nées les troupes cyclistes. L’armée s’est saisie de cette particularité sans en faire un objet militaire. Mais le commun des mortels n’avait aucun usage d’un tel objet. Cependant, les brevets se sont succédé pour arriver à nos jours à des modèles performants capables de saisir l’intermodalité des déplacements.
– Vous faites un saut temporel, car vous parlez de votre dernier chapitre et de cet engouement pour le vélo, propulsé par des think tank et des influenceurs. Si l’on revient un peu en arrière, votre livre, vous le dites vous-même, tire son originalité de la conception simondonienne de l’objet technique.
– Oui, c’est le point central de ce livre. J’ai étudié Gilbert Simondon à l’époque où je m’intéressais aux calculatrices de poche. Il employait souvent le principe de la calculatrice électronique dans ses exemples, et son analyse du rapport à l’objet est très enrichissante pour comprendre le lien entre ce dernier et l’homme, à travers la société. C’est un petit chapitre comparé à d’autres, mais en dix-huit pages, il permet de cerner les concepts comme celui de l’individu technique et de prendre conscience du rôle de médiateur du vélo. C’est l’occasion pour moi de reprendre à mon compte les ouvrages critiques de Katja Ploog sur la mobilité et de Monique Sélim et Bernard Hours sur la moralisation du capitalisme, pour montrer en quoi le capitalisme s’est déplacé aujourd’hui autour du vélo, et notamment le vélo à assistance électromécanique pour conquérir des marchés prometteurs, sur fond de transition écologique.
– Ce chapitre est assez éloquent, mais vous abordez ensuite l’histoire singulière d’un champion cycliste oublié.
– Oui, c’est chez moi une sorte de constance. En travaillant sur les calculatrices, je m’étais penché sur les règles à calcul, et j’ai pu ainsi produire un texte sur le sociologue Jacques Jenny qui au tournant des années 1960 avait inventé une règle à calculer spécialisée pour le calcul des écarts à l’indépendance, et un inventeur de règles marines. Pour moi, faire sortir de l’ombre ces personnes permet de montrer qu’il existe des gens oubliés qui ont tout de même contribué à faire quelque chose. Maurice Archambaud est de ceux-là, et son histoire de coureur cycliste, champion de monde sur piste, est une pièce à ajouter au puzzle des oubliés. À son époque, il a su faire rêver, et le sacrifice qu’il a consenti durant sa carrière n’a pas été suffisamment valorisé à mon sens. Mais là aussi, c’est un travail exploratoire, et je n’ai pas cerné toute sa vie. Il reste des zones d’ombre qu’une recherche future pourra combler, faite par moi ou par d’autres.
– Vous semblez quand même avoir bien montré que l’histoire personnelle du coureur y est pour quelque chose, et le harcèlement dont il fut victime montre l’étroitesse d’esprit d’une communauté cycliste tiraillée entre les fabricants de vélo, les dirigeants des courses cyclistes et le public. Bref, dans le chapitre suivant, vous abordez la question du voyage, un peu, semble-t-il, à contrecœur ?
– Pour les anthropologues, le mot voyage résonne avec Tristes Tropiques et l’incipit de Lévi-Strauss « Je hais les voyages et les explorateurs ». Mais pour moi, après avoir parlé des courses cyclistes, et fallait bien aborder la question du voyage. Parce qu’en définitive, quand on possède un vélo et que l’on ne se rend pas à son travail avec, que reste-t-il ? Le loisir des déplacements. C’est-à-dire aller plus loin, découvrir, ce que le vélo a permis. Souvent on peut lire que le vélo a permis d’émanciper la femme, certes, mais il a aussi permis d’émanciper l’homme. Et comme je voulais m’intéresser aussi aux pratiques féminines, j’ai abordé la question du voyage avec des femmes hors du commun. Je n’en dirai pas plus.
– Pouvez-vous maintenant parler du chapitre huit qui n’apparaît pas dans le mémoire de votre soutenance d’habilitation à diriger des recherches ?
– J’avais ce texte sous la main, car j’avais traité de la question de l’objet technique comme médiateur au sens où dans la sphère publique, le vélo est plus visible que des gens qui manifestent. C’est pour cette raison que des groupes se forment pour constituer une masse critique qui est un état d’équilibre juste avant l’explosion nucléaire. Voyez la métaphore. Et puis j’étais tombé sur un article d’un confrère économiste qui prétendait que la manifestation parisienne de 1971 était la première au monde. C’était un peu présomptueux de dire cela parce que je savais que d’autres manifestations avaient eu lieu bien plus tôt, au démarrage même des pratiques cyclistes. Alors j’ai remonté le fil de cette histoire et j’ai cherché des exemples de manifestations à vélo. Cela m’a permis de voir que très rapidement, les bourgeois et les aristocrates qui pouvaient se permettre d’acquérir une bicyclette, sont montés au créneau lorsqu’il a fallu payer une taxe, etc. On pourrait dire que de tout temps le vélo a été un médiateur dans la sphère publique parce qu’il permet d’être vu, parce qu’il donne à la manifestation un caractère positif et non belliqueux, et qu’en son sein, on trouve toujours des gens influents et politiquement proches du pouvoir.
– Enfin, nous arrivons au dernier chapitre, assez long, qui traite de l’accélération des pratiques dans un contexte de pandémie. Quels sont les points essentiels à retenir ?
– J’ai effectué cette recherche durant la pandémie du Covid-19 lors d’un congé pour études et recherches. Je ne pouvais pas ne pas parler de ce qu’il se passait alors. Et le vélo a été vraiment au centre des attentions du moment. Par exemple, je montre comment les réseaux d’influences ont permis de libérer du port du masque les cyclistes. Je montre aussi comment les services de l’État ont récupéré la notion d’urbanisme tactique pour, c’est une hypothèse, essouffler les mouvements activistes comme Vélorution et masse critique. Et je reviens sur cette injonction à la mobilité et à ce rapport au vélo comme objet devant sauver le monde, alors que la planète s’effondre.
– À vous entendre, on pourrait penser que le vélo est une mauvaise chose, un mauvais atout pour la planète ?
– En fait, dans son rapport à la médiation entre l’homme et le monde, le vélo n’est qu’un intermédiaire. Il n’est ni bon ni mauvais, c’est l’usage que l’on en fait qui est bon ou mauvais. Globalement, je suis plutôt satisfait de voir que le vélo regagne des points de participation à la course vers la transition écologique. Mais il faut envisager cette question de manière globale et si vous permettez d’un côté aux possesseurs de grosses voitures de continuer à polluer avec des moteurs surpuissants, vous ne pouvez pas demander des efforts continuels aux classes dominées en les obligeant à se rendre à leur travail à vélo au motif que la planète s’effondre. Il faut rétablir une harmonie collective à travers un équilibre entre les rapports de domination sans quoi ces efforts seront vains.
=> Noël Jouenne, La simplicité apparente du vélo face aux enjeux de société, Exploration d’un objet technique cet social, Coll. Logiques sociales, Paris : L’Harmattan, 2022, 262 p.
