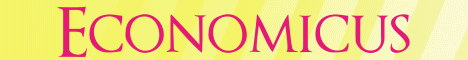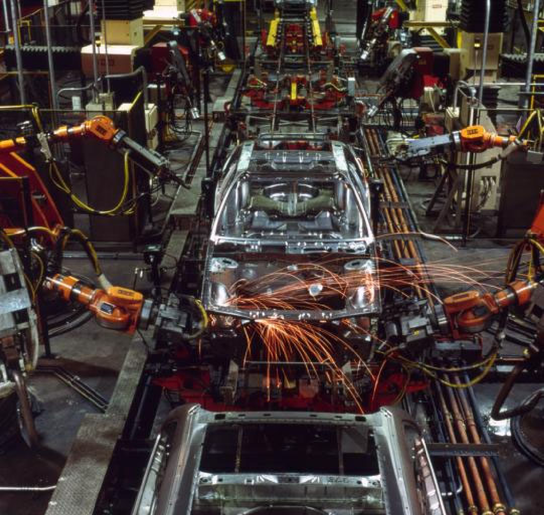La télévision peut-elle critiquer la télévision ?
Analyse d’un passage à l’antenne
En France, plusieurs émissions de télévision se proposent de décrypter les images que reçoivent les téléspectateurs. Se fondant sur l’idée que la télévision peut critiquer la télévision,elles tentent de combattre la méfiance grandissante du public à l’égard de ce média. Pierre Bourdieu,qui a, en janvier dernier, participé à la principale de ces émissions, « Arrêt sur images », livre ici son témoignage.
Par Pierre Bourdieu, avril 1996
J’ai écrit ces notes dans les jours qui ont suivi mon passage à l’émission « Arrêt sur images ». J’avais, dès ce moment-là, le sentiment que ma confiance avait été abusée, mais je n’envisageais pas de les rendre publiques, pensant qu’il y aurait eu là quelque chose de déloyal. Or voilà qu’une nouvelle émission de la même série revient à quatre reprises — quel acharnement ! — sur des extraits de mes interventions, et présente ce règlement de comptes rétrospectif comme un audacieux retour critique de l’émission sur elle-même. Beau courage en effet : on ne s’est guère inquiété, en ce cas, d’opposer des « contradicteurs » aux trois spadassins chargés de l’exécution critique des propos présentés.
La récidive a valeur d’aveu : devant une rupture aussi évidente du contrat de confiance qui devrait unir l’invitant et l’invité, je me sens libre de publier ces observations, que chacun pourra aisément vérifier en visionnant l’enregistrement des deux émissions (1). Ceux qui auraient encore pu douter, après avoir vu la première, que la télévision est un formidable instrument de domination devraient, cette fois, être convaincus : Daniel Schneidermann, producteur de l’émission, en a fait la preuve, malgré lui, en donnant à voir que la télévision est le lieu où deux présentateurs peuvent triompher sans peine de tous les critiques de l’ordre télévisuel.
« Arrêt sur images », La Cinquième, 23 janvier 1996. L’émission illustrera parfaitement ce que j’avais l’intention de démontrer : l’impossibilité de tenir à la télévision un discours cohérent et critique sur la télévision. Prévoyant que je ne pourrais pas déployer mon argumentation, je m’étais donné pour projet, comme pis-aller, de laisser les journalistes jouer leur jeu habituel (coupures, interruptions, détournements, etc.) et de dire, après un moment, qu’ils illustraient parfaitement mon propos. Il aurait fallu que j’aie la force et la présence d’esprit de le dire en conclusion (au lieu de faire des concessions polies au « dialogue », imposées par le sentiment d’avoir été trop violent et d’avoir inutilement blessé mes interlocuteurs).
Daniel Schneidermann m’avait proposé à plusieurs reprises de participer à son émission. J’avais toujours refusé. Début janvier, il réitère sa demande, avec beaucoup d’insistance, pour une émission sur le thème : « La télévision peut-elle parler des mouvements sociaux ? » J’hésite beaucoup, craignant de laisser passer une occasion de faire, à propos d’un cas exemplaire, une analyse critique de la télévision à la télévision.
Après avoir donné un accord de principe subordonné à une discussion préalable sur le dispositif, je rappelle Daniel Schneidermann, qui pose d’emblée, comme allant de soi, qu’il faut qu’il y ait un « contradicteur ». Je ne me rappelle pas bien les arguments employés, si tant est qu’il y ait eu arguments, tellement cela allait de soi pour lui. J’ai cédé par une sorte de respect de la bienséance : ne pas accepter le débat, dans n’importe quelles conditions et avec n’importe qui, c’est manquer d’esprit démocratique. Daniel Schneidermann évoque des interlocuteurs possibles, notamment un député RPR qui a pris position contre la manière dont les télévisions ont rendu compte de la grève. Ce qui suppose qu’il attend de moi que je prenne la position opposée (alors qu’il me demande une analyse — ce qui tend à montrer que, comme la plupart des journalistes, il identifie l’analyse à la critique).
Je propose alors Jean-Marie Cavada, parce qu’il est le patron de la chaîne où passera l’émission, et aussi parce qu’il m’est apparu comme typique d’une violence plus douce et moins visible : Jean-Marie Cavada donne toutes les apparences de l’équité formelle, tout en se servant de toutes les ressources de sa position pour exercer une contrainte qui oriente fortement les débats ; mes analyses vaudront ainsi a fortiori. Tout en proclamant que le fait que je mette en question le directeur de la chaîne ne le gênait en rien et que je n’avais pas à me limiter dans mes « critiques », Daniel Schneidermann exclut Jean-Marie Cavada au profit de Guillaume Durand. Il me demande de proposer des extraits d’émissions qui pourraient être présentés à l’appui de mes analyses. Je donne une première liste (comportant plusieurs références à Jean-Marie Cavada et à Guillaume Durand), ce qui m’amène, pour justifier mes choix, à livrer mes intentions.
Dans une seconde conversation, je m’aperçois que plusieurs de mes propositions d’extraits ont été remplacées par d’autres. Dans le « conducteur » final, je verrai apparaître un long « micro-trottoir » sans intérêt visant à montrer que les spectateurs peuvent dire les choses les plus opposées sur la représentation télévisuelle des grèves, donc à relativiser d’avance les « critiques » que je pourrais faire (cela sous prétexte de rappeler l’éternelle première leçon de tout enseignement sur les médias : le montage peut faire dire n’importe quoi à des images). Lors d’une nouvelle conversation, on m’apprend que Jean-Marie Cavada a finalement décidé de venir et qu’on ne peut pas lui refuser ce droit de réponse, puisqu’il est « mis en question ».
Dès la première conversation, j’avais demandé expressément que mes prises de position pendant les grèves de décembre ne soient pas mentionnées. Parce que ce n’était pas le sujet et que ce rappel ne pourrait que faire apparaître comme des critiques de parti pris les analyses que la sociologie peut proposer. Or, dès le début de l’émission, la journaliste, Pascale Clark, annonce que j’ai pris position en faveur de la grève et que je me suis montré « très critique de la représentation que les médias [en] ont donnée », alors que je n’avais rien dit, publiquement, sur ce sujet. Elle récidive avec la première question, sur les raisons pour lesquelles je ne me suis pas exprimé à la télévision pendant les grèves.
Devant ce nouveau manquement à la promesse qui m’avait été faite pour obtenir ma participation, j’hésite longuement, me demandant si je dois partir ou répondre. En fait, à travers cette intervention qui me plaçait d’emblée devant l’alternative de la soumission résignée à la manipulation ou de l’esclandre, contraire aux règles du débat « démocratique », le thème que les deux « contradicteurs » ne cesseront de rabâcher pendant toute l’émission était lancé : comment peut-il prétendre à la science objective de la représentation d’un événement à propos duquel il a pris une position partisane ?
Au cours des discussions téléphoniques, j’avais aussi fait observer que les « contradicteurs » étaient maintenant deux, et deux professionnels (il apparaîtra, dès que je ferai une brève tentative pour analyser la situation dans laquelle je me trouvais, qu’ils étaient quatre) ; j’avais exprimé le souhait qu’ils n’abusent pas de l’avantage qui leur serait ainsi donné. En fait, emportés par l’arrogance et la certitude de leur bon droit, ils n’ont pas cessé de me prendre la parole, de me couper, tout en proférant d’ostentatoires flatteries : je pense que dans cette émission où j’étais censé présenter une analyse sociologique d’un débat télévisé en tant qu’invité principal, j’ai dû avoir la parole, au plus, pendant vingt minutes, moins pour exposer des idées que pour ferrailler avec des interlocuteurs qui refusaient tous le travail d’analyse.
Daniel Schneidermann m’a appelé plusieurs fois, jusqu’au jour de l’émission, et je lui ai parlé avec la confiance la plus entière (qui est la condition tacite, au moins pour moi, de la participation à un dialogue public), livrant ainsi toutes mes intentions. Il ne m’a rien dit, à aucun moment, des intentions de mes « contradicteurs ». Lorsque je lui ai demandé s’il comptait leur montrer, au préalable, les extraits que j’avais choisis — ce qui revenait à leur dévoiler toutes mes batteries —, il m’a dit que s’ils les lui demandaient il ne pourrait pas les leur refuser… Il m’a parlé vaguement d’un micro-trottoir au sujet mal défini tourné à Marseille. Après l’émission, il me dira sa satisfaction et combien il était content qu’un « grand intellectuel » — pommade — ait pris la peine de regarder de près et de discuter la télévision, mais aussi et surtout combien il admirait mes « contradicteurs » d’avoir « joué le jeu » et d’avoir accepté courageusement la critique… Le jour de l’émission, les « contradicteurs » et les présentateurs, avant l’enregistrement, me laissent seul sur le plateau pendant près d’une heure. Guillaume Durand vient s’asseoir en face de moi et m’entreprend bille en tête sur ce qu’il croit être ma complicité avec les socialistes (il est mal informé…). Exaspéré, je lui réponds vertement. Il reste longtemps silencieux et très gêné. La présentatrice, Pascale Clark, essaie de détendre l’atmosphère. « Vous aimez la télévision ? — Je déteste. » On en reste là. Je me demande si je ne dois pas partir.
Si au moins je parvenais à croire que ce que je suis en train de faire peut avoir une quelconque utilité et que je parviendrai à convaincre que je suis venu là pour essayer de faire passer quelque chose à propos de ce nouvel instrument de manipulation… En fait, j’ai surtout l’impression d’avoir seulement réussi à me mettre dans la situation du poisson soluble (et conscient de l’être) qui se serait jeté à l’eau.
La disposition sur le plateau : les deux « contradicteurs » sont assis, en chiens de faïence (et de garde), de part et d’autre du présentateur, je suis sur le côté, face à la présentatrice. On m’apporte le « conducteur » de l’émission : quatre seulement de mes propositions ont été retenues et quatre « sujets » ont été ajoutés, dont deux très longs « micro-trottoirs » et reportages, qui passeront, tous destinés à faire apparaître la relativité de toutes les « critiques » et l’objectivité de la télévision. Les deux qui ne passeront pas, et que j’avais vus, avaient pour fin de montrer la violence des grévistes contre la télévision.
Conclusion (que j’avais écrite avant l’émission) : on ne peut pas critiquer la télévision à la télévision parce que les dispositifs de la télévision s’imposent même aux émissions de critique du petit écran. L’émission sur le traitement des grèves à la télévision a reproduit la structure même des émissions à propos des grèves à la télévision.
Ce que j’aurais voulu dire
La télévision, instrument de communication, est un instrument de censure (elle cache en montrant) soumis à une très forte censure. On aimerait s’en servir pour dire le monopole de la télévision, des instruments de diffusion (la télévision est l’instrument qui permet de parler au plus grand nombre, au-delà des limites du champ des professionnels). Mais, dans cette tentative, on peut apparaître comme se servant de la télévision, comme les « médiatiques », pour agir dans ce champ, pour y conquérir du pouvoir symbolique à la faveur de la célébrité (mal) acquise auprès des profanes, c’est-à-dire hors du champ. Il faudrait toujours vérifier qu’on va à la télévision pour (et seulement pour) tirer parti de la caractéristique spécifique de cet instrument — le fait qu’il permet de s’adresser au plus grand nombre —, donc pour dire des choses qui méritent d’être dites au plus grand nombre (par exemple qu’on ne peut rien dire à la télévision).
Faire la critique de la télévision à la télévision, c’est tenter de retourner le pouvoir symbolique de la télévision contre lui-même cela en payant de sa personne, c’est le cas de le dire : en acceptant de paraître sacrifier au narcissisme, d’être suspect de tirer des profits symboliques de cette dénonciation et de tomber dans les compromissions de ceux qui en tirent des profits symboliques, c’est-à-dire les « médiatiques ».
Le dispositif : du plus visible au plus caché
Le rôle du présentateur :
— Il impose la problématique, au nom du respect de règles formelles à géométrie variable et au nom du public, par des sommations (« C’est quoi… », « Soyons précis… », « Répondez à ma question », « Expliquez-vous… », « Vous n’avez toujours pas répondu… », « Vous ne dites toujours pas quelle réforme vous souhaitez… ») qui sont de véritables sommations à comparaître mettant l’interlocuteur sur la sellette. Pour donner de l’autorité à sa parole, il se fait porte-parole des auditeurs : « La question que tout le monde se pose », « C’est important pour les Français… » Il peut même invoquer le « service public » pour se placer du point de vue des « usagers » dans la description de la grève.
— Il distribue la parole et les signes d’importance (ton respectueux ou dédaigneux, attentionné ou impatient, titres, ordre de parole, en premier ou en dernier, etc).
— Il crée l’urgence (et s’en sert pour imposer la censure), coupe la parole, ne laisse pas parler (cela au nom des attentes supposées du public c’est-à-dire de l’idée que les auditeurs ne comprendront pas, ou, plus simplement, de son inconscient politique ou social).
— Ces interventions sont toujours différenciées : par exemple, les injonctions s’adressent toujours aux syndicalistes (« Qu’est-ce que vous proposez, vous ? ») sur un ton péremptoire, et en martelant les syllabes ; même attitude pour les coupures : « On va en parler… Merci, madame, merci… » — remerciement qui congédie, par rapport au remerciement empressé adressé à un personnage important. C’est tout le comportement global qui diffère, selon qu’il s’adresse à un « important » (M. Alain Peyrefitte) ou à un invité quelconque : posture du corps, regard, ton de la voix, mots inducteurs (« oui… oui… oui… » impatient, « ouais » sceptique, qui presse et décourage), termes dans lesquels on s’adresse à l’interlocuteur, titres, ordre de parole, temps de parole (le délégué CGT parlera en tout cinq minutes sur une heure et demie à l’émission « La Marche du siècle »).
— Le présentateur agit en maître après Dieu de son plateau (« mon émission », « mes invités » : l’interpellation brutale qu’il adresse à ceux qui contestent sa manière de mener le débat est applaudie par les gens présents sur le plateau et qui font une sorte de claque).
La composition du plateau :
— Elle résulte de tout un travail préalable d’invitation sélective (et de refus). La pire censure est l’absence ; les paroles des absents sont exclues de manière invisible. D’où le dilemme : le refus invisible (vertueux) ou le piège.
— Elle obéit à un souci d’équilibre formel (avec, par exemple, l’égalité des temps de parole dans les « face-à-face ») qui sert de masque à des inégalités réelles : dans les émissions sur la grève de décembre 1995, d’un côté un petit nombre d’acteurs perçus et présentés comme engagés, de parti pris, et de l’autre des observateurs présentés comme des arbitres, parfaitement neutres et convenables, c’est-à-dire les présumés coupables (de nuire aux usagers), qui sont sommés de s’expliquer, et les arbitres impartiaux ou les experts qui ont à juger et à expliquer. L’apparence de l’objectivité est assurée par le fait que les positions partisanes de certains participants sont déguisées (à travers le jeu avec les titres ou la mise en avant de fonctions d’expertise : par exemple, M. Alain Peyrefitte est présenté comme « écrivain » et non comme « sénateur RPR » et « président du comité éditorial du Figaro », M. Guy Sorman comme « économiste » et non comme « conseiller de M. Juppé ».)
La logique du jeu de langage :
— Le jeu joue en faveur des professionnels de la parole, de la parole autorisée.
— Le débat démocratique conçu sur le modèle du combat de catch permet de présenter un ressort d’Audimat (le « face-à-face ») comme un modèle de l’échange démocratique.
— Les affinités entre une partie des participants : les « médiatiques » sont du même monde (entre eux et avec les présentateurs). Familiers des médias et des hommes des médias, ils offrent toutes les garanties : non seulement on sait qu’ils passent bien (ce sont, comme disent les professionnels, de « bons clients »), mais on sait surtout qu’ils seront sans surprises. La censure la plus réussie consiste à mettre à des places où l’on parle des gens qui n’ont à dire que ce que l’on attend qu’ils disent ou, mieux, qui n’ont rien à dire. Les titres qui leur sont donnés contribuent à donner autorité à leur parole.
Les différents participants ne sont pas égaux devant ces situations : d’un côté des professionnels de la parole, dotés de l’aptitude à manipuler le langage soutenu qui convient ; de l’autre des gens moins armés et peu habitués aux situations de prise de parole publique (les syndicalistes et, a fortiori, les travailleurs interrogés, qui, devant la caméra, bafouillent, parlent avec précipitation, s’emmêlent ou, pour échapper au trac, font les marioles, alors que, quelques minutes avant, en situation normale, ils pouvaient dire des choses justes et fortes). Pour assurer l’égalité, il faudrait favoriser les défavorisés (les aider du geste et du regard, leur laisser le temps, etc.), alors que tout est fait pour favoriser les favorisés.
— L’inconscient des présentateurs, leurs habitudes professionnelles. Par exemple, leur soumission culturelle d’intermédiaires culturels demi-savants ou autodidactes, enclins à reconnaître les signes académiques, convenus, de reconnaissance. Ils sont le dispositif (c’est-à-dire l’Audimat) fait hommes : lorsqu’ils coupent des propos qu’ils craignent trop difficiles, ils sont sans doute de bonne foi, sincères. Ils sont les relais parfaits de la structure, et, s’ils ne l’étaient pas, ils seraient virés.
Dans leur vision de la grève et des grévistes, ils engagent leur inconscient de privilégiés : des uns, ils attendent des justifications ou des craintes (« Dites vos craintes », « De quoi vous plaignez-vous ? »), des autres des explications ou des jugements (« Qu’en pensez-vous ? »).
Pierre Bourdieu
Sociologue, professeur au Collège de France.
(1) « Arrêt sur images », La Cinquième, 23 janvier 1996 et 13 mars 1996.