NEW YORK, LONDRES CORRESPONDANTS – A Wall Street comme dans la City, il ne faut jamais juger les gens sur leur mine. Avec ses lunettes cerclées de métal, sa barbe couleur sel, son crâne dégarni et son négligé vestimentaire assorti d’une pointe de fantaisie, Jon Corzine, 64 ans, a une allure de « prof » d’université. Il ne lui manque que l’amidon et l’invisible distance qui vous transforme en cancre. Pourtant, comme l’indique l’expert de la haute finance américaine, William Cohan, à propos du patron déchu de la firme de courtage new-yorkaise MF Global, en dépôt de bilan depuis le 31 octobre, « sous ses dehors relax, Jon Corzine est le prototype du financier hyper-ambitieux à 100 000 volts ».
En effet, le comportement du PDG de la firme, responsable du plus gros accident à Wall Street depuis la faillite de Lehman Brothers en 2008 (Le Monde du 2 novembre), n’a rien à envier à celui des pires spéculateurs des récentes années folles de la bulle subprime. Qu’on en juge : lorsqu’il prend la tête de MF Global, en mars 2010, l’action du fonds vaut 7 dollars. Moins de deux ans plus tard, elle a dégringolé à 1,20 dollar. Pour autant, foin du respect de la rémunération à la performance, le patron s’est octroyé sans lésiner d’exceptionnelles primes. Mieux, pendant qu’il a fait prendre à sa firme d’investissement les plus hauts risques, et finit, dans la panique, par utiliser les montants déposés par ses investisseurs pourcouvrir ses pertes – un délit dont la logique s’apparente aux fameuses « fraudes pyramidales » -, Jon Corzine n’a jamais oublié de protéger ses intérêts personnels. Ainsi, en cas de départ de la société, quel qu’en soit le motif et quelle qu’eût été sa performance, il aurait contractuellement reçu en espèces le montant avant terme de ses stocks options (11 millions de dollars – 8 millions d’euros) auquel s’ajoutait un parachute doré de 12,1 millions.
Son histoire est banale outre-Atlantique, celle d’un petit gars de Willey Station, hameau de l’Illinois, fils d’un d’ouvrier agricole et d’une institutrice, qui a su que seuls l’éducation et le travail le sortiraient de son milieu où la majorité des gens travaillaient aux champs. Après des études d’économie et de commerce, celui qui a fait son service militaire dans le corps des Marines, mais sans servir au Vietnam, est recruté par la Continental Illinois. Il y apprend les arcanes du marché des bons du Trésor américain. En raison des gros volumes en jeu, sur le marché obligataire, seul compte le résultat, pas le temps passé à la tâche.
Cette expertise vaut à ce grand bûcheur d’être recruté par Goldman Sachs (GS) en 1975. A l’époque, l’enseigne prestigieuse est une banque d’affaires moyenne organisée en partenariat. Quatre ans plus tard, Jon Corzine dirige le département obligataire en plein essor et devient associé. Il n’a que 33 ans. Au 85, Broad Street à New York, le Rastignac mène une carrière météorique à l’ombre de son mentor, Robert Rubin, qui copréside la firme. Là, il se lie d’amitié avec une autre étoile montante, Christopher Flowers, un as des fusions-acquisitions dont il se fait un allié. En 1994, deux ans après le départ de Robert Rubin comme secrétaire au Trésor de Bill Clinton, Jon Corzine devient codirecteur général aux côtés d’un banquier d’affaires lui aussi originaire du Middle West, Henry Paulson.
L’inimitié entre les deux hommes est légendaire. Surtout, s’il soutient la mise en Bourse de GS, le duo se déchire sur tout le reste. En particulier, Henry Paulson bloque les tentatives répétées de Jon Corzine, pris par la course au gigantisme, deracheter un concurrent. Avec une habilité redoutable, Henry Paulson se débarrasse peu à peu de tous les membres du clan rival. A commencer par Christopher Flowers qui, tombé en disgrâce, claque la porte pour fonder sa propre firme de capital-investissement, JC Flowers & Co. Progressivement isolé, mégalomane, n’écoutant plus personne, Jon Corzine est « débarqué » par Henry Paulson de la direction de GS en 1999.
Meurtri, l’homme se tourne alors vers l’une des carrières qui, aux Etats-Unis, nécessite le plus de moyens financiers : la politique. Par chance, il a accumulé, durant ses années Goldman et pour salaire de son retrait, une fortune estimée à 400 millions de dollars. De quoi se montrer persuasif auprès des instances de son parti – Jon Corzine s’affiche démocrate – et plus encore auprès des électeurs. En 2000, l’ex-patron de GS remporte l’un des deux sièges de sénateur du New Jersey. Il a dépensé 62 millions de dollars de sa fortune personnelle, ce qui en fait, à ce jour, la campagne la plus chère de l’histoire du Sénat. Le sénateur Corzine sera actif sur des projets de loi touchant aux aides aux étudiants et à l’extension de la couverture-santé et votera, en 2002, contre l’entrée en guerre des Etats-Unis en Irak. Mais l’activité de législateur n’est pas la tasse de thé de cet homme d’action. Avant même la fin de son mandat, il l’abandonne pour se lancer dans la course à la fonction de gouverneur du même Etat.
C’est là, en 2005, qu’il obtient son plus grand succès politique, écrasant son adversaire républicain par 10 points d’écart. Gouverneur, il est de nouveau en contact direct et opérationnel avec les financiers. Ayant dans sa poche aussi bien les milieux d’affaires que les syndicats, il se bâtit une forteresse qui semble inexpugnable. De cette époque date sa notoriété : Jon Corzine n’hésite pas à « arroser » pour se faire élire et acheter des affidés. Las… Ses volumineux moyens ne lui seront d’aucun secours pour se faire réélire, en 2009. Il l’expliquera d’ailleurs lui-même, après sa défaite : auparavant, « être un ancien patron de Goldman Sachs était un énorme plus dans un parcours. Maintenant, les gens ont vu les excès de la finance. Leur attitude est très différente ». De fait, son adversaire républicain a battu le rappel des troupes avec un slogan dévastateur : « Corzine a géré le New Jersey de façon aussi catastrophique que ses amis banquiers à Wall Street. » Impact assuré, tant Goldman Sachs symbolise alors la rapacité des « banquiers-voleurs ».
Après sa défaite, son ami Chris Flowers vient le chercher pour lui confier les commandes de MF Global. Christopher Flowers, qui a pris 10 % dans cette charge de courtage, est mécontent du rendement de son investissement. La firme s’est limitée aux opérations de courtage au profit de ses clients et à la gestion des avoirs en cash de ses investisseurs. Parachuté PDG, Jon Corzine n’a qu’une ambition,créer un mini Goldman Sachs en transformant la société languissante en un supermarché de la finance agissant pour son compte propre. La première année, l’action s’apprécie de 26 % contre 17 % pour l’indice S & P500. Au coeur de sa stratégie gagnante, le pari sur la hausse de la dette souveraine des pays en crise de la zone euro, dont Jon Corzine s’occupe personnellement. Sûr de son flair et de son expertise, il décide seul, sans en référer à ses contrôleurs de risques ou ses analystes. Mais à l’été 2011, la crise souveraine européenne s’aggrave et les pertes s’accumulent.
Aujourd’hui, J C Flowers & Co aurait perdu 48 millions de dollars dans la faillite de MF Global. Pour GS également, la chute de son ancien dirigeant tombe au plus mal. Après les accusations portées par le procureur de New York et la SEC (Securities and Exchange Commission, la tutelle des marchés américains) contre Rajat Gupta, un ex-administrateur de GS soupçonné par la justice de délits d’initié d’envergure, c’est la seconde fois en une semaine que son nom, par ricochet, est traîné dans la boue.
En 2007, Jon Corzine avait été la victime d’un grave accident de voiture alors qu’il était conduit par un chauffeur de l’Etat du New Jersey à 150 km/h sur une autoroute où la vitesse est limitée à 105. Fait aggravant, le gouverneur voyageait sans ceinture de sécurité. Il lui en coûtera des fractures du fémur, de onze côtes, du sternum et d’une vertèbre. Plus une chirurgie plastique faciale. Quand on lui demanda pourquoi le chauffeur n’avait pas exigé de son passager qu’il utilise sa ceinture de sécurité, un collaborateur de Jon Corzine indiqua que celui-ci était « peu ouvert à ce genre de suggestions ». Le jour de sa sortie de l’hôpital, le véhicule qui le transportait fut de nouveau surpris en dépassement de vitesse. Visiblement, le banquier aventurier a toujours été un adepte du défi-frisson.
Sylvain Cypel et Marc Roche
Le Monde
Article paru dans l’édition du 03.11.11
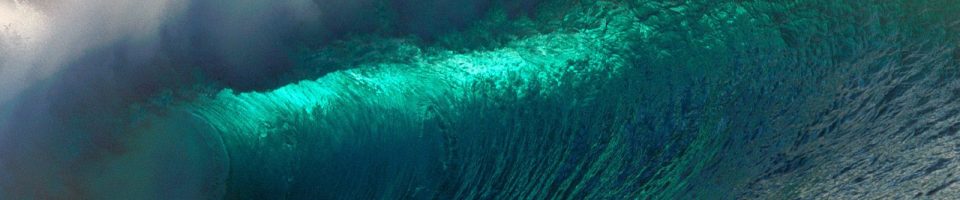
 . Il y en a d’autres qui disent qu’il y a une politique de relance de l’économie réelle, avec des plans de relance conjoncturelle ».
. Il y en a d’autres qui disent qu’il y a une politique de relance de l’économie réelle, avec des plans de relance conjoncturelle ».