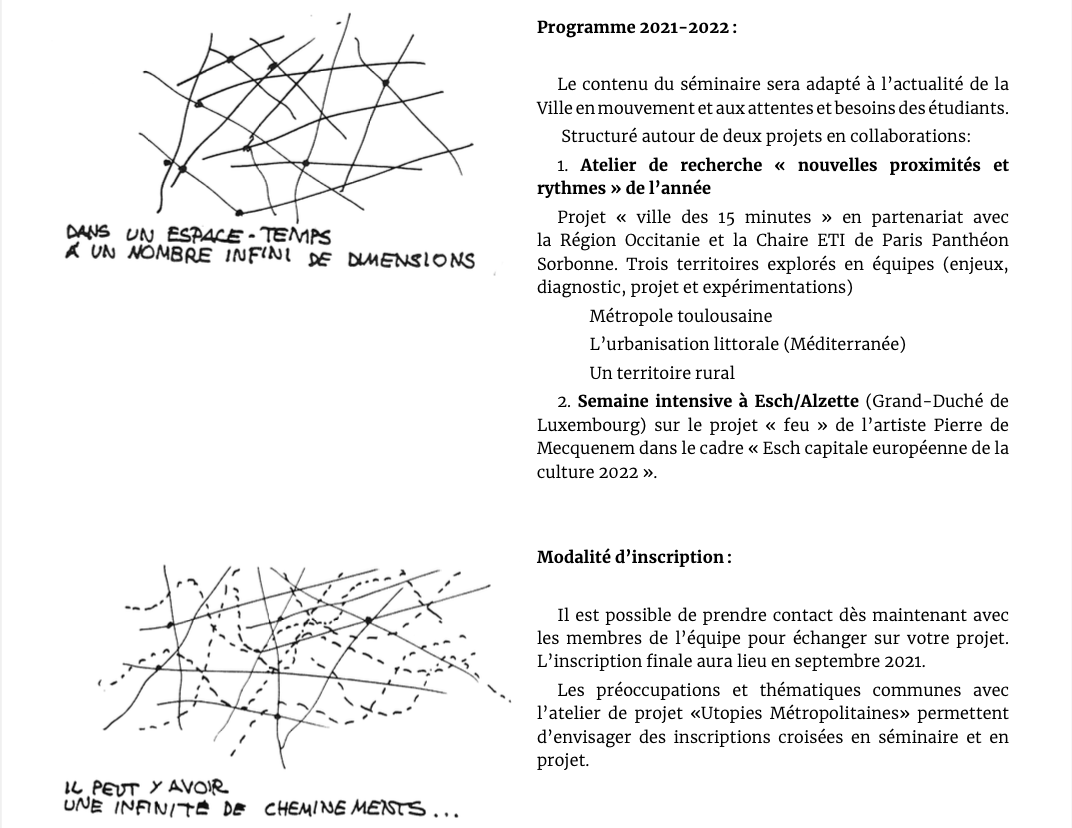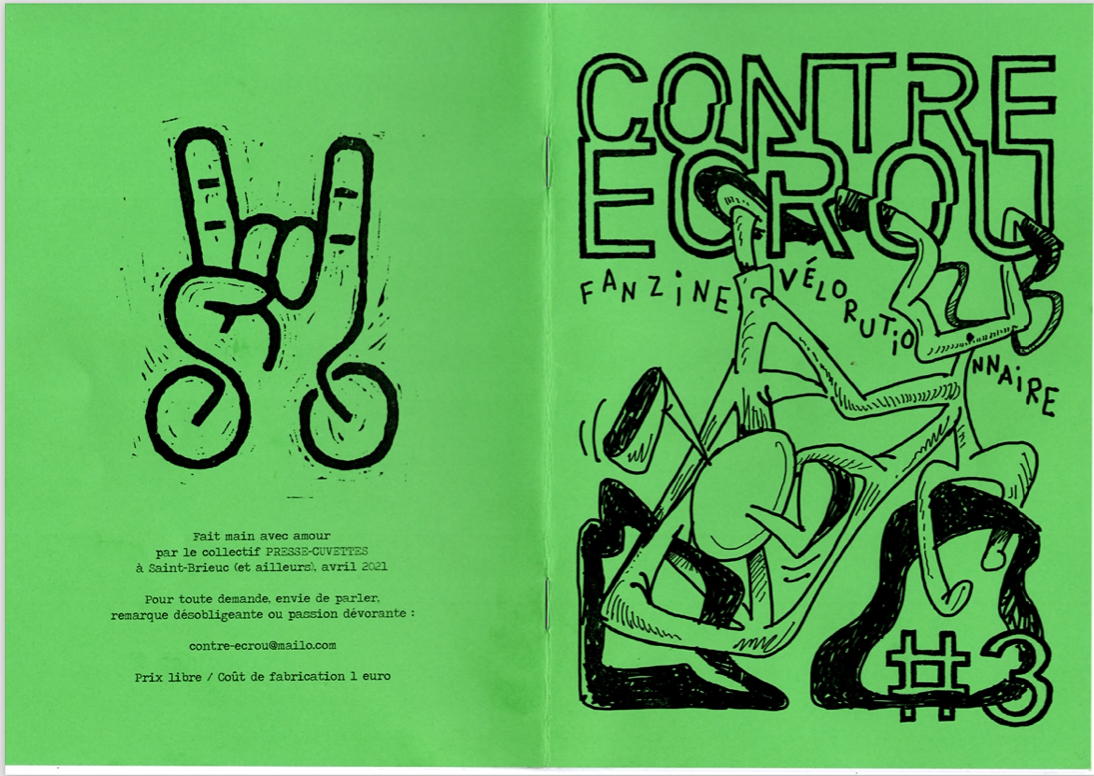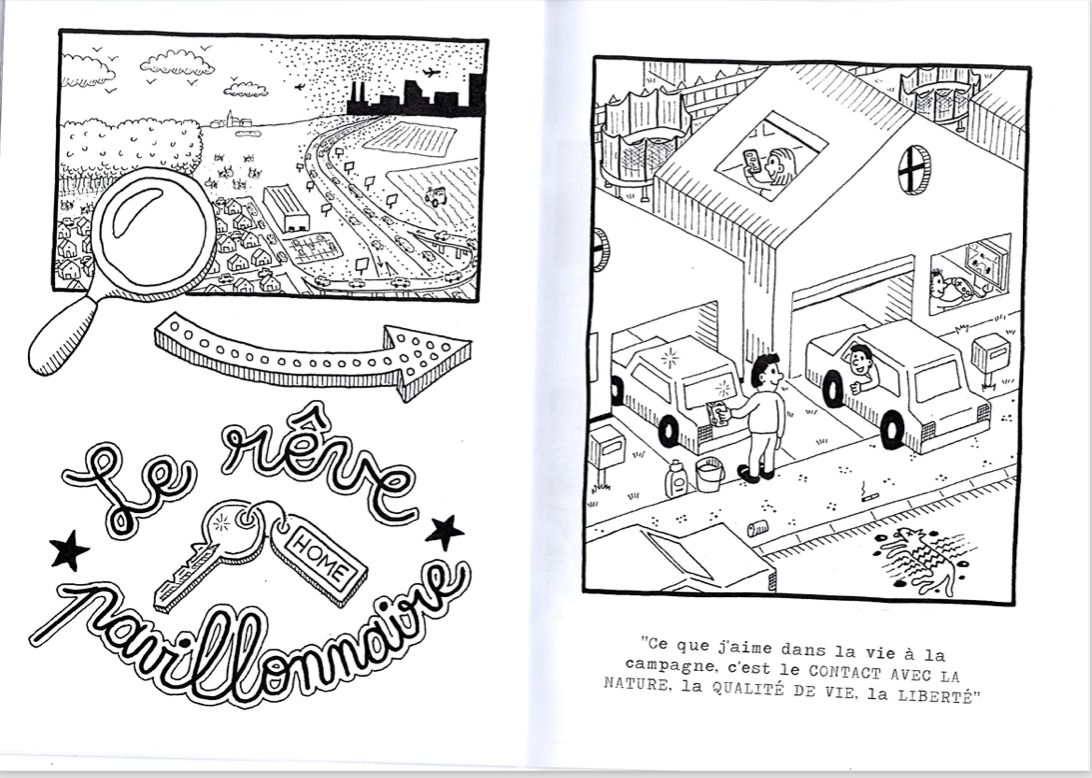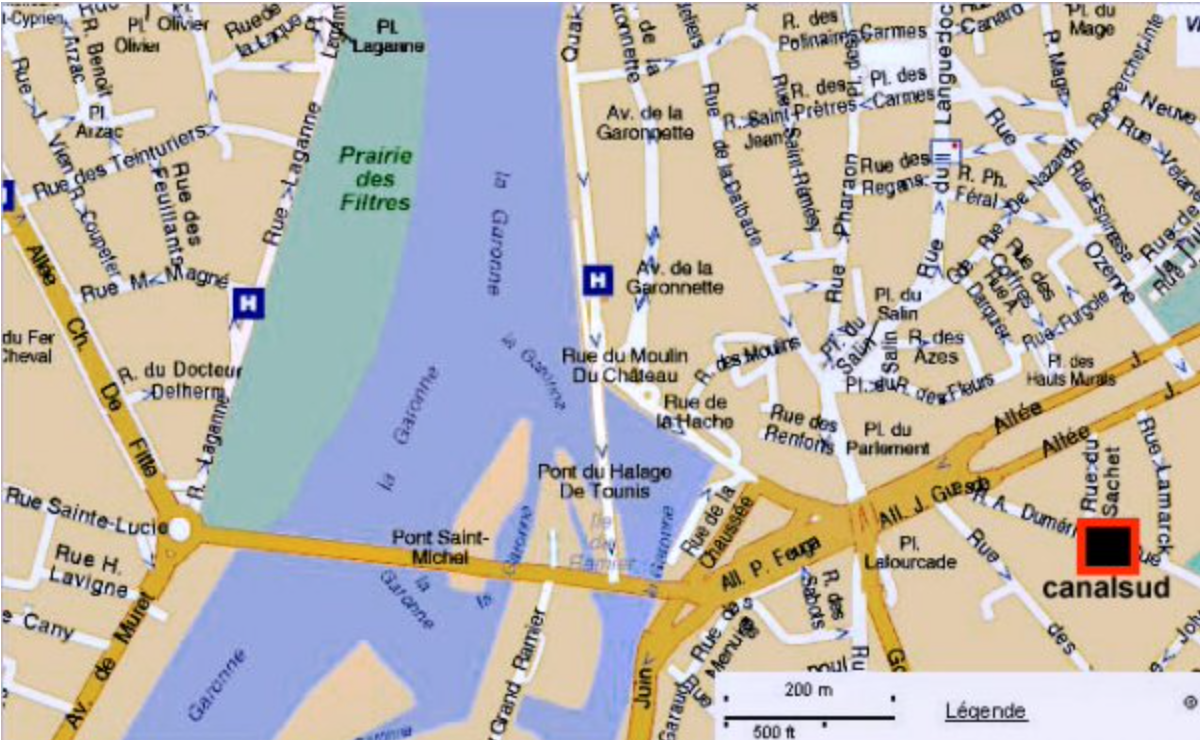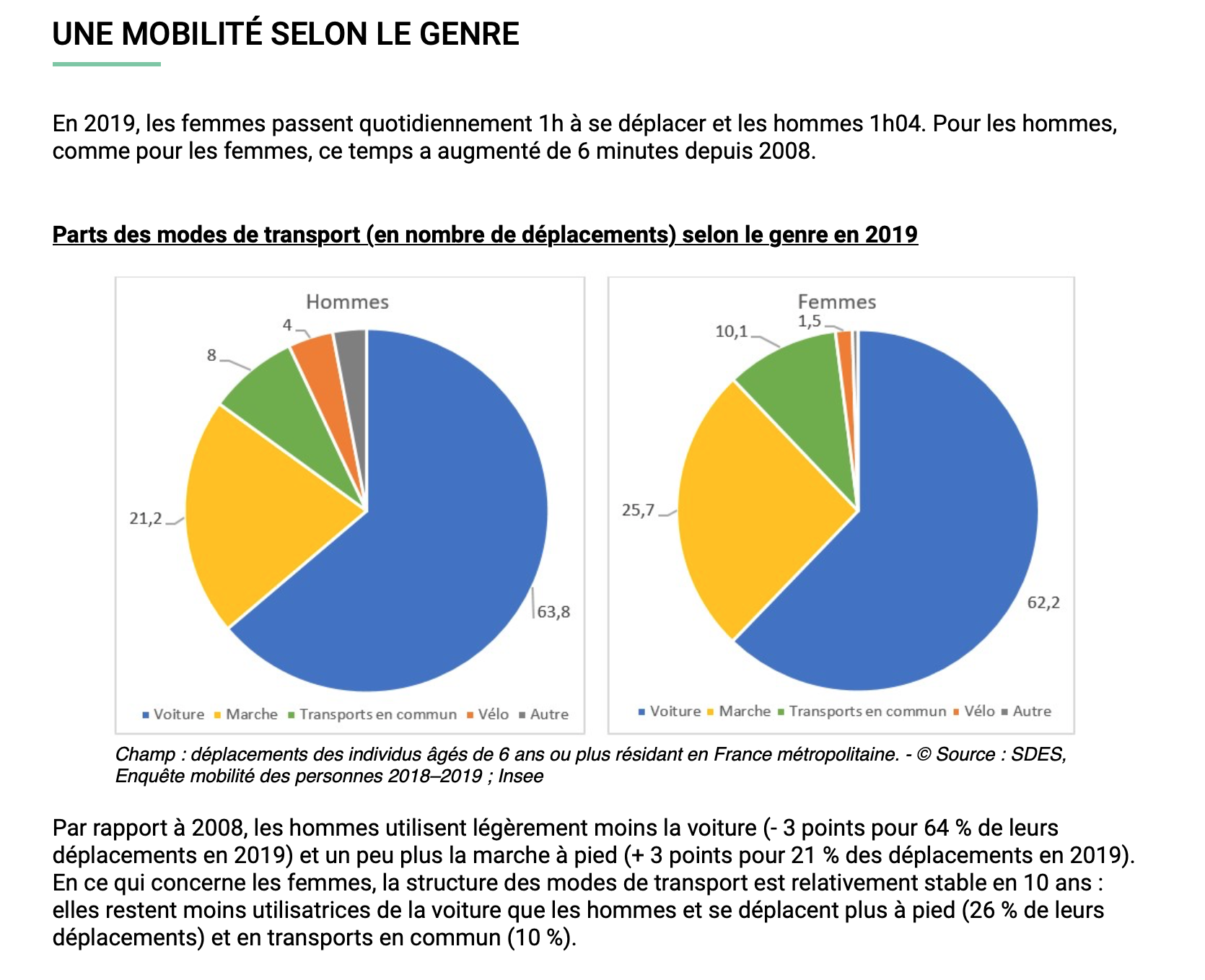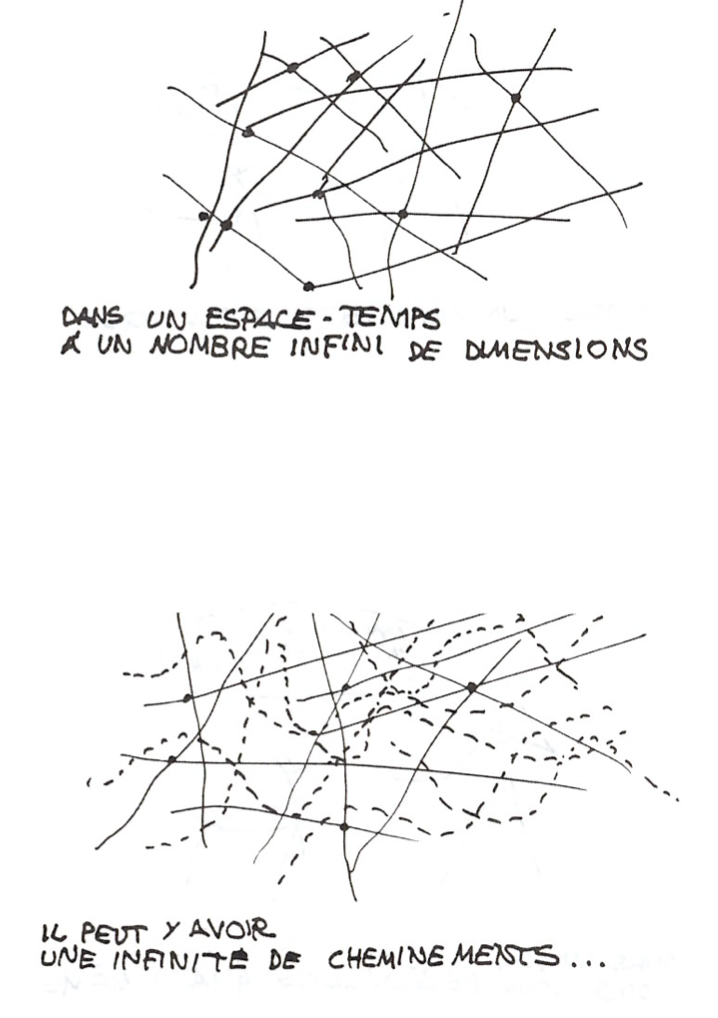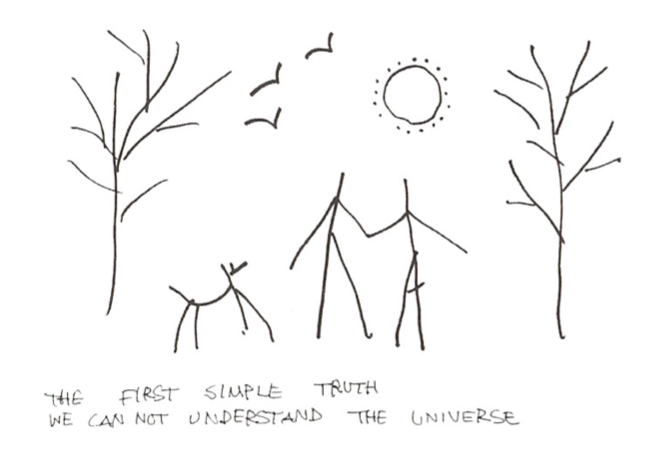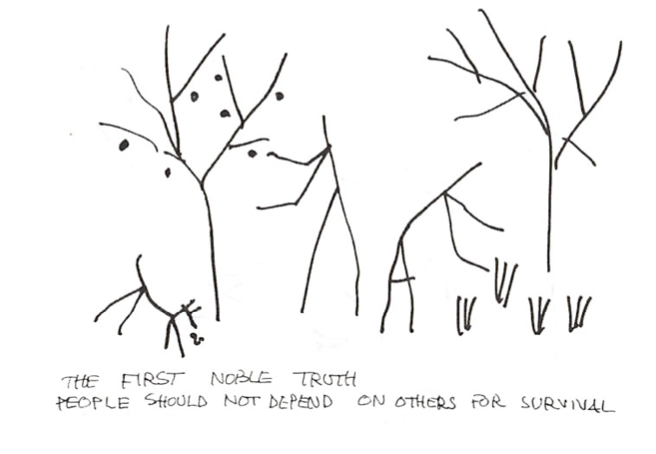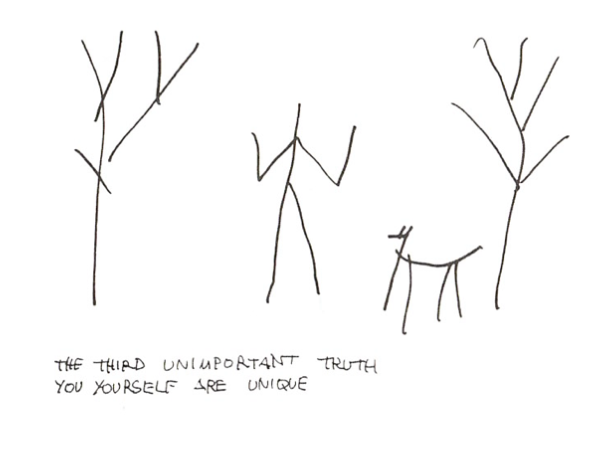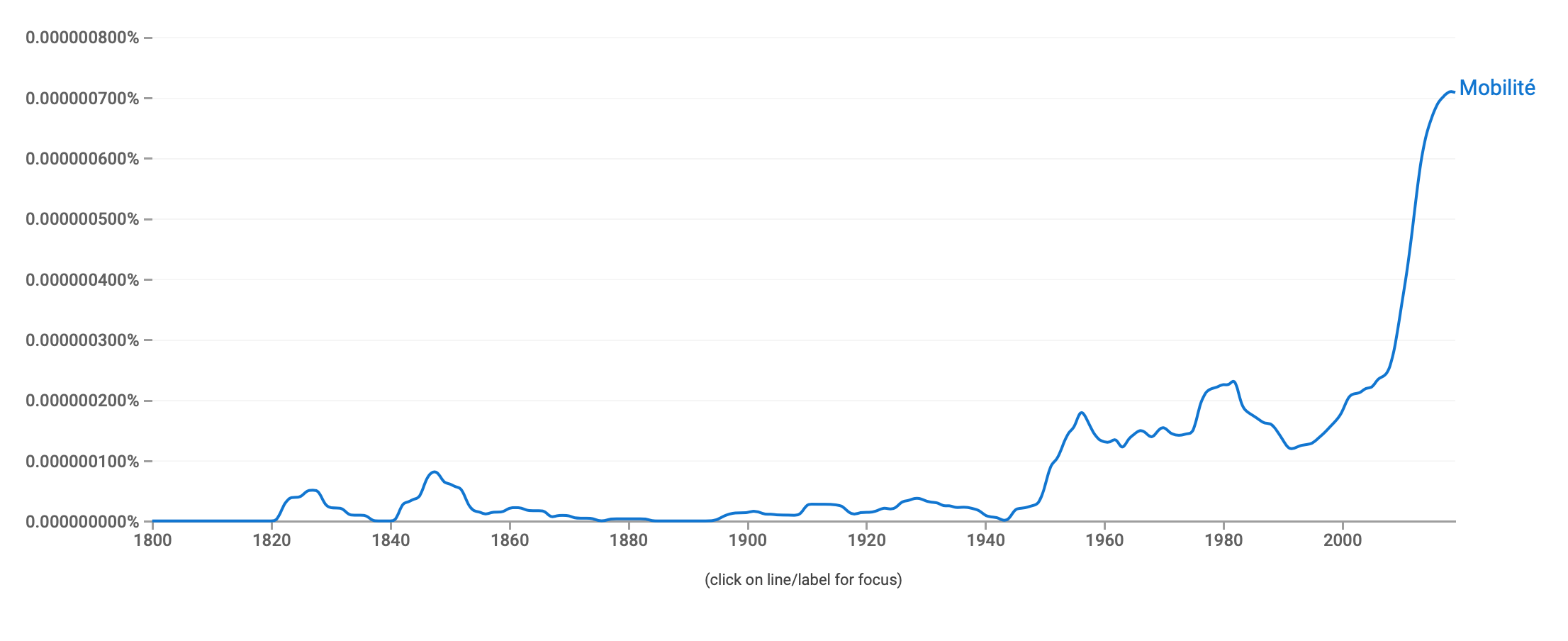La littérature scientifique est parfois jonchée de formules latines qui, ceteris paribus, servent à maintenir une distance entre les arguments énoncés et une réalité trop vaste pour être englobée à l’intérieur de ces arguments. La formule ceteris paribus sic stantibus signie « toutes choses égales par ailleurs ». Il est de bon ton de l’utiliser dans sa version courte ceteris paribus. On l’aura compris, ce n’est pas la formule dans son ensemble qui compte mais l’idée qu’elle véhicule. « Toutes choses égales par ailleurs » est à employer lorsque l’on tient à développer un argument, mais qu’on ne peut toutefois pas généraliser.
En fait, on emploiera souvent cette locution afin de se préserver d’éventuelles critiques, notamment face à la critique récurrente de la représentativité. Lorsque l’on travaille sur un petit échantillon, la représentativité est faible. Les statistiques et la loi normale montrent que la représentativité augmente légèrement à mesure que la population grimpe de façon exponentielle. La loi de Ficher dresse un tableau de probabilités qui permet d’évaluer le pourcentage d’incertitude en rapport avec l’échantillon. Plus l’échantillon est grand, et plus sera grande la certitude d’avoir obtenue une information fiable et représentative. Mais jamais à 100%. Les calculs de probabilités permettent d’éviter d’avoir à questionner la population entière, compte tenu d’une certaine marge d’incertitude.
En ethnologie, nous n’avons pas toujours recours aux statistiques et aux questionnaires quantitatifs. Certains chercheurs rejettent même cette idée. Cependant, la question de la représentativité est souvent posée, et si le singulier prime sur la grande quantité, il faut toujours prévoir cette marge d’incertitude que l’on peut résumer par la locution « ceteris paribus« .
Cependant, les locutions latines sont souvent utilisées dans les textes scientifiques. Colette Pétonnet nous en donne la preuve :
« Les société modernes doivent continuellement trouver leurs réajustements. Plutôt que de regarder en arrière pour constater les pertes avec une nostalgie parfois légitime, mieux vaut mobiliser un peu d’imagination ou assez de curiosité pour contempler les phénomènes in statu nascendi qui conservent aux villes leur pouvoir enchanteur. »
Extrait tiré de Colette Pétonnet, « L’anonymat ou la pellicule protectrice », in Variations sur la ville, Paris, CNRS, 2018, p. 205
In statu nascendi signifie « en état de naître », mais l’utilisation de la locution latine renforce cette situation à la manière d’un concept. Alors que la littérature scientifique anglo-saxonne privilégie l’utilisation des locutions latines, nous pouvons tout à fait écrire leur traduction en français, à plus forte raison, (a fortiori) lorsqu’il s’agit d’affirmer une position par rapport à l’écriture.