Depuis quand la Guadeloupe est-elle française ?
 En 1493, Christophe COLOMB entreprend son deuxième voyage vers ce qu’il croit toujours être les Indes. Mandaté une nouvelle fois par la reine d’Espagne Isabelle la Catholique, il est à la tête de 17 navires. Le dimanche 3 novembre, une île est en vue ; il la nomme « Maria Galanda » (Marie-Galante), du nom du navire amiral. Après un passage d’une nuit à la Dominique, ils reprennent la mer vers une île plus grande dont ils avaient aperçu au loin les montagnes. Colomb décide alors de jeter l’ancre devant cette île afin d’accorder quelques jours de repos à ses hommes.
En 1493, Christophe COLOMB entreprend son deuxième voyage vers ce qu’il croit toujours être les Indes. Mandaté une nouvelle fois par la reine d’Espagne Isabelle la Catholique, il est à la tête de 17 navires. Le dimanche 3 novembre, une île est en vue ; il la nomme « Maria Galanda » (Marie-Galante), du nom du navire amiral. Après un passage d’une nuit à la Dominique, ils reprennent la mer vers une île plus grande dont ils avaient aperçu au loin les montagnes. Colomb décide alors de jeter l’ancre devant cette île afin d’accorder quelques jours de repos à ses hommes.
Le 4 novembre 1493, il débarque sur l’île baptisée par les Caraïbes « Karukera » (ou « Caloucaera »). Il baptisera cette île « Guadalupe » nom ainsi que celui de l’île proviennent du nom du monastère royal de Santa Maria de Guadalupe en Espagne. Lors d’un pèlerinage, Colomb aurait fait la promesse aux religieux de donner le nom de leur monastère à une île. Les premiers habitants de l’île furent des indiens venus du Vénézuela quelques siècles avant notre ère – un peuple de pêcheurs évolués et paisibles – les Arawaks. Vers le IXème siècle, ils furent exterminés par la tribu guerrière et cannibale des Caraïbes (Karibs).
 Tout au long du XVIe siècle, les espagnols se sont peu préoccupés de cette île. Relativement inhospitalière, elle ne possède en effet aucune mine d’or. Elle ne sera qu’un simple point de ravitaillement en eau douce et en bois pour les navires en route vers l’Eldorado. Au début, les Caraïbes tolérèrent ces « marins de passage », et parfois même, fraternisèrent avec eux, mais petit à petit les hostilités grandirent entre les indigènes et les Espagnols. Lassés, les Espagnols, qui préfèrent les terres plus riches de l’Amérique centrale, abandonnèrent progressivement les Petites Antilles aux expéditeurs et flibustiers anglais, français et hollandais.
Tout au long du XVIe siècle, les espagnols se sont peu préoccupés de cette île. Relativement inhospitalière, elle ne possède en effet aucune mine d’or. Elle ne sera qu’un simple point de ravitaillement en eau douce et en bois pour les navires en route vers l’Eldorado. Au début, les Caraïbes tolérèrent ces « marins de passage », et parfois même, fraternisèrent avec eux, mais petit à petit les hostilités grandirent entre les indigènes et les Espagnols. Lassés, les Espagnols, qui préfèrent les terres plus riches de l’Amérique centrale, abandonnèrent progressivement les Petites Antilles aux expéditeurs et flibustiers anglais, français et hollandais.
C’est le 28 juin 1635 que les Français, menés par Jean du Plessis d’OSSONVILLE et Charles LIENARD de l’OLIVE débarquent à la Pointe Allègre à Nogent, (actuelle ville de Sainte-Rose), accompagné de 4 missionnaires dominicains et de 150 hommes (dont de nombreux bretons ou normands). Les deux hommes sont mandatés par la Compagnie des îles d’Amérique. Leur mission est d’évangéliser les peuples indigènes. En échange, ils auraient le droit de gouverner ensemble l’île. Après des premiers mois très difficiles (maladies, manque de nourriture, etc.) pendant lesquels nombre d’entre eux ne survécurent pas, les survivants s’installèrent dans le Sud de l’île du côté de l’actuel Vieux-Fort. Ils y reçurent l’aide des Caraïbes mais malgré tout, De l’Olive, contre l’avis de Du Plessis, décide de déclarer la guerre aux Caraïbes pour leur prendre vivres et femmes. Les français vont alors pratiquement exterminer les amérindiens jusqu’à la signature d’un traité de paix en 1640.
Les Caraïbes furent ainsi exterminés – épidémies, alcool et fusils aidant. Mais les conditions de vie difficiles eurent raison des premiers travailleurs, et bientôt s’organisa l’utilisation d’esclaves déportés d’Afrique, ce qui devra durer près de quatre siècles. Les cultures étant peu rentables au début, la Compagnie vendit la Guadeloupe à Charles HOUËL qui fut à l’origine de son essor grâce à la plantation de sucre, café et cacao. Par la suite, l’île passa en possession de la Compagnie des Indes, puis du roi Louis XIV, fut attaqué par les Hollandais, occupé par les Anglais, de nouvelles cultures furent introduites : coton, épices…
 Au XVIIIe siècle, on est dans la fameuse époque des flibustiers et corsaires et les îles des Caraïbes prospèrent en grande partie grâce au pillage des navires marchands ennemis. Sous l’influence des idées de la Révolution française, la Convention vota l’abolition de l’esclavage le 4 février 1794 et Victor Hugues fût envoyé pour assurer l’application. Bon nombre de grands propriétaires royalistes et esclavagistes furent alors guillotinés. Pourtant, en 1802, Napoléon BONAPARTE rétablit l’esclavage. Des mouvements de résistance commencent alors à voir le jour : sous le commandement de Louis DELGRÈS en 1802, chez les Anglais qui interdisent la traite des Noirs en 1807, au congrès de Vienne qui l’interdit en 1815. Mais il faudra attendre 1848 quand le 27 avril, sous l’impulsion du député Victor SCHOELCHER, à la tête de la Société Abolitionniste, le décret d’abolition est voté.
Au XVIIIe siècle, on est dans la fameuse époque des flibustiers et corsaires et les îles des Caraïbes prospèrent en grande partie grâce au pillage des navires marchands ennemis. Sous l’influence des idées de la Révolution française, la Convention vota l’abolition de l’esclavage le 4 février 1794 et Victor Hugues fût envoyé pour assurer l’application. Bon nombre de grands propriétaires royalistes et esclavagistes furent alors guillotinés. Pourtant, en 1802, Napoléon BONAPARTE rétablit l’esclavage. Des mouvements de résistance commencent alors à voir le jour : sous le commandement de Louis DELGRÈS en 1802, chez les Anglais qui interdisent la traite des Noirs en 1807, au congrès de Vienne qui l’interdit en 1815. Mais il faudra attendre 1848 quand le 27 avril, sous l’impulsion du député Victor SCHOELCHER, à la tête de la Société Abolitionniste, le décret d’abolition est voté.
 Vers la fin du XIXe siècle, la Guadeloupe n’évolua que fort peu sur le plan des droits humains. C’est la Troisième République de 1870 qui marqua un réel progrès, car non seulement le suffrage universel masculin fut institué, mais l’enseignement public obligatoire, laïc et gratuit, fut étendu à tous les Guadeloupéens (1881). Toutefois, la situation des classes ouvrières resta précaire, car la scolarisation des enfants impliquait des dépenses supplémentaires auxquelles les parents ne pouvaient pas toujours faire face. En réalité, le niveau de vie des Noirs et immigrés indiens ne connut une amélioration significative que vers le milieu du XXe siècle. De 1870 à 1914, la crise sucrière secoua la Guadeloupe, ce qui eut pour effet de concentrer les propriétés au profit des usines qui appartenaient déjà à des industriels de la Métropole. Suivit un nouveau régime se réclamant du socialisme et incarné par Hégésippe LÉGITIMUS qui s’en prenait au quasi-monopole des mulâtres dans la vie politique locale au détriment des Noirs.
Vers la fin du XIXe siècle, la Guadeloupe n’évolua que fort peu sur le plan des droits humains. C’est la Troisième République de 1870 qui marqua un réel progrès, car non seulement le suffrage universel masculin fut institué, mais l’enseignement public obligatoire, laïc et gratuit, fut étendu à tous les Guadeloupéens (1881). Toutefois, la situation des classes ouvrières resta précaire, car la scolarisation des enfants impliquait des dépenses supplémentaires auxquelles les parents ne pouvaient pas toujours faire face. En réalité, le niveau de vie des Noirs et immigrés indiens ne connut une amélioration significative que vers le milieu du XXe siècle. De 1870 à 1914, la crise sucrière secoua la Guadeloupe, ce qui eut pour effet de concentrer les propriétés au profit des usines qui appartenaient déjà à des industriels de la Métropole. Suivit un nouveau régime se réclamant du socialisme et incarné par Hégésippe LÉGITIMUS qui s’en prenait au quasi-monopole des mulâtres dans la vie politique locale au détriment des Noirs.
 En 1928, l’île fut ravagée par un terrible cyclone et les constructions commencèrent alors à se faire avec du béton armé. L’économie sucrière continua son développement, mais l’exportation de la banane et du rhum commença à concurrencer la canne à sucre avant la Première Guerre mondiale. Par la suite, le déclin de l’économie sucrière et les tentatives de reconversion de la canne à sucre ne favorisèrent pas la paix sociale.
En 1928, l’île fut ravagée par un terrible cyclone et les constructions commencèrent alors à se faire avec du béton armé. L’économie sucrière continua son développement, mais l’exportation de la banane et du rhum commença à concurrencer la canne à sucre avant la Première Guerre mondiale. Par la suite, le déclin de l’économie sucrière et les tentatives de reconversion de la canne à sucre ne favorisèrent pas la paix sociale.
Le 19 mars 1946, la Guadeloupe devint département français. Elle est administrée à l’instar des autres départements, par un préfet assisté de deux secrétaires généraux et de deux sous-préfets, un pour l’arrondissement de Pointe-à-Pitre et un pour les îles du Nord (Saint-Martin et Saint-Barthélemy). Les lois sont celles de l’Hexagone avec toutefois quelques arrangements spécifiques concernant les salaires des fonctionnaires, les équipements scolaires et l’assistance médicale et sociale. Un mouvement indépendantiste, très actif dans les années 80, est en perte de vitesse au profit d’une réflexion tournée vers l’avenir économique et social avec les institutions présentes.
 Ainsi le 1er décembre 1999 la « Déclaration de Basse-Terre » des présidents de région Guadeloupe, Martinique et Guyane a pour but de trouver ensemble un mode de développement adapté aux Antilles-Guyane, et en juin 2000 le projet de loi d’orientation pour le développement des DOM fut défini.
Ainsi le 1er décembre 1999 la « Déclaration de Basse-Terre » des présidents de région Guadeloupe, Martinique et Guyane a pour but de trouver ensemble un mode de développement adapté aux Antilles-Guyane, et en juin 2000 le projet de loi d’orientation pour le développement des DOM fut défini.
Le 19 janvier 2009, les gérants des 115 stations-services de l’île diffusent un mot d’ordre de fermeture illimitée de leurs établissements. Le lendemain, un «Comité contre l’exploitation outrancière» (Liyannaj kont pwofitasyon, LKP) appelle à la grève générale. Ce comité est un collectif qui regroupe 49 organisations, à savoir des syndicats insulaires, des partis politiques (PC guadeloupéen, MoDem, Les Verts, etc) et des associations culturelles militant pour l’identité créole. Son leader et porte-parole est Elie DOMOTA, 42 ans, aussi secrétaire général de l’Union générale des travailleurs guadeloupéens (UGTG).
Les blocages affectent les secteurs de l’éducation, des transports, du bâtiment, de la santé, du tourisme, de l’hôtellerie, de l’électricité ou de l’eau, qu’ils soient privés ou publics. Les milliers de manifestants de Pointe-à-Pitre exigent notamment une baisse du prix des carburants, des produits de première nécessité, des impôts et des taxes, ainsi qu’une hausse du salaire minimum de 200 euros. Au final, 146 revendications sont énoncées par le collectif.
[dailymotion]http://www.dailymotion.com/video/x8hkqj_guadeloupe-lescalade-dune-crise_news[/dailymotion]
Pour en savoir plus :
– l’article « La Guadeloupe de l’ère précolombienne à nos jours » du site Antilles Info Tourisme
– une mise au point sur La Guadeloupe contemporaine (Wikipedia)
– une présentation complète (géographie, histoire et économie) de la Guadeloupe (Université Laval, Québec)
– une histoire de la Guadeloupe en 15 dates (le Nouvel Observateur)
– les Dates clés de la colère en Outre-mer (20 minutes.fr)
Pourquoi l’Élysée est la résidence du Président de la République ?
 Entre la grande rue du Faubourg-Saint-Honoré, alors simple chaussée menant au village du Roule, et le Grand Cours (Champs-Élysées), l’architecte Armand-Claude Mollet possédait un terrain qu’il vendit en 1718 à Louis Henri de La Tour d’Auvergne, comte d’Évreux. Le contrat de vente prévoyait qu’Armand-Claude Mollet serait chargé d’y construire un hôtel, destiné à la résidence du comte d’Évreux.
Entre la grande rue du Faubourg-Saint-Honoré, alors simple chaussée menant au village du Roule, et le Grand Cours (Champs-Élysées), l’architecte Armand-Claude Mollet possédait un terrain qu’il vendit en 1718 à Louis Henri de La Tour d’Auvergne, comte d’Évreux. Le contrat de vente prévoyait qu’Armand-Claude Mollet serait chargé d’y construire un hôtel, destiné à la résidence du comte d’Évreux.
Édifié et décoré entre 1718 et 1722, l’hôtel fut aménagé selon les principes d’architecture en vogue à l’époque. Il reste l’un des meilleurs exemples du modèle classique. L’ordonnancement des lieux permettra toutes les adaptations souhaitées par les propriétaires successifs. Au début du XVIIIème siècle, l’actuel faubourg saint-Honoré n’était encore qu’une plaine traversée de pâturages et de cultures maraîchères, et de quelques maisons au toit de chaume. C’est à la fin de ce siècle que l’hôtel prit son nom de palais de Élysée par référence à la promenade toute proche (avenue des Champs-Élysées) .
 C’est sous le règne de Napoléon Bonaparte que son histoire fut liée à l’histoire de France. En 1816, l’Élysée entra définitivement dans les biens nationaux. Pendant le gouvernement provisoire de la IIe République, le palais prit le nom d’« Élysée national », et l’Assemblée nationale l’assigna par décret comme résidence du président de la République.
C’est sous le règne de Napoléon Bonaparte que son histoire fut liée à l’histoire de France. En 1816, l’Élysée entra définitivement dans les biens nationaux. Pendant le gouvernement provisoire de la IIe République, le palais prit le nom d’« Élysée national », et l’Assemblée nationale l’assigna par décret comme résidence du président de la République.
En 1853, Napoléon III décida de la rénovation complète du palais par un nouvel architecte, Joseph-Eugène Lacroix. Les structures actuelles du palais proviennent pour l’essentiel de cette époque, et l’ensemble de ces travaux, qui s’achevèrent en 1867, constituent les derniers grands aménagements.
 Après la chute de l’Empire, le Palais de l’Elysée reprit le titre d’Elysée-National (titre précédemment pris pendant le gouvernement provisoire de la IIème République). Le Palais n’eut à subir aucun dommage pendant la Commune. Thiers, chef du pouvoir exécutif en février 1871 puis Président de la République en août, y fit quelques séjours. Son successeur, le maréchal Mac Mahon élu en mai 1873, s’installa définitivement à l’Elysée à partir de septembre 1874.
Après la chute de l’Empire, le Palais de l’Elysée reprit le titre d’Elysée-National (titre précédemment pris pendant le gouvernement provisoire de la IIème République). Le Palais n’eut à subir aucun dommage pendant la Commune. Thiers, chef du pouvoir exécutif en février 1871 puis Président de la République en août, y fit quelques séjours. Son successeur, le maréchal Mac Mahon élu en mai 1873, s’installa définitivement à l’Elysée à partir de septembre 1874.
Le Palais de l’Elysée sera désormais la résidence officielle de tous les présidents de la République.
 Fermé du 13 juin 1940 jusqu’en 1946, le Palais retrouvera sa fonction présidentielle avec Vincent Auriol. La Vème République conservera l’Elysée comme palais présidentiel. Au début de la présidence de Charles de Gaulle, ce dernier trouvant le palais peu adapté à la fonction, le transfert de la Présidence vers un autre lieu fut étudié, plus particulièrement vers les Invalides ou le château de Vincennes pour disposer de plus de place, assurer une meilleure sécurité et pouvoir y accéder par hélicoptère. Ce projet n’eut pas de suite, pas plus que celui de Valéry Giscard d’Estaing qui dit avoir songé à l’École militaire en 1978 et celui de François Mitterrand qui, dès son investiture le 21 mai 1981, envisagea pareil transfert aux Invalides.
Fermé du 13 juin 1940 jusqu’en 1946, le Palais retrouvera sa fonction présidentielle avec Vincent Auriol. La Vème République conservera l’Elysée comme palais présidentiel. Au début de la présidence de Charles de Gaulle, ce dernier trouvant le palais peu adapté à la fonction, le transfert de la Présidence vers un autre lieu fut étudié, plus particulièrement vers les Invalides ou le château de Vincennes pour disposer de plus de place, assurer une meilleure sécurité et pouvoir y accéder par hélicoptère. Ce projet n’eut pas de suite, pas plus que celui de Valéry Giscard d’Estaing qui dit avoir songé à l’École militaire en 1978 et celui de François Mitterrand qui, dès son investiture le 21 mai 1981, envisagea pareil transfert aux Invalides.
Selon Le Parisien (15 janvier 2008), la question serait de nouveau à l’étude actuellement…
[dailymotion]http://www.dailymotion.com/video/x78f7i_visite-du-palais-de-lelysee_travel[/dailymotion]
Pour en savoir plus :
– une visite virtuelle sur 360° du palais de l’Elysée
– une histoire complète du palais (site officiel Elysee.fr)
– petite histoire de l’Elysée (Wikipedia)
– Elysée, la vie de château , (l’Express – 02/11/00)
– Une vidéo sur le site de TF1 qui dévoile les coulisses de l’Élysée et toutes les personnes qui y travaillent
Les coulisses du web pedagogique

Depuis le temps que vous en rêviez, le moment suprême est enfin venu ! De manière tout à fait exclusive, j’ai eu la chance de pénétrer dans l’antre secrète – mais pas si cachée que ça – de toute l’équipe du Web pédagogique. Ils étaient tous là Marie, Claire, Julien et bien sûr Vincent ! Tous ont gentiment acceptés de nous montrer « un peu » de l’envers du décor. Une belle manière de prouver que l’un des atouts majeurs du Web pédagogique, c’est une équipe de gens passionnées au service de milliers d’autres tout aussi passionnés. Qu’il me soit ici permis de les remercier très sincèrement pour le formidable accueil chaleureux dont ils ont bien voulu m’honorer. Par delà le monde virtuel, suivez moi sur les traces d’une équipe pas comme les autres…
 Paris, mercredi 18 février 2009. 9h48. Après avoir un peu cherché dans les rues avoisinantes, à deux pas de l’église La Madeleine, me voici devant le numéro 11 de la rue du Chevalier St Georges. Tout ceux qui la connaissent estimeront qu’elle est facile à trouver. Malgré cela, j’avoue que le géographe que je suis a retourné son plan dans un sens puis dans l’autre avant de se décider à aller dans la bonne direction… Mais qu’importe, je suis à l’heure. C’est l’essentiel !
Paris, mercredi 18 février 2009. 9h48. Après avoir un peu cherché dans les rues avoisinantes, à deux pas de l’église La Madeleine, me voici devant le numéro 11 de la rue du Chevalier St Georges. Tout ceux qui la connaissent estimeront qu’elle est facile à trouver. Malgré cela, j’avoue que le géographe que je suis a retourné son plan dans un sens puis dans l’autre avant de se décider à aller dans la bonne direction… Mais qu’importe, je suis à l’heure. C’est l’essentiel !
 Jolie porte ouvragée… Mais comment l’ouvrir ? Ah, un digicode… Ah oui mais je ne l’ai pas moi ! Coup de fil rapide – c’est un comble – à Olivier (soit trois étages plus haut). Il suffisait d’appuyer sur n’importe quel chiffre, honte suprême avant même d’arriver ! Je déteste passer pour le provincial de service eprdu dans Paris ; je viens tout de même de naviguer dans le métro sans problème, et je bute sur une bête porte. Je la déteste.
Jolie porte ouvragée… Mais comment l’ouvrir ? Ah, un digicode… Ah oui mais je ne l’ai pas moi ! Coup de fil rapide – c’est un comble – à Olivier (soit trois étages plus haut). Il suffisait d’appuyer sur n’importe quel chiffre, honte suprême avant même d’arriver ! Je déteste passer pour le provincial de service eprdu dans Paris ; je viens tout de même de naviguer dans le métro sans problème, et je bute sur une bête porte. Je la déteste.
Superbe entrée, bel ascenseur du type de ceux qu’on installait au début du siècle dans les beaux immeubles bourgeois parisiens. Je préfère néanmoins l’escalier, d’autant qu’une bonne odeur inonde les couloirs – j’apprendrais un peu plus tard qu’elle provient du restaurant tout proche. Tout un programme ! J’arrive enfin au 3ème étage (gauche !), face à la plaque « Copilot Partners ». Cette fois, pas d’erreur possible, c’est bien là ! Allez, je sonne… Je parie sur Marie dés l’ouverture : gagné ! C’est toujours un peu troublant de franchir la barrière du virtuel : on croit connaître des gens, on leur parle… Et puis le moment venu, on devient presque timide. Mais Marie m’a très vite rassurée par son large sourire – qu’elle n’a d’ailleurs pas quitté de la journée et qui semble être communicatif pour toute l’équipe d’ailleurs.
 Je pose rapidement mon sac et mon manteau dans l’entrée, et me voici sur le seuil de LA salle, du centre névralgique, là où tout se fait, où tout se décide : le bureau de la rédaction du Web pédagogique ! Et devinez qui m’y accueille en premier ? Oui, vous l’avez deviné, le Big boss en personne, Vincent OLIVIER, fondateur du Web pédagogique. D’après lui, je ressemble beaucoup à la photo que j’ai choisie pour figurer dans l’en tête de ce Blog. Me voilà rassuré ! Je lui retourne le compliment : il est même mieux que la photo qu’il a déposé sur Facebook.
Je pose rapidement mon sac et mon manteau dans l’entrée, et me voici sur le seuil de LA salle, du centre névralgique, là où tout se fait, où tout se décide : le bureau de la rédaction du Web pédagogique ! Et devinez qui m’y accueille en premier ? Oui, vous l’avez deviné, le Big boss en personne, Vincent OLIVIER, fondateur du Web pédagogique. D’après lui, je ressemble beaucoup à la photo que j’ai choisie pour figurer dans l’en tête de ce Blog. Me voilà rassuré ! Je lui retourne le compliment : il est même mieux que la photo qu’il a déposé sur Facebook.
 Les présentations s’enchainent. Je rencontre Julien TARTAGLIA : enfin un visage sur le support technique ! Très concentré sur la préparation du matériel, il a toujours un œil sur son écran, histoire de na pas rater un seul de vos messages. Mieux qu’une hot-line à lui tout seul, il tapote une réponse, puis revient sur ce qu’il était en train de faire. Son assurance et sa tranquillité sont impressionnantes. Il effectue les derniers réglages de son et d’image avant le début du tournage prévu dans quelques instants. Car c’est là l’autre raison de ma venue dans ce bureau parisien : le tournage de quelques clips inédits dont je vous laisse la surprise pour le moment. Sachez simplement que la première série concerne le programme Pairform@nce du ministère de l’éducation nationale, projet soutenu par Intel – dont j’ai eu la chance de rencontrer l’un de ses responsables ce jour là, dans ce même bureau. Pour ce qui est de la seconde série, un seul indice : elle ne sera pas diffusée avant le mois de mai…
Les présentations s’enchainent. Je rencontre Julien TARTAGLIA : enfin un visage sur le support technique ! Très concentré sur la préparation du matériel, il a toujours un œil sur son écran, histoire de na pas rater un seul de vos messages. Mieux qu’une hot-line à lui tout seul, il tapote une réponse, puis revient sur ce qu’il était en train de faire. Son assurance et sa tranquillité sont impressionnantes. Il effectue les derniers réglages de son et d’image avant le début du tournage prévu dans quelques instants. Car c’est là l’autre raison de ma venue dans ce bureau parisien : le tournage de quelques clips inédits dont je vous laisse la surprise pour le moment. Sachez simplement que la première série concerne le programme Pairform@nce du ministère de l’éducation nationale, projet soutenu par Intel – dont j’ai eu la chance de rencontrer l’un de ses responsables ce jour là, dans ce même bureau. Pour ce qui est de la seconde série, un seul indice : elle ne sera pas diffusée avant le mois de mai…
 Me voici à présent face à Claire De La ROCHEFOUCAULD. Son visage m’est plus familier : il figurait sur la page d’accueil du Blog Brevet 2008 que nous avons co-animé en mai dernier an partenariat avec MSN. Comme avec Marie, nous avons l’impression étrange de déjà nous connaître alors que nous nous voyons pour la première fois. Aussi timide l’un que l’autre, nous aurons l’occasion de discuter un peu plus à l’heure du repas.
Me voici à présent face à Claire De La ROCHEFOUCAULD. Son visage m’est plus familier : il figurait sur la page d’accueil du Blog Brevet 2008 que nous avons co-animé en mai dernier an partenariat avec MSN. Comme avec Marie, nous avons l’impression étrange de déjà nous connaître alors que nous nous voyons pour la première fois. Aussi timide l’un que l’autre, nous aurons l’occasion de discuter un peu plus à l’heure du repas.
 Et de quoi parlent des professeurs qui se rencontrent ? Des élèves, bien sûr ! Nanterre pour elle, Douai pour moi : deux villes, deux publics scolaires, deux univers mais une passion commune. Et puis aussi ce message que, tous deux, nous avons envie de faire passer à destination de nos chers collègues : avoir et mettre à jour un Blog ne fait pas de nous des ingénieurs en informatique ! Il y a des gens bien plus compétents pour régler vos petits tracas quotidiens en informatique; Tenez, Julien, par exemple : son Forum est bourré d’astuces, n’hésitez pas à aller y faire un petit tour !
Et de quoi parlent des professeurs qui se rencontrent ? Des élèves, bien sûr ! Nanterre pour elle, Douai pour moi : deux villes, deux publics scolaires, deux univers mais une passion commune. Et puis aussi ce message que, tous deux, nous avons envie de faire passer à destination de nos chers collègues : avoir et mettre à jour un Blog ne fait pas de nous des ingénieurs en informatique ! Il y a des gens bien plus compétents pour régler vos petits tracas quotidiens en informatique; Tenez, Julien, par exemple : son Forum est bourré d’astuces, n’hésitez pas à aller y faire un petit tour !
Allez, au boulot ! Questions, réponses… On tourne coco : c’est sérieux, mais l’ambiance reste détendue. On s’inquiète de savoir si j’ai soif ou besoin de quelque chose. on est vraiment bien soigné au Web pédagogique, virtuellement comme en réalité ! Au bout d’une demi heure de tournage, la température de la pièce commence a monter – et les deux projecteurs n’y sont pas pour rien. Mais rien n’arrête Vincent : sans une seule note, il avance à pas feutrés dans l’interview, repère déjà les bons moments à reprendre au montage, reformule ses questions en conséquence, s’inquiète de savoir si le son est bon. C’est important, c’est vrai, tout autant que l’image ; surtout lorsque le restaurant du dessous se décide soudain à déverser quelques bouteilles en verre dans la poubelle de la cour : sympa comme bande son !
 Voilà, le première partie est dans la boîte. A peine ais-je le temps de finir mon verre d’eau (joli modèle made in Ikea) que Julien et Claire quitte ensemble le bureau – en tout bien tout honneur – pour aller nous chercher quelques gâteries à la boulangerie du coin. Même si je n’en avais pas remarqué une plus particulièrement en arrivant, il doit bien y avoir une dizaine dans le quartier proche. Vite revenus, petits pains et croissants sont mis à notre disposition pendant que je partage avec Vincent à peu près une idée nouvelle par minute – j’exagère à peine. Vincent est une véritable usine à idées, c’est impressionnant, vraiment. Et elles sont toutes plus passionnantes les unes que les autres. Je m’avance peu en disant que le Web pédagogique est promis à un grand avenir avec une telle équipe à sa tête. Et vous n’êtes pas au bout de vos surprises, croyez-moi !
Voilà, le première partie est dans la boîte. A peine ais-je le temps de finir mon verre d’eau (joli modèle made in Ikea) que Julien et Claire quitte ensemble le bureau – en tout bien tout honneur – pour aller nous chercher quelques gâteries à la boulangerie du coin. Même si je n’en avais pas remarqué une plus particulièrement en arrivant, il doit bien y avoir une dizaine dans le quartier proche. Vite revenus, petits pains et croissants sont mis à notre disposition pendant que je partage avec Vincent à peu près une idée nouvelle par minute – j’exagère à peine. Vincent est une véritable usine à idées, c’est impressionnant, vraiment. Et elles sont toutes plus passionnantes les unes que les autres. Je m’avance peu en disant que le Web pédagogique est promis à un grand avenir avec une telle équipe à sa tête. Et vous n’êtes pas au bout de vos surprises, croyez-moi !
Il est presque 11h30 lorsque nous commençons la seconde partie du tournage. Aucune note pour Vincent comme pour moi. Pas si facile que ça d’y énoncer les bonnes idées, d’articuler face à la caméra. mais j’aime bien l’exercice, un peu comme l’improvisation sur la scène d’un théâtre. Le monde de la communication me fascine toujours autant. Une fois le tournage terminé, Vincent me montre ce qu’on pourra faire à partir de ce qui a été tourné. La vidéo qu’il choisit est d’ailleurs mise à l’honneur cette semaine : cela tombe bien !
[dailymotion]http://www.dailymotion.com/video/x8fq3v_leducation-au-gout-questce-que-cest_animals[/dailymotion]
J’adore ces petits effets d’incrustation. Encore une fois, c’est malin, bien pensé, drôle et intéressant. Que demander de plus ? On parle des projets en cours (CIV, SNCF…), d’Hugo BILLARD, de la prochaine évolution de la plateforme du Web pédagogique, de l’habillage des Blogs… Et il est l’heure de déjeuner (il est presque 13h30). Les petits restos « sympas » du coin sont littéralement bourrés. Alors que nous nous apprêtions, résignés, à nous contenter d’un vulgaire bout de pizza au bureau, nous finissons par nous jucher sur quatre chaises hautes au fond d’une pizzéria typique – et bondée. Et c’est le moment de se quitter, car le mercredi est habituellement très chargé sur Douai, et la vie provinciale (et familiale) doit reprendre ses droits.
Une nouvelle fois, un grand merci à toi Marie, Claire, Vincent et Julien pour cet accueil si sympathique. Vous savoir derrière ces pages me rassurent – même si je n’étais pas inquiet outre mesure. Vous pouvez compter sur moi pour d’autres aventures : je suis partant car avec des gens comme vous, elles ne peuvent être que passionnantes.
MAJ 02/03/09 – article présentant LA vidéo réalisée pour le programme Pairform@ance
Y a t’il une différence entre Période et Époque en histoire ?
 C’est toujours un plaisir que de répondre sur ce Blog à une question surgie à un moment ou à un autre dans la classe. Celui-ci est aujourd’hui décuplé par le fait que la question du jour m’a été posée par Ostiane, rédactrice fidèle et brillante du maintenant célèbre Blog Bleu Primaire (Blog d’argent 2008) couplé à son non moins passionnant projet BiblioBlog. Mais qui a bien pu te poser une pareille question ? Je ne suis pas surpris outre mesure de voir un enfant de primaire toucher du doigt, par sa curiosité, un problème épineux. Je suis seulement curieux de savoir dans quelles circonstances pareille interrogation lui est venue…
C’est toujours un plaisir que de répondre sur ce Blog à une question surgie à un moment ou à un autre dans la classe. Celui-ci est aujourd’hui décuplé par le fait que la question du jour m’a été posée par Ostiane, rédactrice fidèle et brillante du maintenant célèbre Blog Bleu Primaire (Blog d’argent 2008) couplé à son non moins passionnant projet BiblioBlog. Mais qui a bien pu te poser une pareille question ? Je ne suis pas surpris outre mesure de voir un enfant de primaire toucher du doigt, par sa curiosité, un problème épineux. Je suis seulement curieux de savoir dans quelles circonstances pareille interrogation lui est venue…
Parce qu’à vrai dire, et pour être franc, Période et Époque peuvent apparaitre, au premier abord, comme des synonymes. Nombreux sont les élèves – et collègues – qui utilisent l’un et l’autre sans se soucier de quelque différence que ce soit. Et pourtant, en y réfléchissant, il y en a une petite…
 Étymologiquement d’abord, Époque vient d’un mot grec signifiant « sur », et du verbe grec signifiant « s’arrêter ». En ce sens, ce terme désigne précisément un moment déterminé, particulier de la durée. Ce n’est que par extension (ou par abus) qu’on lui attribue le sens de grand intervalle de temps. Au contraire, Période, à cause de la préposition grecque qui entre dans sa composition, désigne proprement un grand intervalle de temps, une grande durée et, par extension, une histoire cyclique.
Étymologiquement d’abord, Époque vient d’un mot grec signifiant « sur », et du verbe grec signifiant « s’arrêter ». En ce sens, ce terme désigne précisément un moment déterminé, particulier de la durée. Ce n’est que par extension (ou par abus) qu’on lui attribue le sens de grand intervalle de temps. Au contraire, Période, à cause de la préposition grecque qui entre dans sa composition, désigne proprement un grand intervalle de temps, une grande durée et, par extension, une histoire cyclique.
Quoi qu’il en soit, les deux termes ont pour double objectif de répondre à une exigence chronologique et de poser des repères, d’indiquer des ruptures qui traduisent un changement d’objet.
 Si l’histoire de la terre commence avec la formation géologique du globe terrestre et si l’histoire de l’humanité commence avec l’apparition du genre homo sapiens, on limite traditionnellement l’emploi du mot « Histoire » (avec une majuscule) pour les périodes qui nous sont connues par l’intermédiaire de sources écrites, quel que soit le support de ces sources et quels que soient les moyens par lesquels elles nous sont parvenues. Comme le veut une ancienne tradition datant de 1808, à la création des archives nationales, les périodes pour lesquelles de telles sources n’existent pas ont été nommées, quant à elles, préhistoire ou protohistoire.
Si l’histoire de la terre commence avec la formation géologique du globe terrestre et si l’histoire de l’humanité commence avec l’apparition du genre homo sapiens, on limite traditionnellement l’emploi du mot « Histoire » (avec une majuscule) pour les périodes qui nous sont connues par l’intermédiaire de sources écrites, quel que soit le support de ces sources et quels que soient les moyens par lesquels elles nous sont parvenues. Comme le veut une ancienne tradition datant de 1808, à la création des archives nationales, les périodes pour lesquelles de telles sources n’existent pas ont été nommées, quant à elles, préhistoire ou protohistoire.
Liste des périodes actuellement retenues :
La Préhistoire : c’est la plus longue et la plus ancienne période de l’histoire des hommes, avant l’invention de l’écriture, il y a 3 300 ans. Elle débute avec nos ancêtres, les premiers hominidés découverts en Afrique centrale (Toumaï) et de l’Est (Lucy).
L’Antiquité : cette période débute avec l’invention de l’écriture et s’achève avec la chute de l’Empire romain d’Occident en 476.
Le Moyen-Age : c’est la plus longue des périodes historiques. Mille ans de Clovis à la découverte de l’Amérique en 1492.
L’époque moderne : appelée dans certains manuels « le temps des rois », elle couvre les XVI°, XVII° et XVIII° siècles.
L’époque contemporaine : ce sont les deux siècles qui nous séparent de la Révolution et de l’Empire napoléonien.
 Il existe actuellement, au CNRS, un Institut de l’Histoire du Temps Présent. On déclare y travailler sur l’histoire culturelle de la guerre au XXe siècle, les systèmes de domination autoritaires, totalitaires ou coloniaux, l’histoire culturelle et l’histoire des cultures des sociétés actuelles, et enfin l’épistémologie de l’histoire du temps présent. Certains historiens et journalistes évoquent enfin une dernière période, : l’histoire immédiate. Elle concerne l’ensemble de la partie terminale de l’histoire contemporaine, englobant aussi bien celle dite du temps présent que celle des trente dernières années. Cette histoire a pour caractéristique principale d’avoir été vécue par l’historien ou ses principaux témoins.
Il existe actuellement, au CNRS, un Institut de l’Histoire du Temps Présent. On déclare y travailler sur l’histoire culturelle de la guerre au XXe siècle, les systèmes de domination autoritaires, totalitaires ou coloniaux, l’histoire culturelle et l’histoire des cultures des sociétés actuelles, et enfin l’épistémologie de l’histoire du temps présent. Certains historiens et journalistes évoquent enfin une dernière période, : l’histoire immédiate. Elle concerne l’ensemble de la partie terminale de l’histoire contemporaine, englobant aussi bien celle dite du temps présent que celle des trente dernières années. Cette histoire a pour caractéristique principale d’avoir été vécue par l’historien ou ses principaux témoins.
Pour en savoir un peu plus…
– l’article Époque historique (Wikipedia)
– Un rappel détaillé des différentes périodes historiques sur le site Histoire en Primaire
– La classe d’Histoire, avec un vrai tableau noir…
Les Questions de la Semaine
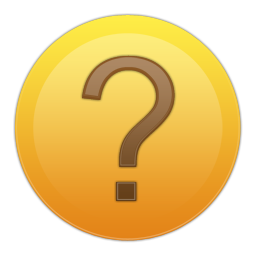
Période 10
à partir du 08/02/09
Gagnant Période 9 : Rodolph DUHEM (5eme G)
Comment les Croisades se sont-elles terminées ?
A vous de jouer ! Durant toute la semaine, déposez ici toutes vos questions, sous la forme d’un commentaire. La plus pertinente sera retenue, fera l’objet d’un billet sur le Blog et sera dignement récompensée…
Il vous suffit de commenter ce billet en n’oubliant pas de donner votre nom, votre prénom et votre classe et l’adresse de votre site ou Blog. Attention à bien respecter ces 3 règles :
- une seule question par personne et par semaine. On peut annuler une question déjà posée, il suffit de me le demander…
- une fois sélectionné, et récompensé, vous êtes « hors-jeu » pour quelques semaines… histoire de laisser leur chance aux autres !
- seules les questions postées en commentaire à ce billet seront prises en compte. Évitez donc de poser vos questions ailleurs : je vais finir par m’y perdre sinon…
Pour découvrir la réponse aux questions lauréates, cliquez sur cette page
Pour voir les questions déjà posées (et recompensées) de l’année dernière, voir ce Billet
Depuis quand la Corse est-elle française ?
 Oui, je sais, cette photo fait rêver. C’est Camille qui me l’a montrée dernièrement en cours. Elle connait apparemment bien la Corse et y retourne assez souvent. Elle ne manquera pas de vous en dire plus sur cette photo et l’endroit où elle a été prise dans un commentaire à cet article… Du moins, je le souhaite !
Oui, je sais, cette photo fait rêver. C’est Camille qui me l’a montrée dernièrement en cours. Elle connait apparemment bien la Corse et y retourne assez souvent. Elle ne manquera pas de vous en dire plus sur cette photo et l’endroit où elle a été prise dans un commentaire à cet article… Du moins, je le souhaite !
Pour le moment, intéressons nous à la question du proche passé assez tourmenté de cette île de rêve…Tout commença en 1755, le 29 avril, date à laquelle y débarqua un grand homme, Pascal PAOLI. Il y est élu Général de la Nation en juillet. Il devra affronter les Matra, héritiers de Gaffori, et leur partisans avant de s’imposer sur toute l’île hormis les villes côtières génoises. En novembre 1755, Paoli fait voter une Constitution nationale corse très moderne : elle instaure une justice et un gouvernement représentatif et établit la séparation des pouvoirs. Elle fait d’ailleurs à l’époque l’admiration de l’Europe des lumières dont, surtout, Jean-Jacques Rousseau puisque la Corse fut ainsi la première région du monde à se doter d’un état démocratique moderne, et ce dés 1755 ! Pour lutter contre le blocus maritime génois, Paoli met sur pied une petite marine de guerre d’une quinzaine de navires qui arborent le pavillon à tête de Maure (le drapeau national corse avec la tête de Maure est adopté en 1760). Il décide également de frapper une monnaie à l’effigie de la tête de Maure en 1762 à Murato.
Face à une telle rébellion, par le traité de Versailles du 15 mai 1768, Gênes cède la souveraineté de la Corse à la France pour dix ans en gage d’une dette annuelle. La conquête de la Corse se fit alors en deux campagnes ; la première voit, en juillet 1768, les troupes françaises occuper le Cap Corse mais subir une grave défaite à Borgo le 9 octobre 1768. La seconde ne dure que quatre jours : l’armée de Paoli est écrasée à Ponte Nuovo le 8 mai 1769 . Pascal Paoli quitte la Corse le 13 juin 1769. Napoléon Bonaparte naît un mois plus tard, le 15 août 1769 à Ajaccio.
 La Corse est gouvernée par Marbeuf et devient pays d’États. Les États de Corse, assemblés et composés de 23 députés de chacun des trois ordres, choisis par élection indirecte, se réunissent huit fois entre 1770 et 1785. L’assemblée n’a qu’un rôle consultatif : toute décision dépend des commissaires du roi, l’intendant et le commandant en chef. L’administration confie peu de postes aux Corses sauf dans les échelons subalternes de la magistrature. L’administration des communes reste toutefois aux mains des autochtones. Les premières routes sont construites (de Bastia à Saint-Florent, et de Bastia à Corte). Les recensements démontrent un accroissement continu de la population. En 1789, alors que la Révolution éclate en France, l’Assemblée nationale, incitée par une lettre d’un comité patriotique de Bastia, décrète que la Corse est désormais partie intégrante de la monarchie française. Les Corses exilés sont alors autorisés à rentrer en France.
La Corse est gouvernée par Marbeuf et devient pays d’États. Les États de Corse, assemblés et composés de 23 députés de chacun des trois ordres, choisis par élection indirecte, se réunissent huit fois entre 1770 et 1785. L’assemblée n’a qu’un rôle consultatif : toute décision dépend des commissaires du roi, l’intendant et le commandant en chef. L’administration confie peu de postes aux Corses sauf dans les échelons subalternes de la magistrature. L’administration des communes reste toutefois aux mains des autochtones. Les premières routes sont construites (de Bastia à Saint-Florent, et de Bastia à Corte). Les recensements démontrent un accroissement continu de la population. En 1789, alors que la Révolution éclate en France, l’Assemblée nationale, incitée par une lettre d’un comité patriotique de Bastia, décrète que la Corse est désormais partie intégrante de la monarchie française. Les Corses exilés sont alors autorisés à rentrer en France.
Le 15 janvier 1790, la Corse devient un département avec Bastia comme chef-lieu et siège de l’unique évêché.

Tanti paesi, tante usanze.
Autant de pays, autant d’us et de coutumes.
Pour en savoir plus :
– l’article Wikipedia Histoire de la Corse
– le site Curagiu superbement documenté
– la France pittoresque, histoire du département

