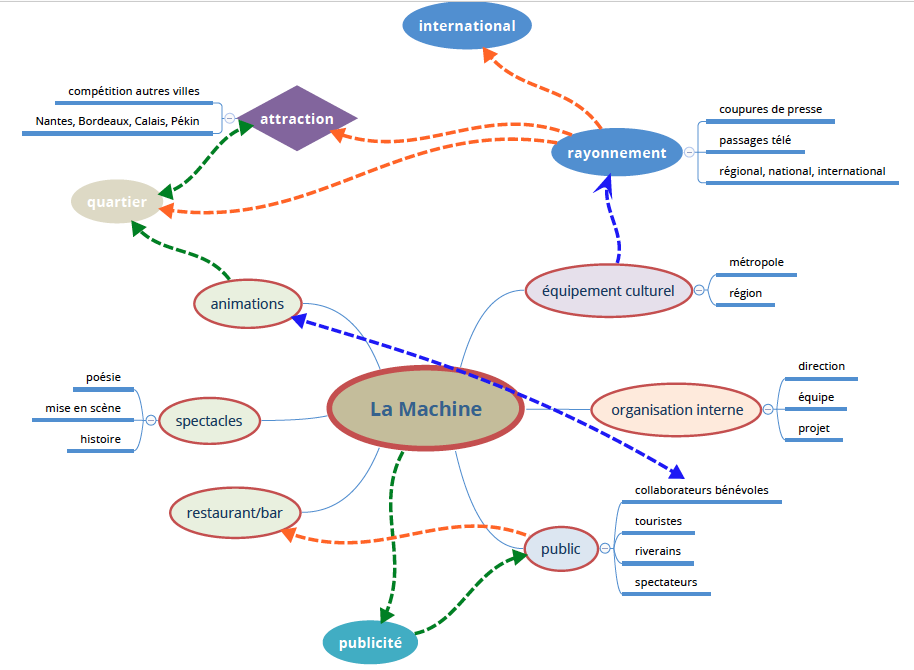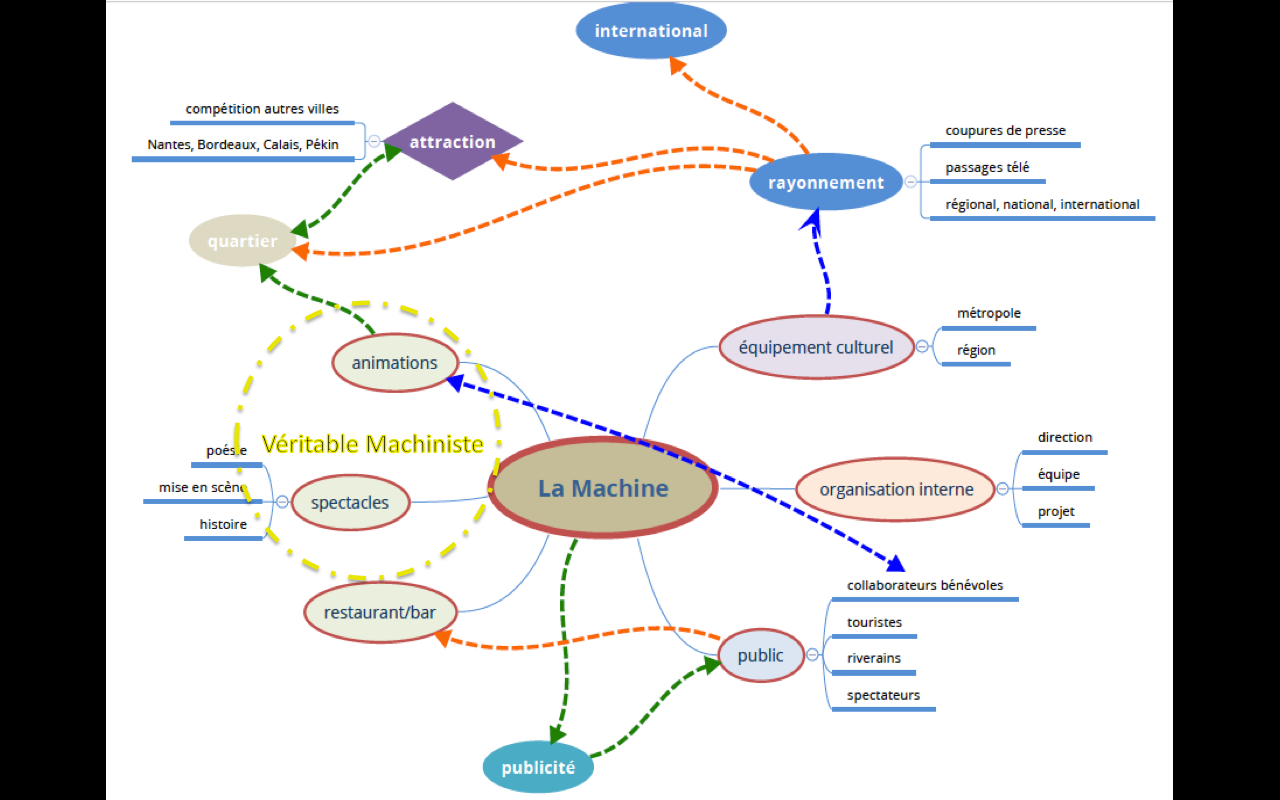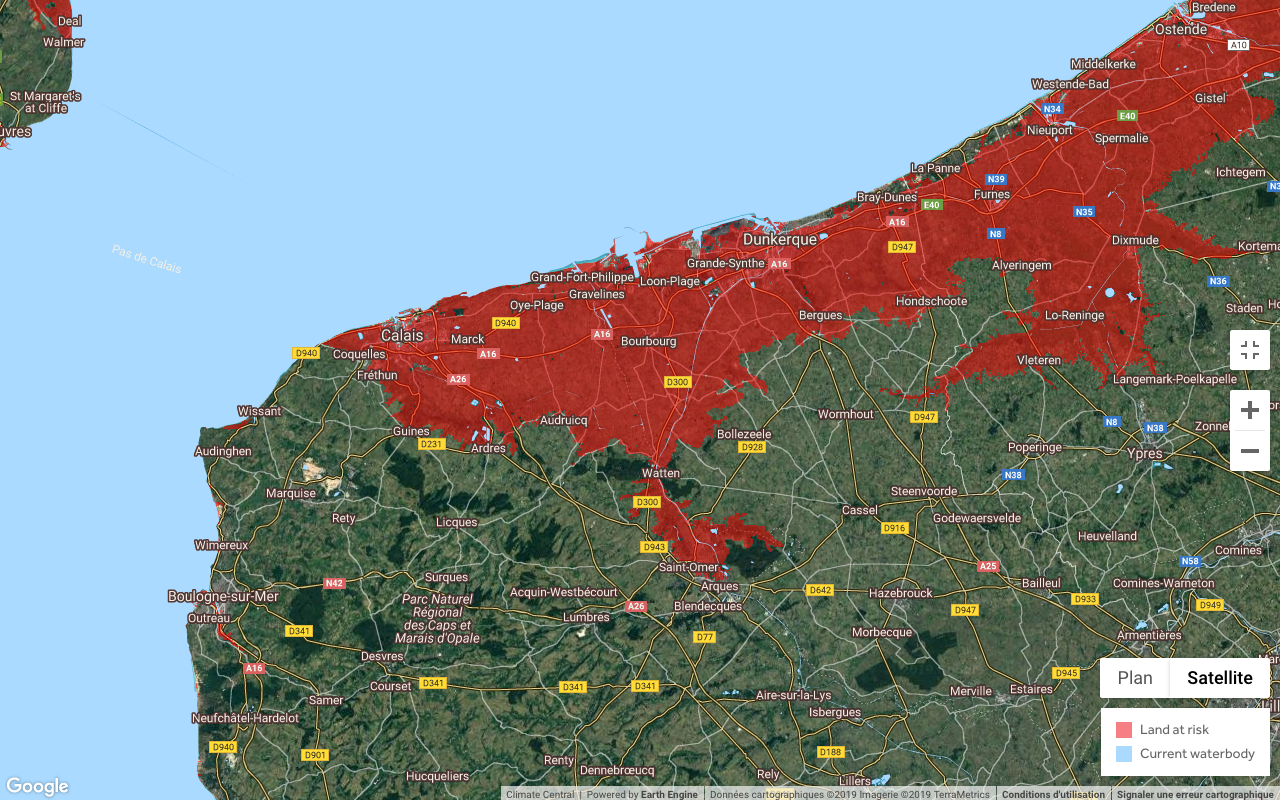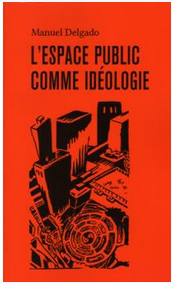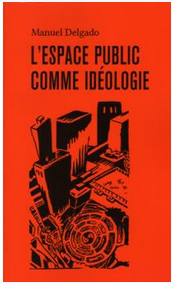
Cette semaine, j’ai proposé une méthode pour déchiffrer un article, à partir des outils de surlignage disponibles sur certains logiciels. Sur papier, il suffit de s’armer de la panoplie des surligneurs Stabilo Boss ®. Je vais donner un autre exmple à partir d’une note de lecture rédigée autour de l’ouvrage de l’anthropologue espagnol, Manuel Delgado. Les couleurs ne sont là que pour renforcer la visibilité des citations.
=> Manuel DELGADO, L’espace public comme idéologie, trad.. Chloé Brendlé, Toulouse : Les réveilleurs de la nuit, CMDE, 2016
Quatre chapitres composent ce livre de 134 pages, initialement publié à Barcelone en 2011. Il s’agit du premier ouvrage traduit en français de cet anthropologue espagnol, représentant du courant actuel de l’anthropologie sociale. Nous connaissions son existence à travers un article publié en langue française articulé autour de l’histoire de l’anthropologie urbaine où les travaux français dirigés par Jacques Gutwirth et Colette Pétonnet étaient abondamment cités.
Seul, le premier chapitre aborde la question de l’espace public sous l’angle de la critique épistémologique. Les autres chapitres portent sur la ville et, dirons-nous, une politique anthropologique urbaine. Nous ne verrons ici que le premier chapitre.
Dans ce premier chapitre, l’auteur déconstruit la notion d’espace public en commençant par rechercher l’origine de son emploi à travers des textes importants des années 1960 à 1980. Peu d’auteurs y font référence, se référant davantage à espace collectif ou espace urbain. Erving Goffman aborde cette notion « d’espace des et pour des relations en public », mais le couple Lyn et John Lofland en donne une définition précise et claire : « par espace public, j’attends ces endroits d’une ville auxquels, la plupart du temps, tout le monde a accès légalement. J’entends par là les rues de la ville, ses parcs, ses lieux de commodité publics. J’entends aussi les bâtiments publics ou les « zones publiques » des bâtiments privés » (p. 28). Se superpose à cette notion, la sphère publique qui constitue le volet politique des rapports sociaux en public pour aboutir à deux sortes de définitions de l’espace public : « espace public comme ensemble de lieux en libre accès », et « l’espace public comme milieu où se développe une forme spécifique de lien social et de relation avec le pouvoir » (p. 29).
Cette notion comporte donc une forte connotation politique et des rapports au politique, dans ce que Delgado nomme une « sphère de coexistence pacifique » (p. 30). Il associe cette notion à celle de la société qu’il définit comme « l’association libre et égalitaire de sujets conscients de leur interdépendance, qui établissent entre eux des liens de reconnaissance mutuelle » (p. 31) qu’il associe à la notion de citoyen discutée dans le dernier chapitre. Au centre de se dispositif se trouve une idéologie pacificatrice, proche de la classe moyenne, qui absorbe les rapports de domination dans une approche de démocratie participative où chacun peut avoir accès au contrôle de son existence. « Ils ne considèrent pas l’exclu et l’abus comme des facteurs structurels, mais comme de simples accidents ou contingences d’un système de domination qu’ils pensent perfectible sur le plan éthique » (p. 32).
L’espace public devient un espace démocratique où le citoyen est acteur d’une médiation tendant à assouplir les rapports de domination ou même à les effacer. « Les stratégies de médiation hégéliennes servent en réalité, selon Marx, à camoufler toute relation d’exploitation, tout dispositif d’exclusion, ainsi que le rôle des gouvernements dans la dissimulation et le maintien de toutes sortes d’asymétries sociales » (p. 33), pour un but inavoué qui serait de « faire respecter les intérêts d’une classe dominante » (p. 34).
Ainsi posé, l’espace public serait la « matérialisation concrète de l’illusion citoyenne » par laquelle les classes dominantes cherchent à « obtenir l’approbation des classes dominées en se prévalant d’un instrument – le système politique – capable de convaincre les dominés de sa neutralité. Elle consiste également à produire le mirage de la réalisation de l’unité souhaitée entre la société et l’Etat » (p. 34). Les mécanismes de médiation ne sont là qu’au service de l’Etat pour asseoir sa domination. A ce propos, il n’est pas innocent de voir se profiler l’idée d’une classe moyenne et de vouloir y mettre le plus grand nombre. Cela renvoie aussi à l’idée développée par Pierre Bourdieu selon laquelle les dominés sont dominés par leur domination, le travail de domination étant beaucoup plus efficace lorsqu’il agit sans répression ou que la répression vient de la classe dominée. Dans la mise en place du mécanisme, la transformation des attributs de l’espace en espace idéologiquement pensé permet de passer de la notion d’appropriation à celle d’incivilité dans un rapport citoyen au « vivre ensemble ». Dans ce prolongement, « le conflit ne peut être perçu que comme un anomalie » (p. 39).
Delgado pose ensuite la question de l’anonymat comme outil permettant d’estomper les différences, et de faire croire à une moyennisation des sujets, dans ce qu’il appelle une « fraternité imaginaire universelle » (p. 41). Devenue anonyme, l’individualité du passant est gommée, « les différences de statut et de classe ont été bannies » (p. 41) dans ce que Delgado nomme un « effet d’optique démocratique ». Cette idéologie ne résiste pas à l’épreuve du réel. Dans l’espace public, certains sont stigmatisés, niés, et ont l’apparence d’un non-citoyen. L’espace public se transforme en arène, en une scène publique qui attribue un marquage social qui « accentue dans beaucoup de cas leur vulnérabilité » (p. 42).
Derrière cette notion, la théorie des sciences sociales joue un rôle important puisqu’elle formalise et diffuse la notion. De Durkheim à l’école de Chicago, l’auteur dresse un portait des différents courants des sciences sociales qui ont contribué à produire et diffuser cette idéologie. « Souvenons-nous, nous dit l’auteur, que “le public“ est dans une large mesure comme domaine voué à la dilution des grandes luttes de religion qui caractérisent le XVIIè siècle, c’est-à-dire comme milieu voué à la réconciliation et au consensus entre les secteurs sociaux aux identités et intérêts opposés » (p. 44).
Delgado utilise ensuite le concept de “foule“ et en fait une comparaison avec cet autre agrégat social qu’est le public. C’est parce que la foule est inquiétante, et qu’elle constitue un élément irresponsable – infantile – considéré comme la principale actrice des émeutes et des révolutions par la psychologie qui s’en empare au XIXe siècle, que celle-ci forgera, en opposition, la notion d’opinion publique, définie comme l’« opinion du public comme ensemble discipliné et responsable d’individualités, la catégorie de base pour la gestion étatique des foules » (p. 45). Le « grand projet bourgeois de pacification généralisée des relations sociales » est en marche avec l’appui des principaux porteurs des théories sociales en Europe comme Outre-Atlantique. On le voit, les efforts pour convertir les “acteurs“ en “citoyens“ responsables et pacifistes fleurissent dans nos villes et nos quartiers. Ainsi, les politiques sont-ils aidés dans leur démarche par les architectes et autres médiateurs, qui véhiculent une pédagogie de la citoyenneté et du civisme. Des actions dans l’espace public, sous forme de fêtes, ont pour visée la diffusion de valeurs communes à la classe dominante, cherchant à neutraliser et pacifier le reste de la communauté humaine. L’auteur nous donne comme exemple l’action de la ville de Barcelone qui souhaite « préserver l’espace public comme lieu de vivre ensemble et de civisme » (p. 48), mais qui n’est en fait qu’un paravent qui masque en réalité des mesures de tolérance zéro vis-à-vis des populations les plus pauvres, marginales et précaires.
Devant l’affichage de ces valeurs morales, le mécontentement et le refus d’un consensus, d’une partie de la population, passent pour de l’incivilité et un refus de se convertir à cet « idéalisme de l’espace public » (p. 49). La responsabilité n’est plus du côté de la société, mais de l’individu a-social.
© Noël Jouenne, février 2017 (déjà paru en octobre 2017)