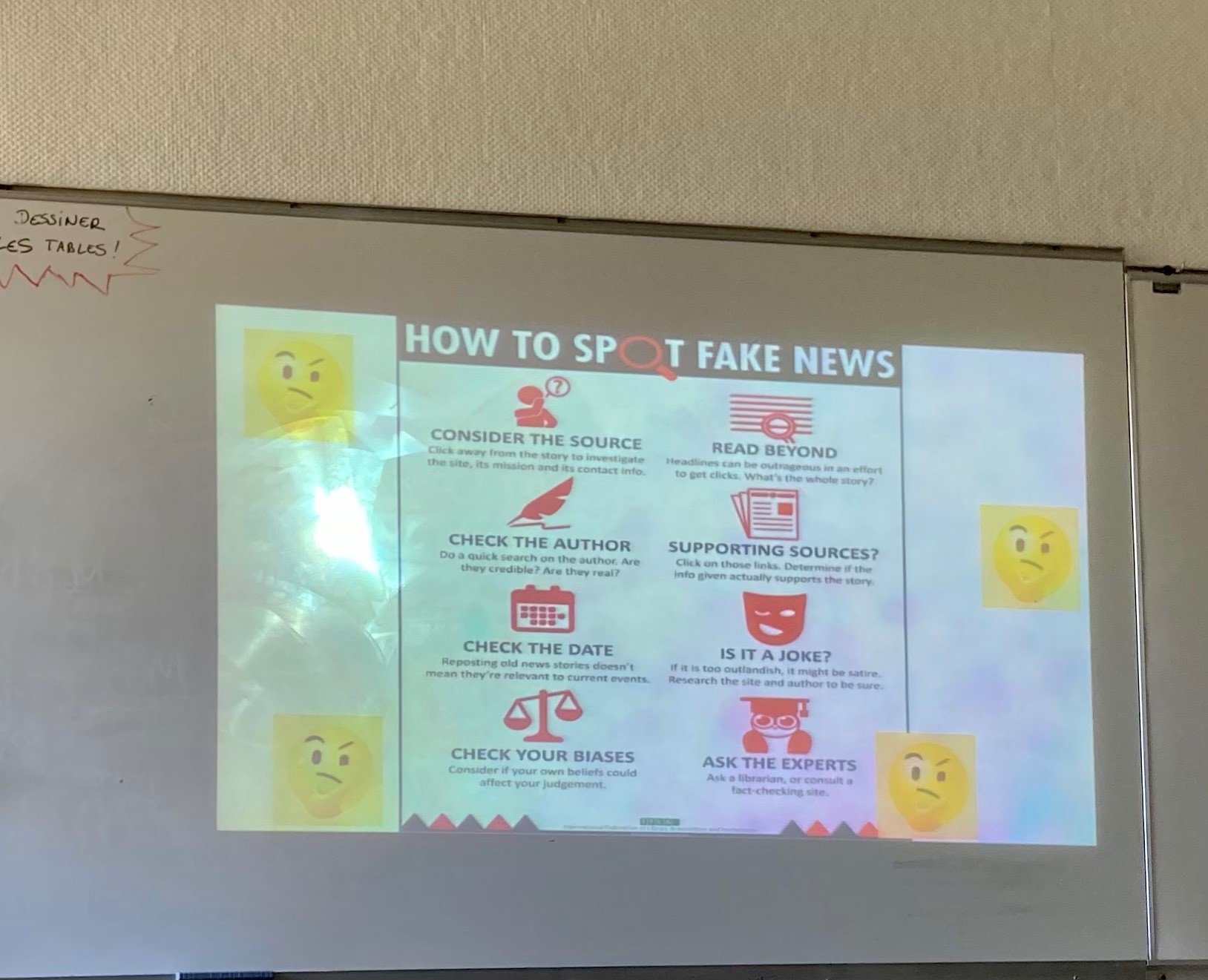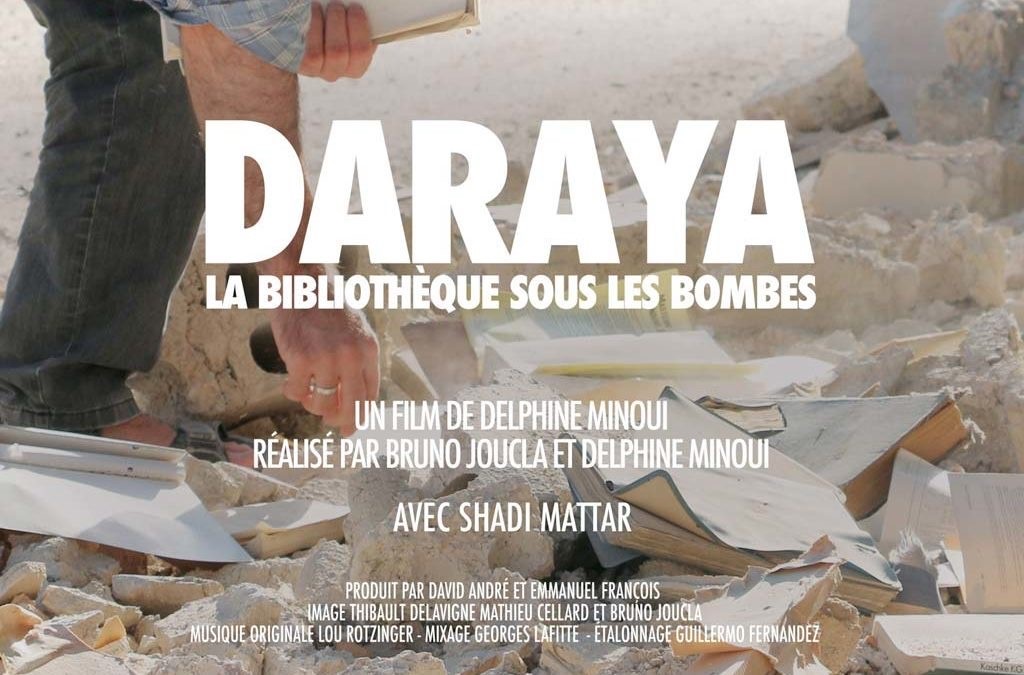Entrevue avec Jimmy Laporal-Trésor, réalisateur du film « Les Rascals », par Johane Hulin et Camille de Lavergne
Dans le cadre du label CaMéo au cinéma de Mérignac, des élèves du lycée Fernand Daguin ont assisté à une séance, le 27 janvier 2023, du film Les Rascales, de Jimmy Laporal-Trésor, sorti en 2023. Les élèves ont ensuite eu l’occasion de débattre avec le réalisateur et de lui poser des questions.

Pourquoi s’être lancé dans le cinéma ?
J’ai toujours aimé raconter des histoires. Au départ je faisais des petites BD, et ensuite je me suis lancé dans le jeu de rôle, surtout comme maître de jeu. J’écrivais des scénarios et je me renseignais sur les univers que je voulais créer. Un autre aspect important du jeu de rôle, est de réussir à tenir en haleine les joueurs. C’est tout cela qui m’a donné le goût pour la narration. La création d’un lien avec le spectateur est essentielle pour moi. Au départ, je me suis lancé dans le cinéma comme scénariste. Après j’ai voulu raconter des histoires autrement, à travers des images.
Dans ce film, justement, qu’avez vous mis en place pour capter l’attention du spectateur ?
J’ai tout de suite cassé le 4e mur. Avec cette première scène qui change soudainement de ton et où la caméra est agressée, malmenée comme Rico l’est : le spectateur est impliqué. Après ce moment, je replace le spectateur dans une situation de confort, pour qu’il baisse sa garde. J’ai besoin qu’il soit désarmé au moment de la scène du disquaire. Mon travail est toujours de placer le spectateur au bon endroit, émotionnellement, par rapport à ce qui se passe. Il y aussi la scène du fourgon de police : le personnage est en impuissance total. La caméra est, elle aussi, coincée dans le van : le spectateur est impuissant. Il ressent donc la même détresse que Mandale.
Le personnage de Rudy attire l’attention, on voit qu’il est différent, il a une sensibilité… Pourquoi avoir choisi de faire un personnage qui casse les codes du dur à cuir ?
Dès le départ, avec mes co-scénaristes, on concevait l’histoire comme une tragédie antique : un personnage est condamné par le sort. On a ici un personnage qui n’a pas sa place dans sa famille, ni dans sa bande de copains, ni dans la société. Il est déjà condamné par essence à ne pas avoir de place dans ce monde. J’ai construit Frédérique et Rudy en miroir : Frédérique, elle, épouse tout de suite la réponse violente mais regrette plus tard et essaie de faire le chemin inverse. Rudy, lui, essaie de rejeter cette violence au maximum mais finalement y succombe. C’est la tragédie sociétale.
Au niveau du casting aviez-vous des attentes particulières ?
Je n’avais pas de critère précis en tête pour trouver des acteurs, à part peut-être l’oralité. Les jeunes des années 80 s’exprimaient différemment des jeunes d’aujourd’hui, il fallait retrouver des personnes en capacité de s’exprimer avec ce ton, qui puisse nous rappeler l’ancien temps. J’avais cette envie de retrouver ce phrasé neutre de l’époque, proche de celui de Souchon, avec des phrases bien construites. Mon but est de dépayser et de faire vivre au spectateur un véritable voyage dans le temps. J’ai écarté de nombreux comédiens talentueux, car ils parlaient trop comme les jeunes d’aujourd’hui. Je cherchais bien sûr, de bons acteurs avec des individualités fortes, mais je cherchais aussi une alchimie naturelle entre eux lorsqu’on les faisait jouer ensemble.
Est-ce qu’il y a un film, un livre, un auteur qui vous à inspiré pour ce film, au niveau des plans par exemple ?
Deux films m’ont vraiment inspiré, surtout pour la direction artistique du film : « Tchao Pantin » de Claude Berri, tourné en 83, qui a été un des rares réalisateurs à montrer Paris différemment de la ville qu’on avait l’habitude de voir à l’écran. Dans les films des années 80, on retrouve un Paris clinquant, brillant, qui nous ramène à des années 80 sur lesquelles on à tendance à fantasmer. Berri montre au contraire une ville sale, sombre, poisseuse, beaucoup plus proche de la réalité de l’époque. Je me suis inspiré des éclairages, de ses lumières rouges et vertes, ainsi que de l’éclairage extérieur. A l’époque, en ville, les lumières étaient plus blanches, nous avons donc du changer les ampoules pour retrouver l’atmosphère et l’ambiance des années 80.
Dans le deuxième film, « Moi Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée » d’Uli Edel, je me suis inspiré de l’image froide et bleutée. Nous avons donc utilisé ce filtre bleu pour refroidir l’image. Les films des années 80 sont généralement haut en couleur, avec des images très chaleureuses, j’avais vraiment envie de casser ce fétichisme.
A l’aide de quoi avez-vous pu recréer les années 80 ?
Pour les vêtements, c’était le plus simple, il a simplement suffi de retrouver des témoignages photographiques dans des livres, des catalogues de l’époque ou encore des sites qui permettent de retrouver de vieilles photos de classe. Les reportages, ou les images de l’INA nous ont aussi beaucoup aidés, notamment pour les costumes et les coiffures. De même pour les décors, il faut des références qui permettent d’avoir une idée de la topographie des lieux des années 80. Il y a ensuite un gros travail de repérage pour trouver des bâtiments et un travail de crédulité, pour qu’ils paraissent un maximum authentique.