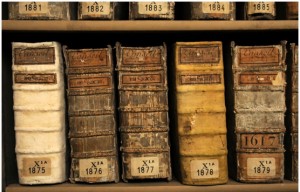Petit rappel : qu’est-ce-que Twitter ?
Twitter est un site de micro-blogging crée et mis en ligne en 2006. Le principe du micro-blogging est d’envoyer des messages synthétiques très courts, constitués au maximum de 140 caractères. Ce site a entraîné une révolution au sein du monde numérique. En effet, situé à mi-chemin entre le réseau social et le blog, il a rapidement vu son nombre d’utilisateurs croître pour arriver à 500 millions en février 2012.
Pourquoi Twitter marche-t-il si bien ?
Twitter a été un outil original qui a rapidement été utilisé par les personnalités du monde entier pour entrer en contact avec leurs fans. Nous pouvons notamment penser aux comptes Twitter de Lady Gaga ou Justin Bieber dans le domaine musical, ou encore Barack Obama dans le domaine politique. Cette proximité entre personnes séduit à la fois les personnalités et ceux qui les suivent, donnant une impression de communication réelle.
A l’instar des réseaux sociaux comme Facebook ou Google+, Twitter permet une présence en ligne qui se veut immédiate. En effet, on peut suivre en temps réel les faits et gestes de la personne qui twitte, et on peut donc immédiatement y répondre. Cette instantanéité des dialogues est la prochaine évolution, ce que certains nomment déjà le web 3.0.
Pontifex : la révolution du numérique appliqué à l’Église.
L’Église a donc fait le choix de l’instantanéité entre le Pape et ses fidèles, au dépend de celui du réseau social typique. La question de la présence en ligne est relancée. En effet, volonté de modernisation de l’institution catholique ou volonté de médiatisation du souverain pontife dans le but de toucher plus de personnes à la cause catholique qui tombe en désuétude? Sans se lancer dans un débat théologique ou religieux qui n’est pas le propos ici, il est intéressant de voir comment une institution aussi ancienne s’adapte au monde moderne numérique et sait tirer parti de ses ressources.
Force est de constater que l’institution catholique a appris à manier les nouveaux outils qui s’offraient à elle. En effet, de plus en plus de personnes viennent s’informer sur ces réseaux plutôt que de regarder la télévision, lire des journaux, … Lors de la démission du Pape Benoît XVI, l’information a été twitté immédiatement après le discours. Ce compte Twitter a été cloturé lors de la renonciation du Pape émérite et réouvert au moment de l’élection du nouveau Pape François, qui a déjà twitté à sept reprises.
De la réelle utilité de la présence en ligne de l’Église et du Pape.
Cela pose cependant une question. En effet, si le compte suit les fluctuations des renonciations, conclaves et autres élections, qu’en est-il de sa visée informative sur le déroulement des événements aux moments précis où ceux-ci se déroulent ? La visée de l’instantanéité n’est-elle pas remise en cause par la clôture du compte lors du conclave ? Compte qui a été rouvert par la traditionnelle formule latine « Habemus Papam Franciscum » le 13 mars 2013. Ce compte est désormais suivi par plus de 3 millions de followers, et devrait bientôt passer la barre des 4 millions.
Le Vatican et son chef d’état se situe donc dans une position ambivalente qui est celle de la tradition catholique et du cérémonial entourant l’élection d’un Pape, et la volonté de se moderniser et d’être présent sur la toile. A noter que le Vatican fut l’un des premiers états à se doter de sa propre radio nationale, ainsi que de sa propre chaîne de télévision. Ce qui laisse à penser qu’au fur et à mesure de l’évolution du numérique, il est fort à parier que l’Église saura utiliser les outils du numérique pour communiquer avec des personnes du monde entier. Elle commence déjà d’ailleurs assez bien en ayant ouvert plusieurs comptes au Pape, ce qui permet la traduction des messages pontificaux en plusieurs langues différentes. Où quand Twitter permet à l’Église d’être visible à l’international.
Sources