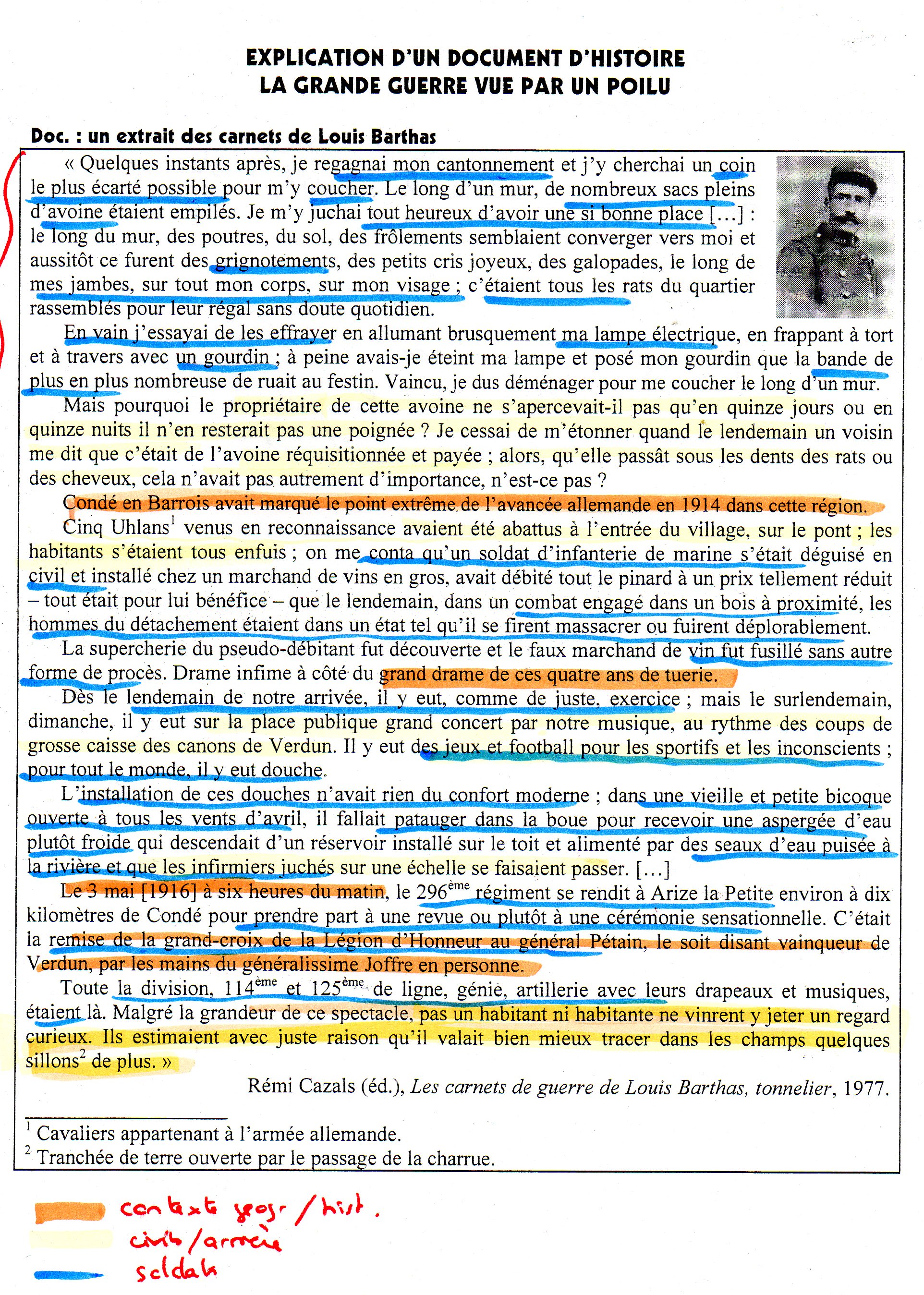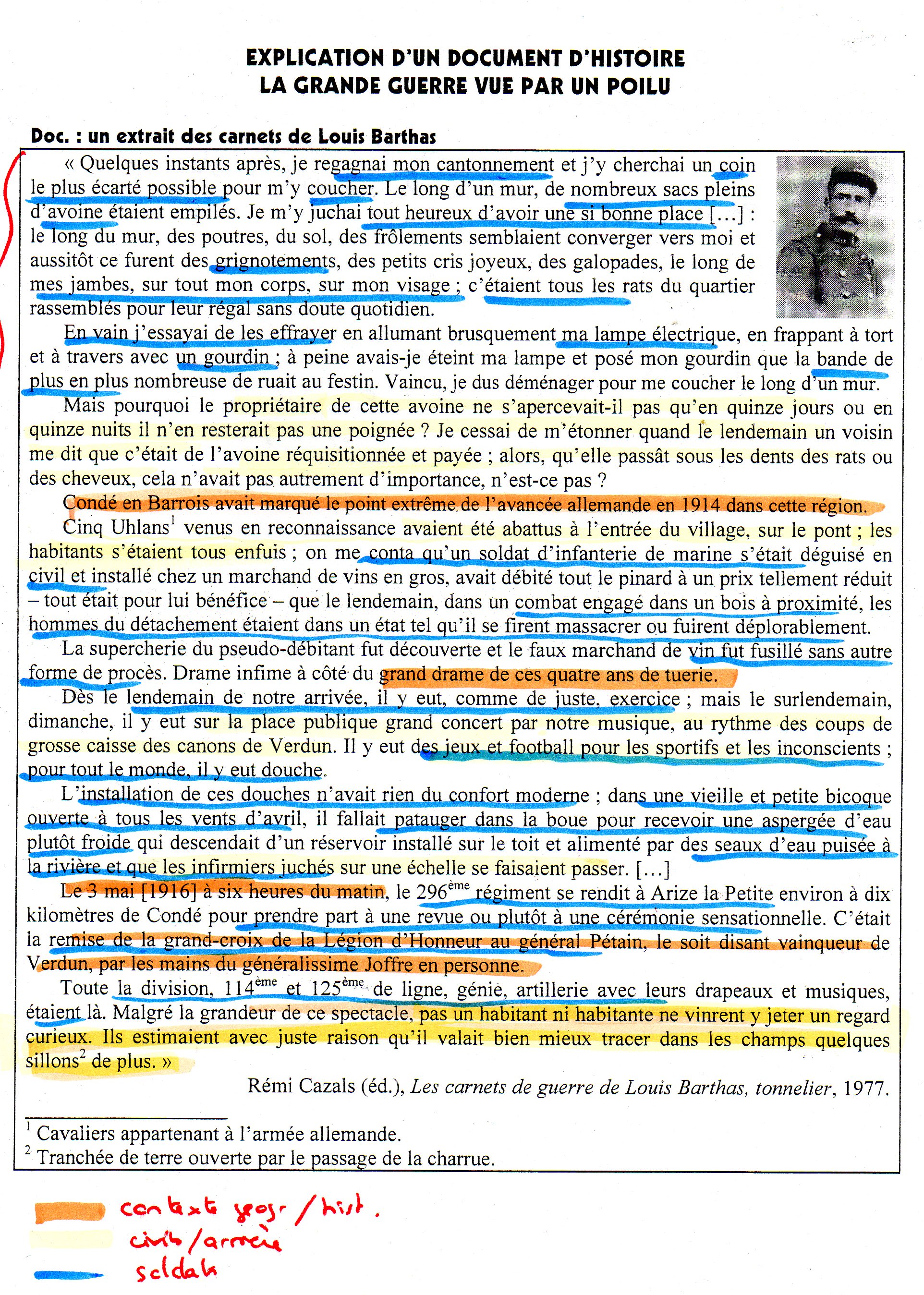Voici à la fin de cet article comment vous pouviez utiliser les couleurs dans votre texte pour l’analyser :
Tout d’abord, un exemple de correction :
Ce document est un extrait des carnets de guerre de Louis Barthas. Il s’agit d’un journal intime, que ce tonnelier a tenu pendant la Grande guerre de 1914-18 dans laquelle il a été mobilisé. Cet extrait se passe en 1916, année où la guerre des tranchées fait rage, et raconte la vie difficile d’un poilu renvoyé quelque temps à l’arrière en Artois. Cet extrait a été rédigé après 1918, la mention de la ligne 22 suppose en effet que Louis connaît la durée de la guerre ! Il est possible qu’il ne l’ait pas écrit pendant la guerre pour éviter la censure. Ces carnets sont publiés en 1977 seulement. Ce document nous permet donc d’observer à la fois les difficultés de la vie des soldats mais en même temps de percevoir ce qui se passe à l’arrière, autrement dit d’analyser la mobilisation de tous dans ce conflit qui fut une guerre totale (selon le terme de Ludendorff en 1937 : peuple et armée ne faisaient qu’un »).
Tous les moyens humains sont donc mobilisés , avant tout bien sûr les soldats : la mention du « 296 eme régiment » montre le nombre de régiments engagés : ainsi plus de 8,5 millions de Français ont été envoyés au front. Mais tous ne se battent pas de la même façon : dans le texte, il est fait mention de 5 Ulhans, cavaliers se battant sur le front, de « soldats d’infanterie de marine » qui se bat en mer. De plus, les canons de Verdun cité en ligne 25 supposent que des artilleurs tirent des obus depuis l’arrière sur les tranchées ennemies (22 Millions au total !).Au front les soldats vivent dans des conditions très difficiles. Le texte souligne la promiscuité , l’auteur cherche une place pour dormir . L’hygiène est souvent déplorable, la toilette n’étant pas possible dans les tranchées, d’où leur surnom de « poilus ». Même ici, lors des permissions si rares « Les rats du quartier » vivent avec les soldats, les empêchant de dormir, entraînant des épidémies… Il souligne aussi que l’installation d’une douche « n’avait rien du confort moderne » : les poilus sont en effet privés de tout mais sont heureux de la moindre amélioration de leur sort ainsi qu’il le montre en dormant sur des sacs plutôt que sur le sol. C’est ainsi que en 1917, Pétain en améliorant les conditions de vies et l’accès au permissions des soldats , parviendra à mettre fin aux mutineries.…L’histoire du faux marchand de vin montre que les soldats ont parfois vu dans l’alcool, ou encore dans des automutilations par exemple, leur seule échappatoire à l’horreur de la guerre. Celle-ci est en effet particulièrement brutale. Les mots « abattus », « fusillé » « canons »… montrent que les soldats se tirent dessus avec des fusils, que les artilleurs bombardaient les tranchées avec des obus, sans oublier les combats au corps à corps, à la baïllonnette. Ces armes causent la mort, des blessures, des mutilations, des traumatismes psychiques. Au total 9 millions de morts dont 1,5 millions de Français et plus de 4M de blessés. Les mots « massacrés », « tueries » renforcent cette idée. Mais la mort n’est pas seulement donnée lors des batailles : le pseudo débitant sera ainsi fusillé « sans procès ». En effet la justice militaire est sévère face aux traîtres pour faire cesser les mutineries , et plusieurs (environ 10% des mutins) seront jugés, voire condamné pour l’exemple (3700 dont environ 500 condamnations à mort). Mais pour les soldats, la mort est une expérience quotidienne qui entraîne pour eux un certain détachement, ainsi qu’il le montre ligne 22,la mort paraissant même parfois normale , surtout celle de l’ennemi (déshumanisation ) .
L’arrière aussi est largement mobilisé. Ainsi dans une guerre totale le pays est entré dans une économie de guerre : le pays entier doit travailler pour l’armée. Les productions agricoles sont réquisitionnées pour le front, pour nourrir les hommes et les chevaux, ainsi que le révèle l’épisode de l’avoine. Les productions industrielles aussi sont tournées vers une économie de guerre, Renault fabrique des chars au lieu de voitures. Cela entraîne des privations chez les civils, des restrictions, un ravitaillement beaucoup plus difficile, des augmentations de prix. On utilise aussi les civils pour travailler par exemple dans les infirmeries ( ligne 30) de campagne, les femmes pour travailler comme munitionnettes, les jeunes filles comme marraine de guerre, et toute la main-d’oeuvre disponible participe au travail des champs pour remplacer les hommes et subvenir aux besoins du pays, ainsi qu’il est fait mention dans la fin du texte.Les civils participaient aussi financièrement en engageant leur épargne, l’État lançant des emprunts afin de financer cette guerre si coûteuse.La population souffre aussi directement des faits de guerre comme le montre le fait qu’il soit obligé de s’enfuir, les Allemands s’étant avancé en 1914 jusque dans cette région (quatrième paragraphe ) : ainsi le front s’est installé entre la Somme et les Ardennes, au Nord-Est de la France, détruisant de nombreux villages comme Fleury, et obligeant la population à fuir ses immenses champs de combat.Les violences faites aux civils pouvaient être nombreuses, matérielles comme la destruction de leur maison, mais aussi physiques comme les blessures (tirs d’obus ) ou des viols…
Enfin l’État mobilise aussi les esprits avec la propagande : la remise de la grand-croix au général Pétain, est une cérémonie patriotique destinée à remonter le moral des civils et des soldats afin de souder les spectateurs autour de valeurs communes, et retrouver l’esprit de « l’union sacrée » du début de la guerre. Mais les commentaires de l’auteur montrent bien l’état d’esprit de la population en 1916 : « aucun habitant ne vinrent », traduisant leur désintérêt pour ces événements. La population se lasse de ce conflit qui devait être rapide et qui dure depuis déjà deux ans. Même si la croix de guerre est une récompense qui sera donnée plus tard à beaucoup de soldats morts pour la France, Barthas montre d’ailleurs par son ton ironique qu’il lui semble anormal que cet honneur soit attribué à Pétain « soit-disant vainqueur » et non aux soldats qui se sont battus à verdun ! .
…
Ces carnets sont donc un témoignage écrit par un homme qui a vécu la guerre et qui décrit au jour le jour les événements auxquels il a participé. Ainsi il nous donne aux lecteurs et aux historiens de nombreux renseignements sur le quotidien, la perception d’un soldat . Cependant ce texte est subjectif : il n’est pas en lui-même une analyse historique : Barthas relate ses propres souvenirs, il n’engage que lui. De plus ce journal est rédigé soit immédiatement soit juste après la guerre, donc sans le recul nécessaire à une certaine objectivité. De plus il ne relate qu’une expérience parmi d’autres qu’il conviendrait de comparer pour une certaine exhaustivité…