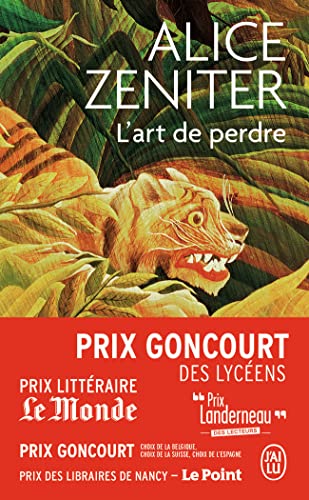Un voyage de tolérance entre passé et présent

Par Emilie Mistrot, élève de terminale 7 et membre de l’atelier critique du Festival international du film d’histoire de Pessac
Avec Où est Anne Frank !, Ari Folman s’adresse à la jeune génération sur la question de la tolérance.
Par des allées et venues dans le passé d’Anne Frank, Ari Folman met en scène la Seconde Guerre Mondiale, dans unr Amsterdam occupér par les nazis, figurés en grands méchants de films enfantins. Seuls personnages masqués, et rappelant le Sans-visage (Kaonashi) dans Le Voyage de Chihiro, on comprend alors que le choix de représentation de ces derniers n’est pas anodin. Le Sans-visage de Miyazaki semblait être dévoué à la jeune fille, prêt à réaliser les pires folies, masquant en réalité un réel besoin de solitude. Son masque de nô symbolisant par ailleurs la dissimulation de soi et la confusion des identités, que l’on pourrait voir dans la représentation des nazis par Ari Folman, formés et endoctrinés dès leur plus jeune âge à servir aveuglement leur führer. En les déshumanisant ainsi, tous représentés de la même manière, Ari Folman lance un message politique antifasciste.
L’esthétique animée du film, permet à la fois d’atténuer la violence et la terreur des événements mais aussi d’utiliser l’imaginaire. C’est alors par des graphismes doux et chaleureux
(hormis lors des scènes représentant les nazis) que Ari Folman peut inventer et créer l’imaginaire. En effet, les couleurs sont harmonieuses et ne sont jamais trop vives, les traits des visages expressifs et les yeux d’Anne Frank pétillants. Les dessins sont par ailleurs accompagnés de musiques mélodieuses et lumineuses lorsque les scènes portent un message de paix. À l’inverse, les scènes représentant les nazis donnent une impression d’enfermement, le ciel est nuageux et sombre, et seul le bruit des pas lourds des soldats se fait entendre. L’imaginaire du réalisateur et surtout de la jeune Anne Frank en adoucissent alors les contours lors des affrontements, par l’intervention des créatures mythologiques et du mythe grec des enfers qui fascinent tant Anne Frank et de nombreux autres enfants.
Par-delà une démarche historique, le réalisateur expose son opinion politique, critiquant la marchandisation moderne des figures du passé. « Anne est partout », tout autour de cet appartement les bâtiments modernes et des ponts ont repris son nom, des pièces de théâtre lui sont dédiées, les centaines d’éditions de son journal sont vendues dans le monde entier et ses mots en deviennent déformés. Le propriétaire du musée qu’est devenu l’immeuble nous apparaît d’ailleurs caricaturé, semblant détaché de l’histoire de la jeune fille et vivant pourtant sur le dos de celle-ci. La façon dont Ari Folman représente ce musée et les touristes qui le visitent semble également faire le rapprochement avec toute l’économie développée sur les souffrances des autres. Notamment, les visites des camps de concentration et d’extermination où les employés sont décrits avec le même détachement que l’homme enrobé.
On remarque par ailleurs tout au long du film l’affichage de sortes d’avis de recherches du fameux journal, en l’échange d’une somme importante en récompense, comme si l’on pouvait donner un prix journal… Ces affiches peuvent alors être vues comme la satire de la propagande, de la publicité, et des préoccupations parfois futiles des sociétés contemporaines. Le rôle central de la mémoire et de la réelle portée des messages de ces anciennes figures est alors présenté comme une responsabilité collective par le réalisateur, mettant en scène la jeune Kitty défendant Anne Frank et critiquant la pièce qui lui est dédiée : « Elle n’a jamais dit ça ! ». Ari Folman veut ainsi faire de ses spectateurs, et notamment de la jeune génération, des héritiers du passés et acteurs du présent. Le parallèle fait avec la situation actuelle des réfugiés et des enfants de réfugiés, longuement décrite et illustrée, s’inscrit alors également dans sa démarche politique. En effet ces derniers sont finalement sauvés par le message d’Anne Frank rappelé par la jeune Kitty : « Faites tout votre possible pour préserver une seule âme. Une seule âme ! ». On peut alors voir un slogan dans le titre du film, dont le point d’exclamation apporte une dimension politique.
Les scènes de flashback finissent toutefois par être lassantes, donnant l’impression que Ari Folman aborde des passages obligatoires de la vie d’Anne Frank, et se prive de raconter l’histoire du présent pour faire retourner Kitty dans le passé. En effet, lorsque Kitty plonge dans le passé de Anne au travers de la lecture du journal, l’encre qui s’évapore donne lieu à des scènes qui deviennent répétitives au point d’avoir le sentiment d’observer un générique de dessin animé à maintes reprises. Elles donnent ainsi lieu à une scène qui paraît indispensable pour le réalisateur, au théâtre Anne Frank, dans laquelle Kitty s’installe parmi les spectateurs, non pour observer le spectacle mais pour plonger dans le journal, demandant à son voisin de la lumière pour lire dans la salle plongée dans le noir. Le sentiment que le réalisateur avait une scène à placer, dans le but d’aborder tous les moments clés de la vie d’Anne Frank mais sans réellement savoir où est alors déplaisant. On se sent par ailleurs soulagé lorsque celles-ci n’apparaissent plus, comme s’il en était de même pour lui, ayant rempli ses obligations. Il est également dommage que certaines répliques et scènes semblent parfois trop enfantines et idéalistes bien que cet aspect pourrait être lié à la jeunesse d’Anne Frank (décédée à 15 ans seulement) et de Kitty. Par ailleurs, la relation que Kitty développe tout au long du film avec un jeune garçon (Peter, apparemment orphelin), alors décrite comme une relation amoureuse dès la première rencontre s’inscrit également dans une démarche plutôt naïve. Si elle peut être vue comme un parallèle avec l’histoire d’Anne Frank et de Peter dans l’appartement d’Amsterdam, elle n’apporte
rien au film. Kitty a été envoyée dans le présent pour faire perdurer le réel message d’Anne Frank et le faire entendre dans le monde entier. La relation amoureuse développée, entre une personne réelle et imaginaire, paraît dès lors superflue, en plus d’être un peu gênante.
Reste que l’appel d’Ari Folman à ses spectateurs retentit avec force, amplifié par un mégaphone. Au travers d’un message de tolérance et d’espoir, le cinéaste apporte son soutien aux familles et enfants réfugiés, victimes d’une histoire en perpétuelle répétition.
Où est Anne Frank !
Belgique, France, Israël, Pays-Bas, Luxembourg, 2021
Titre original : Where Is Anne Frank
Réalisation : Ari Folman
Scénario : Ari Folman, d’après Le Journal
d’Anne Frank
Musique : Ben Goldwasser et Karen O
Genre : animation, historique, fantastique
Durée : 99 minutes
Date de sortie en France : 8 décembre 2021