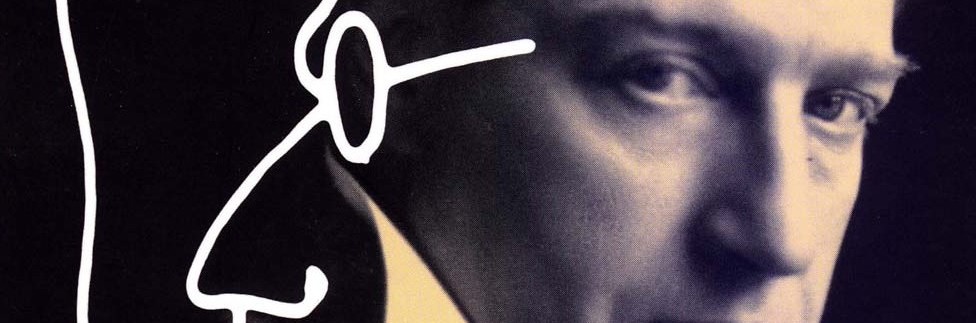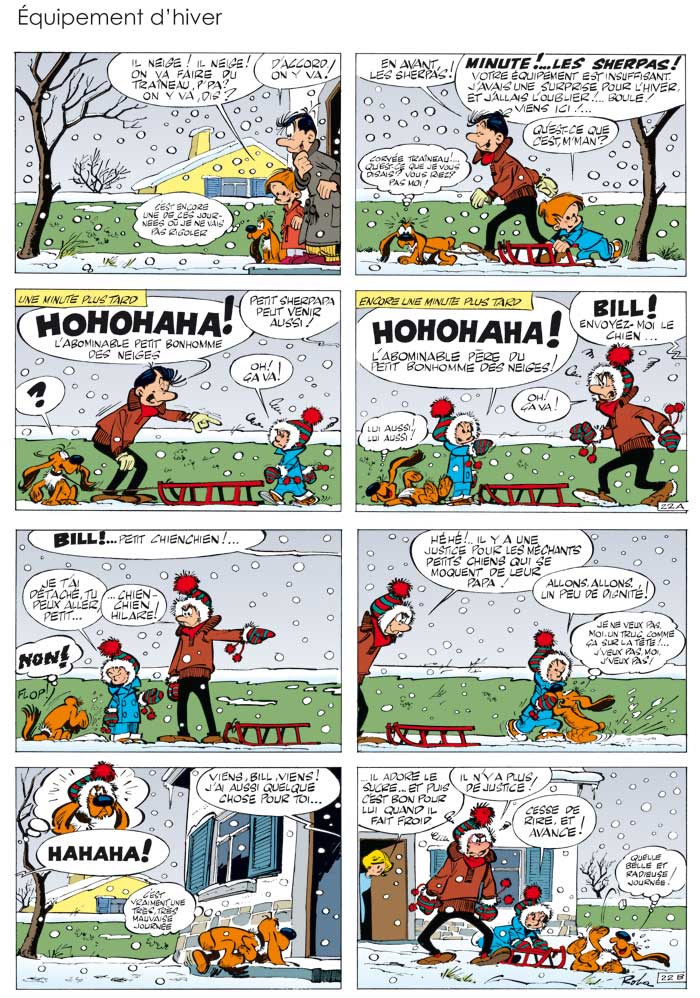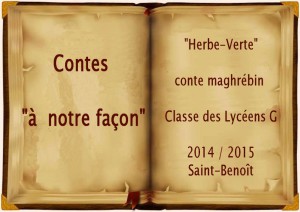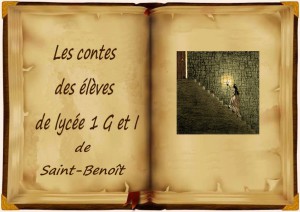Pour découvrir le système français et s’interroger sur les pratiques de classe, le film « Entre les murs » de Laurent Cantet, dont les dialogues et les attitudes si réalistes font sourire tant ils sonnent juste :
Objectifs :
- le système scolaire français : institution, administration, hiérarchie, sanction, durée des études, principes et pratiques …
- la pratique de classe : cours dialogué, place de la récitation, de la compréhension et de l’esprit critique, pédagogie de projet …
- le rapport enseignant / élèves : autorité, complicité, affection, indifférence…
- l’apprentissage du français pour des élèves d’origine étrangère
- la diversité sociale et culturelle : violence, défi, mépris, justice…
- la laïcité, valeur républicaine
- puiser dans un ensemble de fiches pédagogiques très bien concues de l’Institut français : EntreLesMurs fiches péda
- lire l’article intéressant de Philippe Meirieu , sociologue de l’éducation , dont le regard est éloigné de celui des spectateur-prof et spectateur-élève : Meirieu à propos du livre et du film « entre les murs »
- regarder et analyser un extrait :[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=FACNtax1MGw[/youtube]
Le film peut être mis en parallèle avec celui de M- C. Mention-Schaar Les héritiers , dont les critiques généralement négatives ne peuvent cacher l’intérêt de la pédagogie de projet dans une classe jugée ingérable car multiculturelle et multiconfessionnelle.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=wKstUWkxs4s[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=mTQ5r9HdjmM[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=EYEQJ6_6Qrc[/youtube]