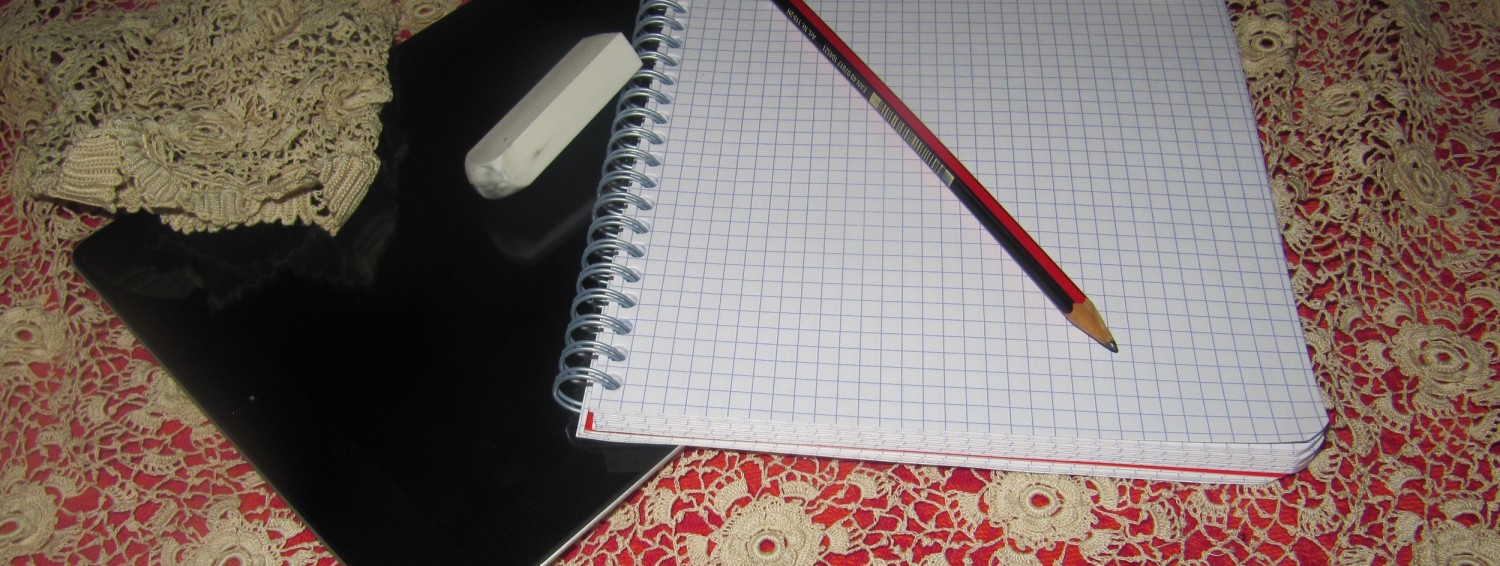Nicolas Roland, dans le webinaire ITyPA, et Perine Brotcorne, dans un article publié sur Educavox ont un point commun : ils ont observé les étudiants utiliser les outils numériques lors de leurs apprentissages.
Sur un certain nombre d’éléments, leurs observations convergent. On imagine nos élèves nés avec une souris à la main. On croit leur maîtrise des technologies innée. Or, selon Nicolas Roland, ils ne sont pas nécessairement compétents en technologie et pas nécessairement détenteurs de stratégies. Créer une page Facebook pour travailler de manière collective n’est pas nécessairement un signe de compétence. On peut y voir l’expression de leurs limites technologiques en terme de gestion de contenus. Quant à Perine Brotcorne, elle estime que les jeunes ne savent pas utiliser internet comme outil de travail. C’est en particulier la compétence informationnelle qui leur manque. Ce n’est pas parce qu’on sait ACCEDER à un contenu qu’on sait l’ORGANISER et l’EXPLOITER. Ce n’est pas parce qu’on manipule vite les touches d’un clavier qu’on gère le fond des choses de manière complexe.
Ces constats coïncident avec les expériences que je fais en classe. Par exemple, je complète le cahier de textes en ligne en mettant à la disposition des élèves les supports que j’utilise que ce soit sous forme de textes, de documents sonores ou de liens vers des sites. La plupart rencontre des difficultés à télécharger les documents audio parce qu’ils ne disposent pas de leur plateforme de téléchargement habituelle. De plus, ils n’ont pas le réflexe de classer les supports ainsi mis en ligne. Et il suffit que plusieurs enseignants procèdent d’une manière analogue à la mienne pour que leur stockage d’informations devienne illisible.
Je pense qu’il y a des risques réels à vivre dans l’illusion que les élèves maîtrisent mieux que nous les technologies.
-
Nous risquons de ne pas leur apprendre ce dont ils auront besoin dans le monde du travail, à savoir gérer des contenus complexes avec les outils spécialisés dans leur domaine.
-
Nous risquons de les amener à considérer l’adulte comme systématiquement incompétent et à se voir eux-mêmes comme nullement dans l’obligation d’apprendre. Danger réel ou imaginaire ? En tout cas, quand, récemment, un de mes élèves de seconde a bloqué sa session sur le réseau (justement en téléchargeant un fichier son) et que je suis venue le voir, il m’a très bien fait comprendre que les manipulations que je testais, ils les avait déjà mises en oeuvre, mieux que moi (puisqu’il me disait au fur et à mesure comment faire). Ayant toujours un plan B, je l’ai renvoyé à sa place travailler sur un lecteur MP3. Heureusement pour moi, j’ai réussi à remettre sa session en place. Dernièrement, ce même élève a rencontré des difficultés pour accéder à un site dans ma discipline. Pas ses camarades (ouf!). En tout cas, en voilà un qui est convaincu de savoir, de savoir mieux que l’autre (surtout quand l’autre est un adulte). Ne risque-t-il pas d’oublier d’apprendre ?