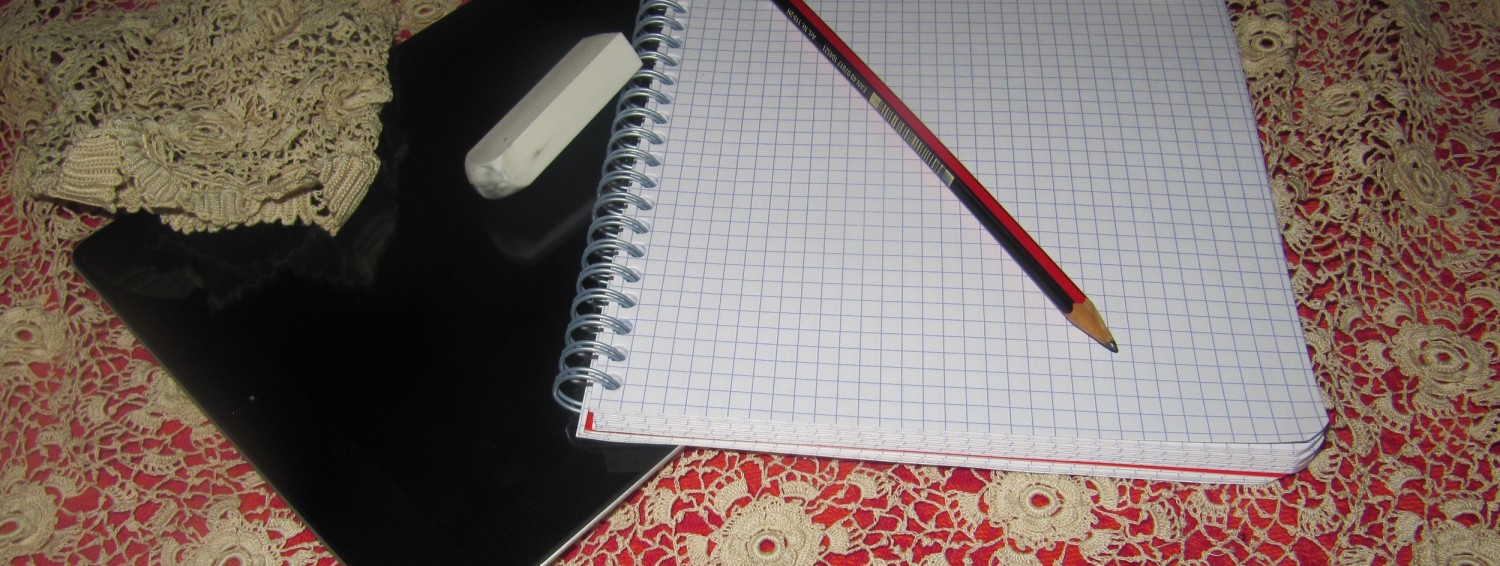Le bilan que je tire de la lecture de l’article de Pascale Catoire tiré du site adjectif.net est que, dans le domaine de la didactisation de la compréhension orale en langue vivante, les enseignants sont livrés à eux-mêmes.
D’abord, la compréhension orale est considérée comme une compétence complexe à travailler. Elle s’inscrit, en effet, dans la fugacité temporelle. Discrimination auditive et construction se sens se font dans l’instant. Le message n’est pas toujours totalement accessible.
Qu’apportent les outils numériques dans ce contexte ? Ils sont considérés comme un atout. Ils permettraient à l’élève de travailler à son rythme, de faire des pauses et des retours en arrière. Mais on peut aussi constater parfois certaines limites aux usages de ces outils à cause de l’alourdissement de certaines contraintes. Utiliser le clavier, suivre des images peuvent constituer des obstacles à la compréhension du message audio. Par ailleurs, mettre en ligne des ressources s’avère insuffisant car le travail nécessite des compétences et des stratégies.
En analysant les discours institutionnels tels que le guide de la baladodiffusion de 2010 et les instructions officielles du programme de cycle terminal, on constate qu‘il n’y est pas question de stratégies. Seuls deux aspects sont évoqués :
-
une description des compétences visées
-
l’autonomie des élèves présentée comme un postulat
Que faire en classe pour amener les élèves à la maîtrise de cette compétence ? En l’absence de proposition de didactisation méthodologique, les enseignants sont donc livrés à eux-mêmes. Deux possibilités se présentent alors à eux : puiser dans leur propre expérience issue de tâtonnements au quotidien, se nourrir d‘échanges informels avec leurs collègues.
Une occasion aussi de regretter une quasi-absence de recherche scientifique en éducation.