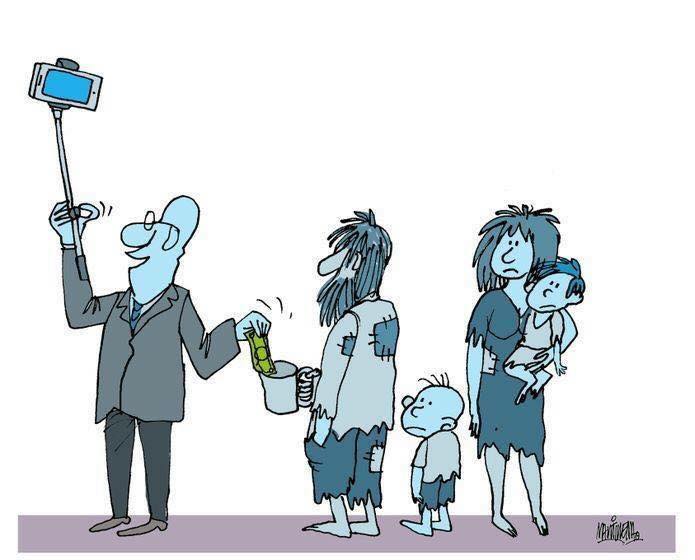1- Il faut rester au moins 3 heures !!!! Vous ne pouvez pas réaliser un devoir digne de ce nom en partant avant. Tous les élèves partis avant auraient pu facilement améliorer leur devoir en prenant le temps de développer, corriger leur copie.
2- L’orthographe peut être améliorée en respectant certaines règles de base : les pluriels, les participe passé (mettez au féminin), les fautes les plus courantes : il a tort et pas tord ; langage et pas language; philosophie et non phylosophie; malgré et non malgrés; Lock, Pascale, Décarte; un enfant en basage; partial et non partialle;
3- Respectez la forme dissertative : on passe des lignes entre les parties, on va à la ligne à chaque nouvel argument.. cf comment faire une dissertation
4- On ne commence pas une partie par un auteur ni un connecteur logique comme En effet, ou Cependant…
5- Les références doivent être exactes : ne pas se tromper sur l’auteur ni l’oeuvre.
6- Soulignez le nom des oeuvres
7- Les parties du plan doivent être annoncées comme des thèses, c’est-à-dire, par des phrases et non seulement des mots, thèmes.
8- Revoir la forme interrogative indirecte ex: on se demandera si la conscience est-elle…..
9-Il faut toujours expliquer une citation sinon c’est juste pour broder, « faire genre »…
10- distinguez inconscient et inconscience !!!!!
11- Reliez tous vos propos au sujet, à la question posée !! sinon c’est hors-sujet, ce n’est pas au correcteur de deviner votre réponse !!!
12- la question posée n’est pas un problème !!!!!!
13-Les expressions à bannir : « la vie de tous les jours »; « au jour d’aujourd’hui »; (ces deux expressions vous font passer pour des cakes); « moi profond » (femme actuelle); « comme par exemple » (comme=par exemple); « Depuis la naissance de l’humanité »; « depuis toujours »…
14- pas de JE pense, je crois, à mon avis, ma réponse…
15- La question d’autrui chez Sartre n’a rien à voir avec l’inconscient !!!
16- « Freud tente donc avec acharnement de prouver sa thèse.. »; « envoyés loin dans l’inconscient »; « le garçon de café pense être garçon de café donc il est garçon de café »… et s’il pense être une betterave ??
17- le moi « juge et jugé » n’a rien à voir avec autrui ! justement il est partial car il se juge lui-même !
Si besoin vous trouverez tous les conseils de méthode dans la catégorie prévue à cet effet !
Introduction
« Qui suis-je » ? Je semble être le mieux placé pour me poser la question et y répondre. La réponse me semble évidente : je connais mon état civil, ma généalogie, mon passé, mes goûts, mes pensées… Mais tout comme Roméo qui s’il ne s’appelait plus Roméo, conserverait encore les chères perfections qu’il possède », je ne me réduis pas à mon nom qu’il soit Montague ou celui de la rose. Et mon identité ne saurait pas davantage se réduire à mon ADN car l’expérience me prouve qu’il n’est pas rare de ressentir cette étrangeté, cette altérité en moi, de me surprendre, me méconnaître. Et c’est souvent lors d’une crise identitaire (adolescence, quarantaine), une remise en question, quand on ressent des remords, quand on est surpris du regard d’autrui sur soi, qu’on en arrive à poser cette question « Qui suis-je? ». Car on vit la plupart du temps comme si la réponse allait de soi, comme si notre identité ne posait pas problème, comme si elle était de l’ordre du bien connu. Il semble alors qu’on soit à la fois le mieux placé pour répondre de manière exacte à la question « qui suis-je » mais aussi le moins bien placé puisque juge et partie, on manquerait inévitablement d’objectivité, et sans aucune possibilité de vérifier, de sortir de soi pour savoir si l’on est bien ce que nous croyons être. Condamné à se voir sous le prisme de la subjectivité, on ne pourrait jamais être certain de l’authenticité du portrait que l’on fait de soi.
Peut-on alors répondre de manière exacte à cette question ? Il semble que nous soyons devant trois problèmes que nous étudierons à la faveur de trois axes :
Tout d’abord, peut-on être sûr de la réponse ? Peut-on avoir une quelconque certitude quant à la connaissance de soi ?
Nous verrons, ensuite, la réponse sera-t-elle conforme à la réalité ? Si c’est moi qui y répond, il faut pouvoir comparer ! Or comment comparer si nous l’objet et le sujet de la question se confondent ?
Enfin, la réponse ne risque-t-elle pas d’être approximative, incomplète, variant au gré de mes changements (physiques, moraux, …) ? Comment répondre de manière exacte si je change sans cesse ? Comment rester identique, exact malgré les changements ? Mon identité est-elle mise en péril sans cette exactitude ?
I Je peux répondre avec certitude que je suis (ce que je suis, mais pas qui je suis)
-Seul l’homme se pose cette question et peut y répondre parce qu’il a une conscience (contrairement aux animaux). Cf. « Posséder le Je », l’enfant troisième personne…ex : test du miroir
-Mais s’il peut répondre facilement lorsqu’il s’agit de dire ce qu’est un objet, en revanche il semble voué à se décrire de manière non exhaustive (à l’infini). On peut donner l’essence d’un objet, sa définition, sa fonction; ce qui est impossible pour l’homme. Le définir reviendrait à lui coller des étiquettes, des stéréotypes, à l’identifier à. La réponse ne serait donc pas exacte, mais dirait ce qu’il est, comme autre chose, ce qu’il a en commun, ce qu’il partage avec d’autres. Cf. Sartre coupe-papier; essence/existence; Beauvoir féminisme…
-Je peux répondre avec certitude que je suis. Ma pensée me révèle mon existence comme chose pensante, dont la grandeur est de se savoir misérable (fini), dont la dignité est de faire l’unité dans ses représentations.
Transition =Mais cette vérité indubitable est partagée avec tous les hommes quand ils pensent; elle est anonyme, impersonnelle parce qu’universelle (essence humaine) Descartes (cogito), Kant (pas unicité); sommes-nous voués à ne pas nous connaître ? que savons-nous de nous ?
II Mais ma réponse peut manquer d’objectivité et d’impartialité (besoin de la médiation d’autrui)
-moi juge/jugé; juge et partie; sur/sous estime; Narcisse; partial,
-on peut se mentir à soi-même, se leurrer, croire qu’on a une essence définie, qu’on peut répondre exactement à la réponse qui suis-je, comme le garçon de café; mais c’est preuve de mauvaise foi, cela cache une angoisse d’assumer de n’être rien, ou de pouvoir tout être, la liberté. Prétendre qu’on peut répondre exactement cache une volonté de ne pas se poser la question, se remettre en cause, c’est se chosifier.
-besoin du regard d’autrui , médiateur entre moi et moi-même; honte; enfer c’est les autres; Sartre; la question peut être posée à autrui mais il ne faut pas se réduire à sa réponse. Elle n’est pas exacte, il faut combiner deux réponses, regards : le sien et celui d’autrui afin de mieux se connaître. Poser la question à autrui est donc salvateur et instructif. (pas unité), mais réponses multiples
Transition :Mais nous devons nous poser la question et tenté d’y répondre malgré les difficultés pour pouvoir répondre de ses actes et acquérir la liberté.
III Et la question « qui suis-je » est sans cesse à reposer car mon identité change, ne se dévoile pas immédiatement et s’affirme dans l’action.
-réponse partielle car connaissance incomplète de soi : surprise, étonnement, regret… et changements => identité personnelle à construire, unité, unicité, ipséité, mémoire, conscience Locke; fou, amnésique « hors de soi » j’ai changé »; réponses multiples, puzzle
la réponse ne peut être exacte car la question est mal posée : l’identité n’est pas identique, elle change or « qui suis-je? » présuppose une fixité, une stagnation. On devient, on a à être bien plus qu’on est. Une chose est, le sujet existe. La question est à poser sans cesse au cours de la vie, seule la mort pourra fournir une réponse exacte mais toujours au passé. C’est donc une question qui ne peut être posée par la personne au présent, puisque lorsqu’elle pourrait y répondre (essence figée), elle ne peut plus (elle est morte).
-l’inconscient nous empêche de nous connaitre totalement… Freud mais on peut s’approcher de la réponse en travaillant sur soi, introspection, psychanalyse.
-La question prend son sens quand la situation accule l’individu; lorsque la situation l’oblige à s’affirmer contre, lui fait obstacle. On s’identifierait alors plus contre qu’à quelque chose ou quelqu’un. L’affirmation du sujet serait effective dans l’opposition. Ainsi l’action de transformer le monde (l’objet qui s’oppose à moi), la révolte, le combat l’oppression seraient autant de moyens et d’occasions pour le sujet de se poser la question « Qui suis-je » et d’y répondre par l’action et le projet de son existence. « Nous n’avons jamais été aussi libres que sous l’occupation » Sartre.