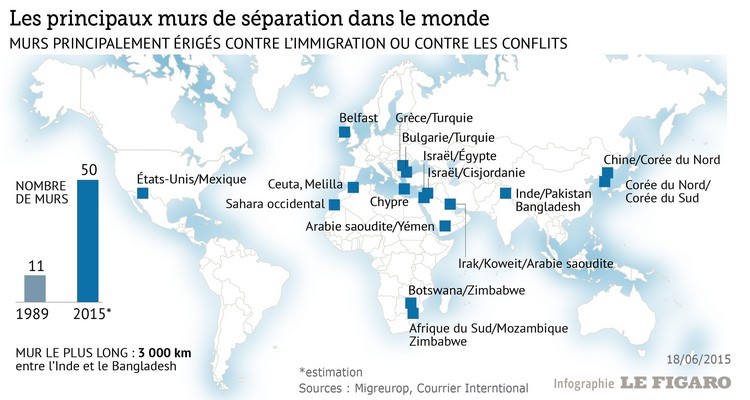Voici un site TheTrueSize.com qui permet de rendre à certains pays (comme la Russie ou le Groenland) leur juste taille. En effet, les cartes peuvent être trompeuses…
Une fois sur le site, il vous suffit d’entrer le nom d’un pays (en anglais) puis de faire bouger sa projection sur la carte. Vous constaterez alors que la taille et la forme du pays sélectionné changent à mesure que vous l’éloignez ou l’approchez de l’équateur. La raison ? La projection de Mercator qui est le type de planisphère le plus utilisé.
 Parce qu’il est difficile de représenter la sphère terrestre (notre globe en 3D) sur un morceau de papier plat (pour obtenir un planisphère), les cartographes utilisent une « projection » pour transformer le globe en carte (donc en 2D). Ainsi, à chaque projection correspond une distorsion de l’espace. Par exemple, la projection de Mercator tend à agrandir les pays qui se trouvent au niveau des pôles. C’est notamment le cas du Groenland : sur le planisphère, il a l’air presque aussi grand que l’Afrique alors qu’il fait la taille de l’Algérie…
Parce qu’il est difficile de représenter la sphère terrestre (notre globe en 3D) sur un morceau de papier plat (pour obtenir un planisphère), les cartographes utilisent une « projection » pour transformer le globe en carte (donc en 2D). Ainsi, à chaque projection correspond une distorsion de l’espace. Par exemple, la projection de Mercator tend à agrandir les pays qui se trouvent au niveau des pôles. C’est notamment le cas du Groenland : sur le planisphère, il a l’air presque aussi grand que l’Afrique alors qu’il fait la taille de l’Algérie…
En revanche, la projection de Peters évite ce type de déformation ; mais contrairement à la projection de Mercator, elle ne conserve pas les angles, ce qui se traduit par la déformation des continents sur le planisphère…
 Ainsi il existe différentes techniques de projections que l’on peut classer en fonction des mesures qu’elles permettent de respecter (les angles, les longueurs ou les surfaces).
Ainsi il existe différentes techniques de projections que l’on peut classer en fonction des mesures qu’elles permettent de respecter (les angles, les longueurs ou les surfaces).
La projection cylindrique classique du géographe et mathématicien flamand Mercator (XVIe siècle) a l’avantage de respecter les angles et donc de faciliter le tracé des itinéraires maritimes et aérien; mais elle ne respecte pas les surfaces. L’historien et géographe allemand Arno Peters (XXe siècle) a donc inventé une nouvelle projection qui a l’avantage de respecter à la fois les angles et les surfaces, mais qui ne respecte pas les contours.
Ce n’est vraiment pas si simple de représenter le monde !